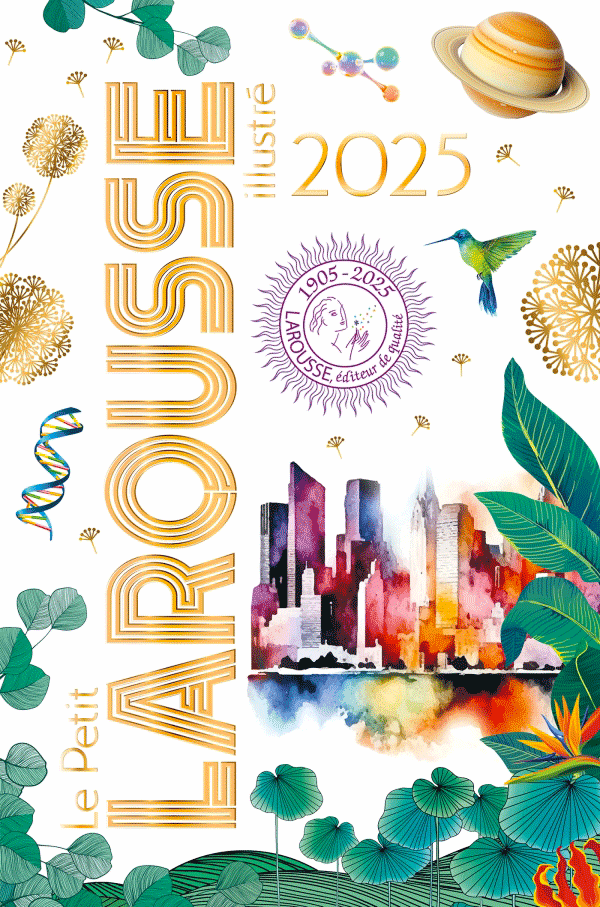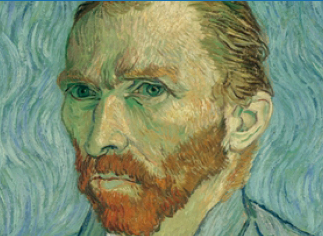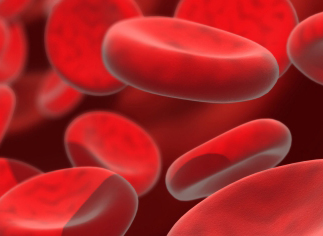États-Unis : vie politique depuis 1945

1945-1991 En 1945, produisant à eux seuls la moitié des biens manufacturés du monde, les États-Unis sont en mesure d’aider à la reconstruction du Vieux Continent, et ce d’autant plus que l’URSS apparaît très vite comme un nouvel ennemi, protégé par une sphère d’influence qui échappe à leur emprise (→ guerre froide). Dès lors, et jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989 et l’implosion du géant soviétique en 1991, ils deviennent les leaders et protecteurs des pays capitalistes occidentaux, tout en s’employant, par la course aux armements et l’aide au développement, à tailler, parfois difficilement, des croupières à la zone d’expansion communiste (guerres de Corée, puis du Viêt Nam). Depuis les années 1990 Les États-Unis se muent en « gendarmes du monde », essayant de faire valoir leurs valeurs et intérêts à l’ensemble des nations et régions du globe, non sans susciter des tensions qui peuvent donner lieu à des réactions hostiles voire des attaques directes (attentats terroristes de septembre 2001). Engagés dans la traque de leurs nouveaux ennemis, et pris dans la nasse d’une nouvelle Grande récession à la fin des années 2000, ils semblent devoir perdre de leur superbe, notamment au regard de l’émergence de nouvelles puissances économiques comme la Chine, l’Inde ou le Brésil. Mais ils ne sont pas sans garder maints atouts qui laissent entrevoir pour quelques décennies encore le maintien de leur suprématie.
1. De la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 1960 : prospérité et leadership occidental
1.1. Le leadership américain
Terminer la guerre, rétablir la paix

Harry Truman, successeur de F. D. Roosevelt, est appelé à prendre de lourdes responsabilités pour achever la guerre (utilisation de la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki les 6 et 8 août) et pour faire face aux problèmes posés par l'effondrement des puissances de l'Axe : occupation de l'Allemagne et du Japon, réorganisation politique du monde selon les principes démocratiques (Charte de San Francisco, qui jette les bases de l'Organisation des Nations unies [ONU], 26 juin 1945), remise en ordre des économies des pays vaincus et même alliés, pour enrayer la poussée du communisme international.
Le plan Marshall et le début de la guerre froide

L'aide économique promise par Truman (discours du 12 mars 1947), et réalisée par des prêts de la banque « Import Export », et surtout par le plan Marshall (discours de Harvard, 5 juin 1947), facilite le retour de l'Europe occidentale à une économie du temps de paix. Mais, n'ayant pu arrêter la guerre froide ni empêcher la création de nouveaux régimes de démocratie populaire (coup de Prague, 1948 ; blocus de Berlin, 1948-1949), les États-Unis décident d'organiser la défense du monde non communiste en créant un système d'alliances militaires dont ils sont la cheville ouvrière : pacte de l'Atlantique Nord (OTAN) du 4 avril 1949, consolidé par l'envoi de troupes en Europe.
Les échecs subis en Asie (triomphe du régime communisme en Chine, 1949 ; guerre de Corée, 1950-1953) les contraignent à signer de nouveaux accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande (pacte du Pacifique, ou ANZUS, septembre 1951), avec l'Asie du Sud-Est (OTASE, 8 septembre 1954), et de l'Est (pacte nippo-américain de sécurité, consécutif au traité de paix, 8 septembre 1951), même à soutenir ceux du pacte de Bagdad (1957).
Ainsi se trouve nouée une chaîne d'alliances enserrant le monde communiste ; les bases militaires (plus d'une centaine) créées à la périphérie de celui-ci, la couverture aérienne assurée souvent vingt-quatre heures sur vingt-quatre par les bombardiers atomiques du Strategic Air Command, la présence permanente des VIe (Méditerranée) et VIIe (détroit de Formose) flottes assurent la protection des points les plus névralgiques. Cet appareil guerrier et coûteux ne leur permettant pas de pallier les risques de subversion intérieurs, les États-Unis ont dû, en outre, accorder (point IV de la doctrine Truman) une aide financière très substantielle aux pays sous-développés, qui ne leur assure pas toujours l'amitié des pays bénéficiaires (difficultés avec certains États d'Amérique latine et surtout du Proche-Orient), mais qu'ils doivent poursuivre pour contrebalancer l'influence soviétique.
Le maccarthysme et la coexistence pacifique

Les États-Unis, où la crainte du communisme a abouti au maccarthysme (Joseph McCarthy) et à un filtrage très sévère des immigrants, ont adopté la politique « dure » de John Foster Dulles, secrétaire d'État de Dwight David Eisenhower (président de 1953 à 1961). Mais cette politique échoue, et l'Amérique doit accepter le partage de la Corée (1953) et du Viêt Nam (1954). Cependant, avec Khrouchtchev et après la mort de Staline (1953), une relative détente s'instaure. Mais elle reste fragile, et, en mai 1960, la conférence de Paris est un échec.
1.2. Les démocrates au pouvoir (1960-1968) : J. F. Kennedy et L. B. Johnson

La difficile mais décisive victoire remportée le 8 novembre 1960 par le parti démocrate avec l'élection de son candidat John Fitzgerald Kennedy à la présidence s'explique par un ensemble de circonstances particulièrement défavorables au parti républicain sur un quadruple plan :
– économique (récession de 1960-1961),
– politique (ségrégation raciale dans le Sud, crise de l'alliance occidentale provoquée en partie par l'affaire de Suez dès 1956),
– militaire (retard pris par l'industrie américaine de l'espace par rapport à la soviétique),
— et institutionnel (l'amendement de 1951, qui interdit à Eisenhower de briguer un troisième mandat présidentiel).
En outre, son catholicisme et le choix du Texan Lyndon Baines Johnson comme candidat à la vice-présidence assurent à J. F. Kennedy le vote de 80 % de ses coreligionnaires et celui de la grande majorité des Sudistes, ainsi que l'appui de tous les cadres du parti démocrate.
Ne disposant néanmoins que d'une très faible majorité (113 000 voix, soit 0,15 % des 68 832 000 électeurs qui ont exprimé leur suffrage), J. F. Kennedy doit, pour assurer son autorité, faire preuve d'audace avec l'aide d'une administration rajeunie, dirigée par des universitaires dynamiques.
« Nouvelle Frontière » et « Grande Société »


Cette action s'inscrit dans le cadre d'un programme qui vise à redonner aux Américains une mentalité de pionniers et dont il a défini les grandes lignes dans le discours prononcé après son investiture par le parti démocrate, le 13 juillet 1960 : c'est la « Nouvelle Frontière », celle au-delà de laquelle doivent être définitivement rejetées la faim, l'ignorance, l'injustice – et la guerre leur fruit naturel –, par une lutte qui doit être menée aussi bien à l'intérieur du territoire des États-Unis, dont la pauvreté et la misère ne sont pas absentes, qu'en dehors des États-Unis, où les deux tiers des hommes ne mangent pas à leur faim.
Ces thèmes seront en grande partie ceux mêmes du programme dit « de la Grande Société », qui sera celui de L. B. Johnson après son accession, le 22 novembre 1963, à la présidence des États-Unis à la suite de l'assassinat à Dallas de J. F. Kennedy. À l'élection présidentielle du 3 novembre 1964, L. B. Johnson est élu à une forte majorité (61 % des voix, contre 39 % au candidat républicain Barry Goldwater).
La politique économique et sociale des démocrates
Pour que ce programme soit mené à bien, il faut, au préalable, briser la récession et relancer l'expansion. J. F. Kennedy, contrairement aux républicains, préfère les remèdes fiscaux et budgétaires aux remèdes monétaires, afin de relancer les investissements et la consommation.
– Sur le premier point, le Revenue Act de 1962 et la loi complémentaire de février 1964 accordent des allègements fiscaux aux entreprises au triple titre de l'amortissement, de l'investissement et de la recherche scientifique et expérimentale.
– Sur le second point, par suite de l'opposition du Congrès, ce n'est qu'en octobre 1963 que J. F. Kennedy peut faire déposer et qu'au début de 1964 que L. B. Johnson peut faire accepter une double réduction de l'impôt personnel et de l'impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, le budget est appelé à contribuer à la relance de la consommation grâce à une forte augmentation des dépenses fédérales ; d'abord, dans le domaine purement militaire de l'armement classique et, surtout, des études aérospatiales sous l'impulsion de la NASA. Aux dépenses de défense nationale s'ajoutent à partir de 1965 d'importantes dépenses sociales.
Enfin, une politique monétaire d'accompagnement freine la fuite des capitaux à l'étranger (hausse de 2,3 % en 1961 à 3,5 % en 1964 du taux de l'intérêt à court terme des bons du Trésor à trois mois). Cette politique met ces capitaux à la disposition des entreprises américaines par simple abaissement du taux de réserve des banques, réduit, pour les dépôts à terme, à 5 % dès septembre 1960 et à 4 % en octobre 1962 ; le gouvernement augmente encore les liquidités disponibles en recourant à la pratique de l'Open Market par rachat par le Federal Reserve Board de fonds d'État pour 1,850 milliard de dollars en 1960 et 8 milliards de dollars de 1961 à 1964 inclus. Cette politique assure l'expansion du pays dans la stabilité.
Afin de porter remède aux difficultés des catégories sociales les plus défavorisées, le gouvernement démocrate pratique une triple politique de soutien des prix, d'ajustement de l'offre à la demande et d'aide à l'exportation. L'ensemble de son œuvre législative est couronné par l'Economic Opportunity Act du 20 août 1964 (« loi contre la pauvreté »).
La lutte pour les droits civiques et la question noire

Pour régler, au moins partiellement, le problème noir, en constante aggravation et qui provoque la création des mouvements divers tels que la Southern Christian Leadership Conference (SCLC), fondée en 1957 par le pasteur baptiste Martin Luther King, le Congrès vote et le président Johnson signe le 2 juillet 1964 le Civil Rights Act, loi sur les droits civiques : celle-ci interdit toute discrimination raciale dans les lieux publics et en matière d'emploi, les États récalcitrants étant automatiquement privés des crédits fédéraux. En 1965, le Voting Rights Act, loi sur le droit de vote, garantit celui-ci sans dictinction d'origine ethnique. Dans le seul Mississipi, en trois trois ans, de 1965 à 1968, la proportion d'Afro-Américains inscrits sur les listes électorales passent de 7 à 59 %. C'est la fin de la ségrégation.
Toutefois, ces lois n'empêchent pas les Noirs de s'orienter de plus en plus sur la voie du séparatisme, celle que prêchent les Black Muslims de Elijah Muhammad et les membres de l'Organisation de l'unité afro-américaine, fondée en 1964 par Malcolm X, peu avant son assassinat le 21 février 1965.
Ces mouvements séparatistes voient leur action renforcée par la misère générale de leurs frères de couleur et orientée vers la violence par le mot d'ordre « Black Power ! » lancé en 1966 par Stokely Carmichael. La tension, qui débouche sur des incidents de plus en plus graves, allant des émeutes de Harlem (juillet 1964) et de Watts à Los Angeles (août 1965) jusqu'à la véritable insurrection des Noirs de Detroit et du Michigan (juillet 1967), semble remettre en cause l'unité de la nation.
Enfin, l'assassinat, à Memphis, de M. L. King (avril 1968) provoque des violences dans de nombreuses villes américaines. Mais cet événement contribue à l'adoption d'une loi interdisant la ségrégation raciale dans l'habitat et à l'élaboration de mesures pour lutter contre la ségrégation scolaire .
Entre détente et crises : la politique extérieure de J. F. Kennedy
Appuyée sur une puissance militaire accrue, la diplomatie américaine s'efforce de limiter l'expansion du communisme international tout en sauvegardant la coexistence pacifique, seul point sur lequel J. F. Kennedy et Khrouchtchev semblent être tombés d'accord lors de leur rencontre à Vienne en juin 1961.
Sans doute l'administration démocrate subit-elle un grave échec lorsqu'elle se révèle incapable de sauver les 2 000 réfugiés cubains qui ont tenté avec son approbation de renverser le régime de Fidel Castro (débarquement de la baie des Cochons, 17 avril 1961). Mais, sous l'impulsion de J. F. Kennedy, elle s'oppose à toute remise en cause de l'équilibre des forces mondiales, même lorsque Khrouchtchev brandit la menace nucléaire (reprise des expériences nucléaires soviétiques le 31 août 1961 et américaines en mai 1962).

C'est d'ailleurs dans cette atmosphère explosive que Kennedy réussit à maintenir le libre accès des Occidentaux à l'ancienne capitale allemande lorsque l'URSS décide d'autoriser l'Allemagne de l'Est à fermer ses frontières (13 août 1961) et à entreprendre presque aussitôt la construction du mur de Berlin.
Mais c'est un échec encore plus grave qu'il inflige à l'URSS en octobre 1962. Au terme de la crise marquée par l'installation à Cuba de bases soviétiques de missiles à tête nucléaire dirigées contre le territoire des États-Unis (juillet-octobre 1962), J. F. Kennedy réussit, en effet, à contraindre Khrouchtchev à retirer de l'île, le 28 octobre, ses armes de destruction massive.
Un second axe de la politique économique mondiale des États-Unis est la nécessité d'assurer à l'économie américaine les débouchés extérieurs qui seuls peuvent lui éviter le fléau de la surproduction et le chômage. Cette politique repose sur trois bases essentielles : l'aide à l'étranger, le développement des exportations commerciales et la multiplication des investissements à l'étranger, notamment vers les pays en voie de développement.
L'engagement au Viêt Nam
Cependant, l'antiaméricanisme s'amplifie dans le monde, se manifestant au Japon lors du renouvellement du traité de sécurité en 1960, s'étendant en même temps à l'Amérique latine (voyage très difficile du vice-président Richard Nixon en 1958), pour gagner finalement l'Europe, où des manifestations hostiles au vice-président Humphrey ponctuent son voyage en avril 1967. L'une des causes principales en est le Viêt Nam où les États-Unis entretiennent un nombre croissant de soldats.
Englués dans ce pays dans un conflit sur lequel l'opinion est très partagée, les États-Unis sont amenés à pratiquer un interventionnisme de plus en plus évident dans tous les pays d'Asie du Sud-Est (Thaïlande, Laos), afin de mieux juguler l'expansion de la Chine.
Contraints par là même à réduire leur engagement en Europe (fermeture de 160 bases militaires), incapable d'empêcher l'installation de l'URSS dans le Proche-Orient après la troisième guerre israélo-arabe de juin 1967, contestés dans leur leadership sur l'Alliance atlantique et le monde occidental, menacés de désintégration interne par le mécontentement croissant à l'encontre de la guerre du Viêt Nam et par la révolte noire, affaiblis, enfin, par le déficit de leur balance des paiements, les États-Unis, malgré leur exceptionnelle prospérité économique, sont aux prises avec de redoutables problèmes.
Le 31 mars 1968, le président Lyndon Baines Johnson annonce à la fois son renoncement à une nouvelle candidature et son désir d'entamer avec le Viêt Nam du Nord des pourparlers visant à une « désescalade » de la guerre. Des conversations préliminaires commencent effectivement à Paris, en mai.
La campagne présidentielle est marquée par l'affrontement, au sein du parti démocrate, d'Eugen McCarthy, de Robert Francis Kennedy et de H. H. Humphrey, et, au sein du parti républicain, par les candidatures de Richard Nixon et de Nelson Rockefeller. Mais l'assassinat de Robert Kennedy (6 juin 1968) bouleverse les données de l'élection présidentielle.
2. Les États-Unis depuis les années 1970 : crise, doute et renouveau de la puissance américaine
2.1. Les présidences de Richard Nixon (1968-1972, 1972-1974)

C'est finalement le républicain Richard Nixon qui l'emporte le 5 novembre 1968, mais avec à peine 500 000 voix de plus que le démocrate H. H. Humphrey sur 73 millions de votants. Les démocrates conservent cependant la majorité dans les deux Chambres du Congrès.
Poursuite de la « Grande Société » et début de crise économique

Le nouveau président est confronté au problème noir. Tout en s'opposant à l'agitation provoquée par les Black Panthers, il crée, en mars 1969, l'Office of Minority Business Enterprise, qui a pour but d'encourager l'activité commerciale des minorités. Face à la pauvreté d'une masse croissante d'Américains, il étend le programme d'aide alimentaire gratuit aux Américains les plus déshérités.
Mais cette politique est entravée par les difficultés économiques. Dès le début de sa présidence, Nixon doit lutter contre l'inflation. Il engage avec les travailleurs une épreuve de force pour éviter une crise inflationniste. Le chômage augmente en conséquence, passant de 5,5 % en septembre 1970 à 6,2 % en mai 1971. Pour y remédier, le président propose en 1971 un budget expansionniste, refuse à la fois un contrôle des prix et des salaires et le retour à tout protectionnisme (demandé par le Congrès) qui porterait atteinte au commerce international.
Vers le désengagement vietnamien

Le budget militaire nécessité par la guerre du Viêt Nam contribue à aggraver les difficultés économiques des États-Unis. Or, Nixon a été élu dans l'espoir qu'il mettrait rapidement fin à l'engagement américain. En mai 1969, il définit sa position, qui repose sur deux principes : le retrait mutuel des troupes étrangères engagées au Viêt Nam du Sud et l'autodétermination du peuple sud-vietnamien. Le président compte sur la « vietnamisation » du conflit, c'est-à-dire sur le renforcement de l'armée du Sud afin qu'elle assure seule la défense sur le terrain, avec l'aide stratégique de l'aviation américaine.
En mars 1972, une grande offensive des forces de Hanoi et du Front national de libération du Viêt Nam du Sud (FNL), qui infliget de graves défaites aux troupes sud-vietnamiennes, illustre l'échec de la vietnamisation prônée par Nixon. Celui-ci instaure alors une « ligne dure » (minage du port de Haiphong et blocus du Viêt Nam du Nord en mai).
Le président, à quelques mois des élections, doit cependant sortir de l'impasse. Il annonce le retrait de contingents supplémentaires et, par l'entremise de Henry Kissinger, son conseiller spécial pour la sécurité nationale, il reprend les pourparlers avec le Viêt Nam du Nord. L'accord sur le cessez-le-feu est près d'être signé en octobre 1972, mais, le 18 décembre, les raids de bombardements américains reprennent. Après une rupture des négociations et la suspension des attaques aériennes le 30 décembre, les discussions sont rouvertes le 8 janvier 1973 et aboutissent à un accord de cessez-le-feu signé à Paris le 27 janvier (conférence de Paris). Le 15 août 1973, les États-Unis interrompent leurs raids aériens sur le Cambodge.
La poursuite de la détente dans un monde multipolaire
L'élément le plus spectaculaire de la politique étrangère de Richard Nixon est le rapprochement avec la Chine. Le dialogue entre les deux pays est renoué à partir de février 1969. En décembre de la même année, le gouvernement américain relâche certaines mesures qui pesaient sur le commerce avec la République populaire de Chine depuis 1950. En mars 1971, le département d'État annonce la levée des restrictions sur les voyages des citoyens américains à destination de la Chine populaire. En août, le secrétaire d'État William Rogers annonce que les États-Unis ne s'opposeront pas à l'admission de la Chine à l'ONU. La rencontre au sommet Nixon-Mao Zedong a lieu à Pékin en février 1972.
Cette nouvelle orientation de la politique américaine a des répercussions sur les rapports que les États-Unis entretiennent avec d'autres puissances, et principalement avec l'URSS. Nixon se rend à Moscou en mai 1972 : un accord sur la coopération spatiale et un traité sur la coopération scientifique et technique y sont signés. Le voyage de Leonid Brejnev aux États-Unis (juin 1973) se conclut par un accord sur la prévention de la guerre nucléaire. En septembre 1974, les États-Unis et la RDA établissent des relations diplomatiques.
Le 15 mai 1972, après vingt-sept ans d'occupation américaine, Okinawa et les îles Ryukyu sont restituées au Japon, qui en réclamait la rétrocession depuis 1969. Mais un contentieux économique pèse encore sur les relations nippo-américaines, que l'entrevue entre l'empereur Hirohito et Nixon en Alaska, en 1971, n'a pas suffi à dissiper.
L'affaire du Watergate et la crise de la fonction présidentielle
À l'élection présidentielle du 7 novembre 1972, les républicains font réélire R. Nixon avec plus de 60 % des suffrages, contre le sénateur démocrate George McGovern. Cependant, le parti républicain reste minoritaire dans les deux Chambres et perd même encore deux sièges au Sénat.
Mais, en mai 1973, éclate le scandale du Watergate, où de hautes personnalités gouvernementales, touchant de près à la Maison-Blanche, sont mises en cause. De plus, en octobre 1973, le vice-président Spiro Agnew – sur lequel pèsent des charges de corruption et de trafic d'influence – est amené à démissionner. Il est remplacé par Gerald Ford, chef du groupe des républicains à la Chambre des représentants.

L'enquête sur le Watergate établit progressivement la responsabilité du président Nixon, qui démissionne (8 août 1974). Gerald Ford lui succède et nomme Nelson Rockefeller comme vice-président.
2.2. La présidence de Gerald Ford (1974-1977)

Ce ne sera qu'un simple intermède. Le nouveau président conserve, pour l'essentiel, les responsables politiques mis en place par Nixon, et notamment Henry Kissinger. Mais Gerald Ford est critiqué, sur sa droite, par tous ceux qui s'inquiètent d'une politique de coexistence avec l'Union soviétique, qu'ils estiment dangereuse (le Viêt Nam du Sud est tombé, en avril 1975, aux mains des communistes, le Cambodge passe sous l'autorité des Khmers rouges à la même date, et l'Angola est soutenu par les Soviétiques). Sur sa gauche, Gerald Ford subit les attaques de tous ceux qui lui reprochent d'avoir pardonné à l'ancien président Nixon, sans qu'un procès ait véritablement établi les responsabilités relatives au Watergate.
Et de nombreux Américains ne se résignent pas à accepter un président qui a été élu ni pour accéder à la magistrature suprême ni même pour devenir vice-président. Les élections législatives de 1974 ont été un triomphe pour les démocrates.
2.3. La présidence de Jimmy Carter (1977-1981)
Pourtant, si Ford est battu à l'élection présidentielle de 1976, ce n'est pas par une majorité écrasante : il a obtenu 48 % des suffrages populaires, soit 240 mandats au collège électoral. Son adversaire est un nouveau venu, Jimmy Carter, qui a fait campagne contre la corruption de Washington et en faveur d'un programme libéral. Carter a recueilli 50 % des suffrages populaires et 297 mandats au collège électoral. Sa victoire témoigne d'une nette volonté de changement. Néanmoins, sa présidence sera jugée comme un échec, et il verra sa cote de confiance baisser régulièrement à travers les sondages.
Les Américains sont de plus en plus nombreux à rejeter l'intervention fédérale dans le domaine économique et social, tout en souhaitant que leurs problèmes principaux soient réglés par Washington ou par les gouvernements d'États.
Les partis politiques eux-mêmes traversent une période de déclin. De plus, des associations à but unique (single-issue groups) font pression sur les candidats, dans des sens opposés, et suscitent plus d'enthousiasme que les partis traditionnels. Le Congrès se compose d'hommes politiques qui ne doivent rien, ou doivent peu, aux partis. Ils sont, eux aussi, élus grâce aux mass media. Et, à ce titre, ils ne se sentent pas liés par leur affiliation à tel ou tel parti, fût-il celui du président. En conséquence, les relations entre l'exécutif et le législatif sont marquées par d'interminables luttes, et le programme législatif du président en sort défiguré, si ce n'est annihilé.
Succès et limites de la politique extérieure de J. Carter
Toutefois, sur le plan de la politique étrangère, Carter remporte quelques succès. Il tiendra sa promesse : sous sa présidence, aucun soldat américain ne sera engagé dans une guerre. Il parvient à signer, avec le président égyptien Anouar el-Sadate et le Premier ministre israélien Menahem Begin, les accords de Camp David (septembre 1978). Mais il ne peut attirer dans la négociation les autres pays arabes.
D'autre part, la politique de détente qu'il préconise ne donne pas des résultats convaincants, et son désir affirmé de défendre les droits de l'homme partout dans le monde n'a guère d'effets.
Certes, Carter mène à bien la négociation avec l'URSS sur la limitation des armements stratégiques, et signe en 1979 l'accord SALT II. Mais, à la suite de l'intervention soviétique en Afghanistan (décembre 1979), cet accord ne sera pas présenté pour ratification devant le Congrès. Enfin, l'affaire de la prise d'otages à Téhéran dans l'ambassade des États-Unis (4 novembre 1979) souligne les faiblesses de la politique du président.
La détérioration de la situation économique
Sur le plan de la politique intérieure, au début de 1980, Carter propose un véritable plan de lutte contre l'inflation, mais une majorité au Congrès s'y oppose. Il ne peut davantage tenir sa promesse de procéder à une réforme fiscale, de réajuster le salaire minimum ou de diminuer le déficit budgétaire. L'inflation persiste et le taux de chômage reste particulièrement inquiétant (aux environs de 7,7 %). Ce sont les Noirs, les jeunes, les femmes, les ouvriers peu qualifiés qui sont touchés les premiers. L'industrie automobile subit les assauts de la concurrence japonaise et européenne, et pâtit de la volonté d'économiser l'essence et de la réduction des revenus disponibles.
Cependant, Carter ne connaît pas que des échecs. Il inaugure une politique de restrictions dans la consommation de pétrole, énonce des propositions dans le domaine de l'environnement et favorise une réforme des tarifs routiers et ferroviaires.
Attaqué de toutes parts, lâché par bon nombre des membres de son parti, le président Carter échoue aux élections de novembre 1980, face au républicain Ronald Wilson Reagan. Il obtient 41 % des voix populaires et seulement 49 mandats de grands électeurs. Son adversaire est élu avec 51 % des voix populaires et 489 mandats de grands électeurs. Bien plus, les républicains ont la majorité au Sénat et améliorent notablement leurs positions.
3. Les présidences de Ronald Reagan (1981-1985, 1985-1989)
L'élection de l'ancien gouverneur de Californie confirme le rejet par les classes moyennes du projet de « Grande Société » repris par les successeurs de L. B. Johnson et le déplacement du centre de gravité du pays vers les « terres d'espace et de liberté », hostiles aux pouvoirs du gouvernement fédéral.
Quatre ans plus tard, dans un climat de croissance et de leadership retrouvés, le président sortant est réélu avec près de 60 % des suffrages et 16,8 millions de voix d'avance sur son adversaire démocrate, Walter Mondale. Preuve que ce triomphe est moins la victoire d'un parti que le succès d'un homme et de sa politique, les démocrates dominent toujours la Chambre des représentants, les républicains conservant le Sénat.
3.1. Une nouvelle orientation économique
Quand Ronald Reagan arrive au pouvoir, l'économie américaine s'enlise dans la stagflation : l'inflation dépasse 10 %, le revenu national s'essouffle, la productivité fait du sur-place, le chômage augmente. Son programme économique prend le contre-pied des politiques précédentes d'inspiration keynésienne (soutien à la consommation par une redistribution des revenus) ; il donne résolument la priorité à la production et aux entreprises, privilégiant les initiatives individuelles.
Partant de l'idée que la place de l'État et le poids des impôts freinent l'activité des entrepreneurs, il prévoit d'alléger sensiblement la pression fiscale et de réduire les dépenses publiques (coupes claires dans les programmes sociaux). L'administration entend par ailleurs démanteler une bonne partie des réglementations jugées trop contraignantes pour les entreprises – quitte à engager un bras de fer avec les syndicats (licenciement des 13 000 contrôleurs aériens en grève à l'été 1981) – dans le but de créer un environnement favorable à la création de richesses.
Mais la rupture avec le passé tient d'abord dans l'état d'esprit et le discours de la nouvelle équipe au pouvoir. Reagan l'assure, lors de son investiture, le 20 janvier 1981 : « le gouvernement n'est pas la solution aux problèmes. Le gouvernement est le problème. » Mais ce tournant libéral avait été déjà pris par Carter, qui avait nommé un monétariste, ferme partisan de la lutte contre l'inflation, Paul Volcker, à la Réserve fédérale, et commencé à déréglementer (transport aérien).
En outre, Reagan se garde de toucher aux retraites, aux pensions, à la sécurité sociale. Surtout, son action s'apparente à un keynésianisme déguisé : par le biais des programmes de défense, l'économie bénéficie d'une injection massive d'argent fédéral, et le déficit budgétaire, considérablement accru par les dépenses militaires (jusqu'à un tiers du budget), stimule l'activité.
3.2. Une croissance artificielle
Les premiers résultats sont décourageants : certes, la hausse des prix se ralentit (6,3 % en 1982), mais la production industrielle recule, comme le PNB (−2,1 % en 1982), et le chômage grimpe à 10 %, son plus fort taux depuis la Grande Dépression. Dès 1983, la reprise s'amorce cependant : l'inflation est maîtrisée à 3,8 %, le chômage diminue, le PNB augmente de 3,7 %. De 1983 à 1989, le pays connaît une phase de croissance continue (+3,5 % par an), inédite depuis 1945, qui crée 17 millions d'emplois (5,7 % de chômage en 1988).
Bien réelle, cette reprise repose néanmoins sur le financement étranger. Chaque année (sauf en 1987), le déficit budgétaire se creuse davantage ; il atteint 250 milliards de dollars en 1988. Afin de le financer sans recourir à une création monétaire de type inflationniste, il a fallu attirer les capitaux par des taux d'intérêt élevés, d'où un dollar longtemps fort qui pénalise les exportations, favorise les importations et aggrave le déficit de la balance commerciale (plus de 170 milliards en 1987 contre 40 en 1981) ; l'Amérique vit au-dessus de ses moyens – elle est d'ailleurs devenue débitrice en 1985.
Face à la concurrence et aux nécessaires restructurations, de nombreux secteurs déclinent : métallurgie, électronique grand public, textile sombrent, l'automobile est menacée. Cependant, haute technologie et services entraînent l'économie et créent les nouveaux emplois, souvent précaires. La productivité repart, mais à un rythme faible (+1,6 % par an) : la rentabilité financière impose son empire sur les stratégies industrielles de plus long terme. Avec un corollaire, la spéculation : les années 1980 constituent une période faste pour les « raiders », aventuriers des marchés qui réorganisent des secteurs entiers à grands coups d'OPA ; la Bourse s'envole jusqu'au krach d'octobre 1987, symbole de l'artificialité de la croissance et des excès de la déréglementation.
3.3. Confiance retrouvée ou société à deux vitesses ?
Les écarts sociaux se creusent : les 20 % d'Américains les plus riches voient leurs revenus augmenter de 40 %, les 20 % les plus pauvres les voient baisser de 10 %. 15 % de la population ne bénéficie d'aucune couverture sociale. La drogue et l'illettrisme constituent des fléaux contre lesquels Reagan ne s'engage que timidement. Pourtant, le président bénéficie d'une cote de popularité élevée. Grand communicateur, il a restauré auprès des classes moyennes la fonction présidentielle, les valeurs traditionnelles, la confiance en l'avenir du pays.
3.4. La politique extérieure : des tensions avec l'URSS à un nouveau dégel
L'Initiative de défense stratégique ou « guerre des étoiles »
Au début de la décennie, les États-Unis doutent de leur puissance, après l'affront iranien (affaire des otages, en 1979), avec le maintien de la présence castriste à 150 km de la Floride et la prise du pouvoir par les sandinistes au Nicaragua. L'URSS apparaît conquérante : elle vient d'envahir l'Afghanistan et ne tarde pas à imposer la loi martiale à la Pologne (fin 1981).
Face à ces menaces, Reagan estime qu'il importe de « réarmer avant de parlementer » : il renforce l'arsenal nucléaire et conventionnel, fait installer des missiles à moyenne portée (Pershing) en Europe, puis lance un programme de bouclier spatial antibalistique, l'Initiative de défense stratégique, dite « guerre des étoiles » (1983).
Il rappelle que l'URSS reste l'« Empire du mal », exalte les sentiments nationalistes de ses compatriotes et leur demande de croire en leur force, morale et matérielle. Après des années marquées par la défaite au Viêt Nam et les effets du Watergate, ce message passe et Reagan fait figure de champion de la guerre froide. Dans les faits, il agit avec plus de prudence.
La CIA fournit des armes aux Afghans, aide les contras antisandinistes du Nicaragua et l'Unita angolaise, soutient les régimes du Salvador et du Chili. Les États-Unis multiplient les avances à la Chine, qui dénonce le « social-impérialisme » de l'URSS. En 1983, l'occupation éclair de la Grenade anéantit une menace cubaine naissante et fournit une preuve facile de l'efficacité retrouvée des militaires et de la détermination du président.
Échec au Moyen-Orient
L'activité diplomatique de Reagan ne se limite pas à la lutte contre l'influence de l'URSS. Au Moyen-Orient, les États-Unis cherchent à résoudre le conflit israélo-arabe, sans grand succès. La guerre du Liban complique la situation : 1 200 marines sont envoyés à Beyrouth en 1982 dans le cadre d'une mission de l'ONU en faveur de la paix, qui se solde par un repli précipité à la suite d'un attentat qui a coûté la vie à 241 hommes, en octobre 1983. En représailles d'actes terroristes, un raid aérien est mené sur Tripoli en janvier 1986.
La même année, le Congrès vote des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud et Reagan finit par faire pression pour que Pretoria mette un terme à l'apartheid.
Détente avec l'Union soviétique
L'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev en 1985 est ressentie comme un tournant. De plus, les États-Unis sont désormais en position de force pour négocier la réduction des armements stratégiques. Un sommet Reagan-Gorbatchev se tient à Genève, suivi d'une rencontre en 1986 à Reykjavík, qui aboutit à un traité d'élimination des forces de courte et moyenne portée, signé à Washington en 1987. En 1988, Gorbatchev annonce le retrait des troupes soviétiques de l'Afghanistan. Leur départ de l'Angola est négocié contre l'indépendance de la Namibie, jusqu'alors colonie sud-africaine.
L'Irangate
En 1984 et 1986, le Congrès a suspendu toute aide en faveur des contras du Nicaragua, mais, à la fin de 1986, l'opinion apprend que des ventes secrètes d'armes à l'Iran (en principe sous embargo) ont servi à financer leur guérilla. L'Irangate constitue le plus grand scandale politique survenu aux États-Unis dans les années 1980. Le blason du président en est terni.
Pourtant, à son départ de la Maison-Blanche, en janvier 1989, Ronald Reagan est populaire : il passe pour avoir redonné la prospérité à son pays, même si les circonstances et le déclin de l'URSS l'ont servi.
4. La présidence de George H. W. Bush (1989-1993)

En 1988, le vice-président George H. W. Bush est élu avec 54 % des voix contre son rival démocrate Michael Dukakis. C'est la première fois depuis 1948 qu'un même parti gagne trois fois de suite la course à la Maison-Blanche. Mais les démocrates détiennent la majorité dans les deux Chambres.
4.1. La fin de la guerre froise
George H. W. Bush assiste à l'effondrement de l'empire soviétique en Europe : chute du mur de Berlin (1989), dissolution du pacte de Varsovie (1990), éclatement de l'URSS (1991) ; il entérine la fin de la guerre froide en signant le traité de réunification de l'Allemagne ainsi que les accords sur la réduction des armements stratégiques (START I et II, en 1991 et 1993).
Les États-Unis, désormais seule superpuissance de la planète, sont promus « gendarmes du monde », et agissent avec succès en faveur de la démocratie dans le monde, de la libéralisation du commerce et du respect du droit international.
4.2. Les progrès de la démocratie et du commerce
L'Afrique du Sud voit la disparition progressive de l'apartheid. À la fin de 1989, une intervention militaire américaine au Panamá, la première d'envergure depuis le Viêt Nam, chasse le général Noriega. Au Nicaragua, à la suite du cessez-le-feu entre les contras et le pouvoir sandiniste, Violeta Chamorro est élue à la présidence de la République (1990). Cependant, malgré les progrès de la démocratie, bien des régimes latino-américains restent menacés par la guérilla, la corruption ou les trafics de drogue.
En 1989, le président marque sa réprobation face à la répression chinoise, mais la modère vite. Les relations commerciales se tendent avec le Japon (à la suite notamment de l'achat par des Japonais de Columbia Pictures et du Rockefeller Center), mais George H. W. Bush résiste à la tentation du protectionnisme, sans toutefois parvenir à ouvrir le marché nippon. L'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Canada, entré en vigueur le 1er janvier 1989, s'élargit au Mexique en 1992 (ALENA), et l'Initiative pour les Amériques vise à créer à terme un grand marché de l'Alaska à la Terre de Feu.
4.3. La guerre du Golfe
L'invasion du Koweït par l'Iraq, le 2 août 1990, surprend l'administration américaine qui a soutenu Saddam Husayn face à l'Iran. George H. W. Bush obtient la condamnation de l'Iraq par l'ONU et s'assure la neutralité bienveillante de l'URSS. Sans renoncer à des solutions négociées, il réunit une coalition de vingt-sept pays, dont les alliés français, britanniques, la plupart des pays arabes. L'opération Desert Storm (« Tempête du désert ») commence le 15 janvier 1991 ; un corps expéditionnaire de 500 000 hommes remporte la victoire en cinq semaines, mais sans faire tomber Saddam Husayn.
Pour pacifier la région, les États-Unis s'emploient à résoudre la question israélo-arabe. Ils obtiennent que s'ouvrent une conférence de paix sur le Proche-Orient (à Madrid, le 30 octobre 1991) ainsi que des négociations bilatérales israélo-palestiniennes.
4.4. Action humanitaire et environnement
George H. W. Bush érige en principe l'ingérence humanitaire en plaçant hors du contrôle de Bagdad les Kurdes d'Iraq persécutés par Saddam Husayn et lance à la fin de 1992 l'opération Restore Hope (« Restaurer l'espoir »), destinée à garantir l'acheminement de l'aide à la Somalie.
Contrairement à son prédécesseur, le président s'est impliqué dans les questions d'environnement, à l'intérieur comme à l'extérieur : interdiction des gaz responsables de la destruction de la couche d'ozone (1989), gel pour cinquante ans de l'exploitation de l'Antarctique (1991) ; mais il refuse d'engager son pays dans la lutte contre les gaz à effet de serre au Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992.
4.5. Crise et tensions intérieures
Héritier de la prospérité reaganienne et auréolé par la victoire sur l'Iraq, le président ne voit pas les problèmes intérieurs s'accumuler et la crise poindre à partir de 1990.
Durant son mandat, la croissance stagne, le chômage remonte à 7,5 %, le déficit budgétaire explose (plus de 300 milliards en 1992) et contraint à lever (en 1990) de nouveaux impôts, fort impopulaires. La récession exacerbe les tensions sociales et raciales, aggravées pendant les années 1980 mais contenues jusque-là par la croissance. Les villes et les États, sur lesquels le gouvernement fédéral s'est déchargé de la lutte contre la pauvreté, connaissent de graves difficultés budgétaires ; l'insécurité règne. En 1990, des émeutes raciales dans les quartiers noirs ou hispaniques de Washington et Miami annoncent celles de South Central à Los Angeles, en 1992, les plus graves depuis celles de Watts, dans la même ville, en 1965 (60 morts et 2 000 blessés).
Dans ce contexte, l'élection présidentielle de novembre 1992 mobilise l'électorat (55 % de participation). L'opinion reproche à George H. W. Bush d'avoir privilégié les questions internationales aux dépens du règlement des problèmes économiques et sociaux du pays. Aussi Bill Clinton, peu connu du public jusqu'à la convention démocrate de l'été, devance-t-il avec 43 % des suffrages le président sortant (38 %) et l'indépendant Ross Perot (19 %). Les démocrates conservent la majorité dans une Chambre des représentants et un Sénat rajeunis et renouvelés par l'arrivée d'un plus grand nombre de femmes et d'élus issus de minorités.
5. Les présidences de Bill Clinton (1993-1997, 1997-2001)
5.1. Des débuts incertains
La nouvelle administration adopte un plan de relance tout en cherchant à contenir les déficits (augmentation des taxes, baisse des dépenses militaires et réduction du nombre des fonctionnaires). Elle s'attaque à la violence urbaine et fait passer la « loi Brady » qui contrôle la vente d'armes ; mais ses relations avec le Congrès sont difficiles, et le grand projet de réforme du système de santé présenté par Hillary Clinton, la femme du président, s'enlise, pour finir torpillé par les lobbys. Cet échec contribue à l'impopularité du président et pèse sur les partielles de novembre 1994, à l'issue desquelles le parti républicain contrôle les deux Chambres, ce qui n'était pas arrivé depuis 1952.
5.2. Les excès du « Contrat pour l'Amérique »
La majorité républicaine du nouveau Congrès se méprend sur la nature du raz de marée qui l'a portée au pouvoir et ambitionne de réaliser point par point son programme de révolution conservatrice (dit « Contrat pour l'Amérique »). Très vite, elle se heurte à ses contradictions internes ainsi qu'à l'habileté politicienne de Bill Clinton, qui retrouve la faveur de l'opinion.
Si, amené à faire des concessions, il signe, en août 1996, la loi restrictive sur la réforme de l'aide sociale préparée par les républicains, il fait porter sur leur intransigeance la responsabilité de la fermeture des administrations fédérales durant l'hiver 1995-1996. Reprenant certaines de leurs idées (équilibre du budget, mais avec un calendrier plus long et des mesures moins brutales), il se pose en rempart contre leurs excès dogmatiques.
5.3. Des années de croissance
Attendue, la victoire de Bill Clinton à l'élection présidentielle de novembre 1996 est mitigée : historique, car il n'est que le troisième président démocrate à être réélu, mais décevante, car il n'a obtenu que 49,9 % des voix, contre 41,4 % au républicain Robert Dole et 8,6 % à Ross Perot. Surtout, les deux Chambres du Congrès demeurent républicaines.
Clinton associe pourtant son nom à des années de croissance : une moyenne de 4 % par an depuis 1993 ; 22 millions d'emplois créés qui, malgré les dégraissages massifs des grandes entreprises, sont loin d'être tous précaires ; un taux de chômage en conséquence descendu en-deçà de 4 % à son départ de la Maison-Blanche, en janvier 2001 ; des gains de productivité de 3 % l'an ; une industrie redevenue très compétitive et conquérante, dominante même dans le secteur des nouvelles technologies ; une inflation maîtrisée, un budget équilibré en 1997 et même fortement excédentaire à partir de 1998.
Reste que les inégalités sont loin d'avoir régressé : les trois millions d'Américains les plus riches possèdent autant que les cent millions les plus pauvres ; les ghettos demeurent et leurs populations sont parmi les premières victimes du retournement de conjoncture ; les quelques filets d'aides sociales mis en place précédemment par l'État providence se sont relâchés.
5.4. Désordre mondial et diplomatie du négoce
Alternant d'abord hésitations ou reculades (retrait américain de Somalie en 1994) et attitudes de fermeté (contrôle des politiques d'armement de la Corée du Nord et de l'Iraq, intervention et restauration de la démocratie en Haïti en 1994), l'action extérieure de Clinton cherche à maintenir les États-Unis dans leur rôle de garants des grands équilibres internationaux :
– soutien à la Russie de Boris Ieltsine en 1996,
– promotion de la non-prolifération nucléaire et chimique,
– mise en route du processus d'élargissement de l'OTAN à trois pays d'Europe de l'Est en 1997.
La diplomatie américaine s'investit aussi dans le règlement des conflits régionaux :
– rencontre historique Rabin-Arafat à la Maison-Blanche en septembre 1993, lors de la signature de l'accord de Washington,
– intervention en Bosnie-Herzégovine et paix de Dayton en 1995,
– pourparlers sur l'Irlande du Nord en 1996 et accords de Stormont en 1998.
Cette politique s'appuie sur deux impératifs, limiter les actions directes et former au cas par cas des coalitions ponctuelles d'États ou d'institutions :
– intervention à Haïti en 1994 (avec l'ONU),
– frappes aériennes contre les Serbes de Bosnie en 1995 (avec l'OTAN),
– sauvetage du peso mexicain en 1995 (avec des banques privées),
– aide économique aux pays d'Asie en 1997 (avec le FMI),
–frappes contre l'Iraq en 1998 (avec les Britanniques),
– bombardement de la Serbie pour mettre fin à la politique répressive de Slobodan Milošević au Kosovo en 1999 (avec l'OTAN).
Mais si les questions politiques dominent toujours dans les relations avec certains pays comme les « États félons » (Cuba, Iraq et, dans une moindre mesure, Iran), l'administration Clinton donne plus que jamais la priorité aux intérêts économiques dans la définition de ses grandes orientations diplomatiques. La prospection des marchés émergents (Chine, Argentine) et la constitution de blocs commerciaux régionaux (en 1993, ratification de l'ALENA par le Congrès et relance de la communauté Asie-Pacifique, ou APEC) s'accompagnent de pressions sur les partenaires traditionnels (Japon, Union européenne) pour qu'ils acceptent les conceptions américaines sur la libéralisation des échanges : déblocage des négociations du GATT fin 1993, mise en place de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995, proposition d'Accord multilatéral sur l'investissement.
5.5. Une fin de mandat en demi-teinte pour un président affaibli
En septembre 1998 l'affaire Monica Lewinsky fait de Bill Clinton le deuxième président du pays à devoir affronter une procédure d'impeachment ouverte au Congrès. Les élections de midterm voient les démocrates progresser au Congrès, qui demeure toutefois à majorité républicaine ; ils gagnent en outre un État. Comme Ronald Reagan, le « Président Teflon » qu'aucun scandale n'affecte, B. Clinton apparaît comme un « Comeback Kid », qui rebondit toujours. En février 1999, le Sénat l'acquitte et met fin à la procédure.
Son action diplomatique s'essouffle : pour riposter aux attentats contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, en 1998, il fait bombarder le Soudan et l'Afghanistan, puis, au début 1999, l'Iraq. S'il implique l'OTAN en Serbie (mars-juin 1999) et facilite le déblocage de la situation en Irlande du Nord (novembre 1999), il ne condamne pas l'offensive russe contre la Tchétchénie à partir d'août 1999 et ne peut relancer le processus de paix israélo-palestinien (négociations de Wye Plantation en octobre 1998, de Charm el-Cheikh en septembre 1999) : l'échec des ultimes pourparlers entre Ehoud Barak et Yasser Arafat, à la fin de l'été 2000, exacerbe les tensions (reprise de l'Intifada) et réduit les espoirs nés des accords de Washington en 1993, à son arrivée au pouvoir.
L'impression d'unilatéralisme et d'hésitation que donne la superpuissance américaine irrite ailleurs dans le monde (ainsi du rejet du traité d'interdiction des essais nucléaires en octobre 1999 par le Sénat républicain, contre l'avis de l'administration). Le rôle moteur qu'elle exerce dans la mondialisation (normalisation des relations avec la Chine conclue en 1999 et ratifiée par le Congrès en 2000) suscite l'opposition de nombre d'ONG et de PVD, qui font échouer la conférence de l'OMC à Seattle fin 1999.
Les Américains savent gré à B. Clinton d'avoir présidé à de longues années de croissance et d'innovation sans trop rogner sur les modestes filets de sécurité sociale du pays ; mais les affaires qui l'ont entouré suscitent auprès d'une opinion publique qui lui reproche de n'avoir pas donné la pleine mesure de ses talents une lassitude qualifiée de « Clinton fatigue ». C'est cet héritage contrasté que doit endosser Al Gore, vice-président depuis 1993 et candidat à la présidence.
6. Les présidences de George W. Bush (2001-2005, 2005-2009)
6.1. Une campagne et une élection incertaines
À l'ouverture des primaires républicaines, le prétendant George Walker Bush, gouverneur du Texas et fils de l'ancien président George H. W. Bush, dispose d'un trésor de guerre qui vient à bout des autres postulants de son camp, notamment John McCain, sénateur de l'Arizona.
Chez les démocrates aussi, Bill Bradley conteste un temps l'investiture au vice-président sortant, Al Gore.
Le débat politique est atone, sauf sur des questions de société (avortement, prière à l'école, vente des armes à feu) et sur l'affectation du surplus budgétaire (baisse des impôts pour les républicains, remboursement de la dette et amélioration du système éducatif et social pour les démocrates). George W. Bush ne convainc pas. Al Gore non plus. En fait, c'est la campagne d'Hillary Clinton dans l'élection sénatoriale du New York qui passionne l'opinion : c'est la première fois qu'une épouse de président sollicite un mandat électif.
Le résultat des urnes traduit le désintérêt des électeurs. L'élection du 7 novembre 2000 est très serrée. Et disputée : avec 48,4 % des suffrages, Al Gore obtient 600 000 de voix de plus que son adversaire (47,9 %), mais les résultats de la Floride, État pivot, sont contestés. Pour savoir à qui iront ses vingt-cinq grands électeurs, on recompte les bulletins. À la mi-décembre, la Cour suprême suspend et invalide la vérification manuelle des suffrages accordant l'État au candidat républicain. G. W. Bush remporte alors la majorité du collège électoral et Al Gore reconnaît la victoire de son adversaire.
6.2. Les débuts difficiles d'un « président accidentel »
Les premières mesures prises par la nouvelle administration s'avèrent plus conservatrices que ne l'avaient laissé entendre discours et programmes. Le nouveau président fait des concessions à la droite chrétienne, qui l'a soutenu pendant la campagne, en prenant soin de ne pas effrayer les milieux d'affaires en matière d'environnement, ou pour ce qui est des accidents du travail. Ainsi la promotion des groupes religieux dans nombre de programmes sociaux, ou le refus de tout soutien fédéral aux organisations internationales favorisant l'avortement s'accompagnent-ils, entre autres, du rejet du protocole de Kyoto sur la réduction de l'émission des gaz à effet de serre et de l'éventualité d'une exploitation de gisements énergétiques en Alaska.
Pour ce faire, le président s'entoure d'une équipe de fidèles et d'anciens, souvent proches de Dick Cheney et piliers des précédentes administrations républicaines. Il appelle à lui et promeut en particulier les Afro-Américains Colin Powell (au secrétariat d'État) et Condoleezza Rice (à l'influent Conseil de sécurité nationale). Il s'appuie également sur un Congrès resté républicain : à la Chambre, il dispose d'une majorité de 220 représentants (contre 210 aux démocrates), mais le Sénat, partagé entre républicains et démocrates, voit bientôt son équilibre basculer : un républicain, James Jefford représentant du Vermont, rejoint par protestation le camp adverse, donnant à celui-ci le contrôle du Sénat (mai).
Autre geste significatif : le pilonnage, à la mi-février 2001, des installations de défense antiaériennes irakiennes. Les relations avec l'ONU se détériorent : les États-Unis sont exclus de la Commission des droits de l'homme. Ils remettent en cause le traité ABM signé en 1972 avec l'URSS (officiellement dénoncé en décembre 2001), en même temps qu'ils annoncent leur engagement dans un vaste programme de défense antimissile : la Chine et la Russie s'inquiètent d'une reprise de la course aux armements. Le bouclier devra protéger le pays des « États voyous ». Mais les responsables politiques sous-estiment les autres menaces, terroristes notamment.
6.3. Le 11 septembre 2001 et ses suites : les États-Unis en guerre
Le 11 septembre 2001, une vague d'attentats frappe les États-Unis : deux avions détournés par des membres de l'organisation al-Qaida dirigée par Oussama Ben Laden s'encastrent dans les tours jumelles du World Trade Center à New York, provoquant leur effondrement et des milliers de victimes. Au même moment, un avion s'écrase sur une aile du Pentagone à Washington et un quatrième s'abîme en Pennsylvanie, sans avoir atteint son but.
Face à ces attaques terroristes d'un genre inédit, les États-Unis, soutenus par l'opinion internationale occidentale, la Russie et la Chine, et après s'être conciliés la plupart des pays arabes, décident de poursuivre leurs auteurs présumés dans leurs bases afghanes, aux mains des talibans. De la fin octobre à décembre, l'opération « Liberté immuable » met fin au régime taliban, mais la traque des commanditaires des attaques du 11 septembre se poursuit, cependant que régulièrement les menaces d'une attaque terroriste affolent les États-Unis.
G. W. Bush se mue en président d'un pays en guerre. Sa popularité s'envole. Du moins aux États-Unis. Ailleurs dans le monde, son action provoque des remous. La vague de solidarité dont ont bénéficié les Américains le 11 septembre ne résiste guère aux mesures de protectionnisme prises fin 2001-2002. En janvier 2002, l'Iraq, l'Iran et la Corée du Nord sont stigmatisés en tant que parties prenantes d'un « axe du Mal armé pour menacer la paix du monde ». Cette politique de fermeté rassure les Américains. En novembre 2002, les républicains remportent les élections de midterm, scrutin pourtant généralement défavorable au parti de l'administration en place : la légitimité électorale d'un président qui n'a pas ménagé ses efforts pendant la campagne est désormais assise.
En mars 2003, G. W. Bush déclenche, avec l'appui de Tony Blair, mais sans l'accord de l'ONU et malgré les fortes réticences émanant de la communauté internationale, tout particulièrement de la France, de la Russie et de la Chine, l'opération « Liberté de l'Iraq ». Saddam Husayn est accusé de possession d'armes de destruction massive et d'accointance avec les groupes terroristes. Le régime baassiste tombe en quelques semaines. Dès le mois de mai cependant, il apparaît que l'armée anglo-américaine ne fait pas figure de force libératrice aux yeux des populations locales et ses membres deviennent la cible d'attaques ponctuelles. Les pertes militaires s'accélèrent à partir de septembre 2003, pour dépasser les cinq cents au début 2004 et atteindre le millier à l'été.
Malgré l'arrestation spectaculaire de l'ancien dictateur en décembre 2003 et alors que s'engage la campagne pour les élections présidentielles, les Américains se mettent à douter du bien-fondé de l'intervention de leur pays. En janvier 2004, le rapport Kay atteste l'absence d'armes de destruction massive en Iraq ; en mai, la révélation de sévices et de tortures infligés à des détenus irakiens placés sous la surveillance des troupes suscite l'indignation ; en juin, une commission sénatoriale conclut à l'absence de tout lien entre l'Iraq du raïs et al-Qaida.
L'opinion publique envisage l'hypothèse d'une manipulation par l'administration – dont le discours martial ne change pas – et s'interroge à nouveau sur la crédibilité et l'autorité de G. W. Bush. Si elle continue à suivre le « président de guerre », elle ne comprend plus vraiment les raisons du conflit et demande des explications. Celles-ci ne viennent pas et la polémique retombe, sans avoir jamais vraiment profité au candidat démocrate John F. Kerry : le débat électoral tourne davantage autour de l'état de l'économie et de questions de société.
6.4. Les aléas de l'activité économique et de la conjoncture politique
En 2001, G. W. Bush hérite d'une situation économique assombrie. Le ralentissement se mue en récession, du fait notamment de la chute de la Bourse et de l'explosion des bulles spéculatives du marché des valeurs technologiques (Nasdaq). Le plan de réductions d'impôts est destiné à relancer la consommation, mais son effet n'a rien d'immédiat et la crise s'installe. L'année 2002 voit cependant la croissance repartir et atteindre 3 % en 2003. Mais elle ne crée guère d'emplois et ne résorbe pas un chômage qui culmine alors à 6 % de la population active (2,7 millions d'emplois perdus en 3 ans).
En outre, la reconduction et l'extension des dégrèvements fiscaux ainsi que l'augmentation faramineuse des dépenses militaires alimentent un trou budgétaire de plus de 400 milliards de dollars. Ajouté au déficit commercial abyssal (6 % du PIB) et à l'endettement des ménages et entreprises, il obère la solidité de la reprise. Pour répondre aux doutes croissants de la population et parer les attaques des démocrates rassemblés autour de la candidature du sénateur J. F. Kerry, le président entre plus tôt que prévu dans la campagne électorale 2004. La reconduction du ticket Bush-Cheney ne paraît plus en effet automatique.
Toutefois, au cours de l'année 2004, la conjoncture s'éclaircit. Dopée par une politique de « keynésianisme militaire », l'augmentation des revenus des ménages (impact des réductions fiscales) et des taux d'intérêt très bas, qui poussent à la consommation par l'endettement, la croissance est forte (4,4 %). En un an, l'économie crée près d'1,8 million de postes, réduisant d'autant le solde négatif en emplois du mandat de G. W. Bush (800 000). Les « déficits jumeaux » s'aggravent, les inégalités s'accroissent, la baisse du dollar et la hausse des cours du pétrole constituent autant de menaces à terme pour la croissance, mais l'opinion publique n'en a cure.
Elle se passionne davantage pour les questions de société, autour desquelles la campagne électorale se concentre : ainsi des débats sur le droit à l'avortement ou encore le mariage homosexuel. L'élection présidentielle du 2 novembre voit en définitive s'affronter deux Amériques : l'Amérique dite libérale ou progressiste (grosso modo celle des deux côtes), qui apporte ses voix à J. F. Kerry, et l'Amérique conservatrice (le cœur du pays), qui soutient le président sortant. Au final, c'est cette dernière qui l'emporte, par 51 % des suffrages (62 millions) contre 48 (59 millions).
6.5. Un second mandat : de la nouvelle donne politique à Canossa ?
G. W. Bush entend « dépenser » le capital politique que sa réélection lui apporte. Il remanie son cabinet et nomme de proches conseillers : ainsi Condoleezza Rice remplace-t-elle Colin Powell au secrétariat d'État, et Alberto Gonzales, John Ashcroft à la Justice. En revanche – gage de continuité en matière militaire et économique, – Donald Rumsfeld reste à la Défense, tout comme John Snow au Trésor.
Dans son discours sur l'État de l'Union (février 2005), le président réaffirme son souhait à la fois de continuer la lutte contre le terrorisme, de maintenir les troupes en Iraq, et, sur le plan intérieur, de poursuivre la politique de réductions fiscales, qu'il entend même pérenniser. Il annonce qu'il compte également privatiser le système de sécurité sociale du pays. L'objectif est de satisfaire la droite chrétienne qui a soutenu le ticket présidentiel et d'établir une nouvelle donne politique, durablement favorable aux conservateurs.
Mais ces projets s'enlisent : la réforme des retraites se heurte à l'opposition de l'opinion publique, du Congrès, et même de membres d'un parti républicain de plus en plus divisé entre radicaux et modérés. Si G. W. Bush parvient à nommer John Roberts à la tête de la Cour suprême à l'été 2005, il doit renoncer à y faire entrer à l'automne l'une de ses conseillères juridiques, Harriet Miers, jugée trop modérée par les chrétiens de droite. Nombre de leaders du Grand Old Party sont par ailleurs éclaboussés par une série de scandales, qui affaiblissent un peu plus le crédit du président.
Des révélations (affaire Wilson-Plame, qui conduit à la démission du directeur de cabinet de D. Cheney, Lewis Libby, en octobre 2005 ; prisons secrètes de la CIA ; écoutes téléphoniques de la NSA [National Security Agency] ; torture à Guantánamo) ébranlent ensuite la tête d'un exécutif, suspecté d'abus de pouvoir, qui peine à obtenir la reconduction du Patriot Act et dégringole dans les sondages. Aux yeux des ménages américains, la croissance réelle de l'économie est éclipsée par le creusement des déficits, l'accroissement des inégalités et l'envolée des cours du pétrole.
Enfin, les ravages du cyclone Katrina qui s'abat à la fin d'août 2005 sur le golfe du Mexique et La Nouvelle-Orléans en particulier révèlent à nouveau douloureusement la vulnérabilité de l'Amérique et témoignent cruellement d'une absence de leadership, qui écorne davantage encore l'aura d'un président désormais livré à son impuissance.
L'impopularité croissante du président suscite des velléités d'indépendance au sein même de sa majorité au Congrès. Contre l'avis de ce dernier, elle vote à la fin de 2005 une loi sur le traitement des « ennemis combattants » détenus à Guantánamo et, à l'initiative du sénateur John McCain, interdit l'usage de la torture – sans pour autant garantir à ces derniers les droits fondamentaux. Puis au printemps 2006 elle se saisit de la question de l'immigration, jetant dans les rues des grandes villes des centaines de milliers de Latinos désireux de protester contre le projet de texte législatif.
Les suites des enquêtes sur l'affaire Wilson-Plame et les écoutes téléphoniques de la NSA achèvent de ternir l'image et la crédibilité de l'exécutif, cependant que le président doit reconnaître en septembre l'existence des prisons secrètes de la CIA à l'étranger. Son bilan en matière de lutte contre le terrorisme souffre de la parution, au même moment, d'un rapport sénatorial concluant à l'inexistence d'un lien entre Saddam Husayn et al-Qaida et à l'absence d'armes de destruction massive en Iraq. Peu de temps après sont publiées des analyses du renseignement américain qui font du pays occupé un nouveau et dangereux foyer d’islamistes radicaux. L'administration doit aussi essuyer le mécontentement des ménages dont le pouvoir d’achat est rogné par la hausse du prix du carburant.
La consultation de midterm de 2006 est par conséquent, selon l'expression de G. W. Bush, une « raclée », qui prive le parti républicain de sa majorité dans les deux chambres du Congrès et lui fait perdre en outre le contrôle de six États. Les électeurs, qui se sont relativement mobilisés (45 % de participation), placent en position de responsabilité les démocrates. Ces derniers vont chercher avec plus ou moins de bonheur à appliquer leur programme : redéploiement puis désengagement en Iraq, relèvement du salaire minimum, financement des retraites, subvention des études universitaires, plan de santé publique, aide aux programmes de recherche sur les cellules souches, audits et éventuelles renégociations des contrats passés par l'administration avec de grands groupes privés.
Mais en premier lieu, les démocrates contraignent G. W. Bush à se séparer de son secrétaire à la Défense, le faucon D. Rumsfeld, qu'il remplace par un tenant de l'école réaliste, ancien membre du cabinet de son père et ex-dirigeant de la CIA, le modéré Robert Gates. Autre tête exigée et obtenue des démocrates : celle de John Bolton, l'inflexible ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Cependant, malgré la tradition de la recherche du compromis, le président, qui conserve l'arme du veto, fait savoir qu'il entend garder sa marge de manœuvre, notamment en politique étrangère.
6.6. L'action extérieure : des plans de reconstruction du Moyen-Orient aux désastres irakien et afghan
En politique étrangère également, le second mandat de G. W. Bush s'ouvre par un mixte de continuités et de ruptures qui achoppe tout autant. Les accents martiaux renouvelés s'accompagnent d'initiatives qui vont dans le sens d'une plus grande conciliation et d'une plus grande modération. Dans son discours d'entrée en fonction, le président s'engage à mettre fin à la tyrannie et à promouvoir l'expansion de la liberté dans le monde. Il pointe les nouvelles menaces que fait peser selon lui, par exemple, l'Iran. Bien que le cap des 1 500 morts parmi les troupes ait été franchi au début de l'année, le président n'envisage pas de leur faire quitter l'Iraq.
Les élections présidentielles qui se sont tenues en Afghanistan le 9 octobre 2004, en Palestine le 9 janvier 2005 à la suite de la mort de Yasir Arafat le 11 novembre 2004, et enfin en Iraq le 30 janvier 2005 pour la formation d'un régime parlementaire, font souffler un vent de démocratie sur le Moyen-Orient. L'ouverture politique annoncée en Égypte, les consultations populaires en Arabie saoudite, la reprise du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens semblent légitimer la stratégie adoptée par Washington, qui consiste à remodeler l'ensemble de la région.
En même temps, les premières tournées internationales effectuées par C. Rice et le président lui-même entérinent le désir américain de tirer un trait sur les différends passés avec l'Europe, de restaurer les liens transatlantiques et de faire davantage prévaloir la concertation dans le règlement des questions internationales. Mais ces impulsions nouvelles se brisent très largement sur les réalités politiques locales et le cours des événements : le résultat et le déroulement des élections législatives égyptiennes de décembre 2005 contredisent l'ouverture manifeste lors du scrutin présidentiel de septembre ; la consultation parlementaire du 25 janvier 2006 en Palestine donne la victoire aux radicaux du Hamas, tandis que la poursuite du processus de paix pour lequel s'impliquent désormais davantage G. W. Bush et C. Rice pâtit de la fragilité politique du président de l'Autorité palestinienne Mahmud Abbas comme celle du nouveau Premier ministre israélien Ehoud Olmert, successeur d'Ariel Sharon, victime en janvier d'un accident cérébral.
La fermeté avec l'Iran conduit à une escalade de tensions qui finit par retomber quelque peu à l'été 2008, sans que la succession de ces politiques aboutisse à des résultats en matière de contrôle des activités nucléaires de Téhéran.
Dans le même temps, et sans beaucoup plus d'effets, les relations avec Moscou se refroidissent sensiblement :
– crispation russe autour du projet de bouclier antimissile européen
– rapprochement réprouvé à Washington entre la Russie et le Venezuela de Hugo Chávez
– crise géorgienne de l'été 2008.
Des opérations musclées, comme l'intervention aérienne en Somalie contre les prétendues positions d'al-Qaida sur place au tournant 2007, ne réduisent guère la menace terroriste (Ben Laden demeure insaisissable), et surtout n'améliorent guère l'image du pays dans le monde. Aussi le bilan international de la seconde Administration Bush s'avère-t-il fort limité.
C'est aussi que la situation en Iraq, qui longtemps s'apparente à la fois au bourbier et à la poudrière accapare durablement la diplomatie américaine et ses moyens : si la Constitution du nouvel État est péniblement ratifiée le 15 octobre, la consultation parlementaire du 15 décembre 2005 atteste les divisions ethniques et confessionnelles d'un pays en définitive en proie à la guerre civile. La perspective de voir se former prochainement un Iraq pro-occidental, uni et séculier, s'efface tout d'abord devant les difficultés rencontrées par les parties en présence à propos de la création d'un gouvernement. L'exacerbation du climat de violence, le franchissement en octobre 2005 du cap des 2 000 soldats tués, puis de la barre des 3 000 à la fin 2006 (chiffre symbolique, équivalent au nombre de victimes des attentats du 11 septembre 2001) et le seuil des 4 000 en juillet 2008, les révélations sur les manipulations de l'opinion au moment du déclenchement de la guerre, le gouffre financier que représente le conflit et la succession de scandales impliquant les entreprises mercenaires présentes sur place plongent les Américains dans le doute quant au bien-fondé et à l'issue d'un engagement qui apparaît comme un enlisement indépassable.
La mise sur pied d'un gouvernement irakien en juin 2006, la condamnation à mort en novembre puis la pendaison de S. Husayn n'y peuvent rien. En janvier 2007, malgré la reconnaissance officielle des difficultés rencontrées sur le terrain, le président exprime son refus d'écouter à la fois sa nouvelle majorité au Congrès et les recommandations de la commission indépendante sur l'Iraq : il demande en effet l'envoi sur place de quelque 21 500 soldats supplémentaires, chiffre élevé en mars à plus de 26 000 hommes.
Mais les résultats de cette « escalade », en particulier l'amélioration notable de la situation à Bagdad comme dans le reste du pays, ne dissipent nullement les interrogations dubitatives des responsables législatifs comme de l'opinion publique, d'autant que, par ailleurs, les informations en provenance d'Afghanistan s'avèrent de plus en plus mauvaises et que la situation s'aggrave dans le Pakistan voisin.
Là, de part et d'autre de la frontière, les talibans dont l'influence grandit auprès des populations ne cessent de marquer des points, cependant qu'un bras de fer politique interne avec ses opposants démocrates a raison du président dictateur et allié, Pervez Mucharraf (août 2008). C'est pourquoi le début du retrait des troupes engagées en Iraq annoncé fin 2007 et entamé un an plus tard va de pair avec le renforcement du dispositif militaire sur le front afghan.
Aussi, sur le plan international, le président lègue à son successeur le soin de régler deux guerres majeures sans compter de multiples autres conflits et sources de tension ou encore le discrédit qui entoure le pays. À quoi s'ajoute une crise historique, de dimension planétaire...
6.7. Une fin de mandat plombée par une crise et une impopularité historiques
La fin de mandat multiplie les déboires pour le président sortant, de plus en plus isolé, impuissant et impopulaire. L'été 2007 est « meurtrier » : avec le départ de Karl Rove, son conseiller et éminence grise, et la démission quelque peu forcée d'Alberto Gonzales, le ministre de la Justice, impliqué dans une affaire de révocations abusives de procureurs, il est en tout cas fatal à son entourage. Et d'autres défections, plus ou moins voulues, suivent, tandis qu'éclatent de nouveaux scandales de mœurs ou de corruption dans les rangs républicains et que l'implication de la Maison-Blanche dans l'autorisation de pratiques d'interrogatoire peu constitutionnelles de la CIA ou de l'armée est portée au grand jour. L'impopularité de G. W. Bush, qui doit aussi faire face à l'opposition du Congrès, atteint des niveaux sans précédent.
Surtout les signes annonciateurs d'une crise économique de grande ampleur s'amoncellent : taux de pauvreté établi à 15 % de la population, tensions inflationnistes, menace de retournement du marché immobilier, risque d'insolvabilité des ménages et de défaillances d'institutions financières, déficits en série et dette record, progression, à partir de la fin de l'année, du chômage... La croissance qui se poursuit à vive allure les cache encore, mais l'éclatement de la bulle spéculative de l'été (crise des subprimes) suscite tout au long de 2008 des soubresauts financiers (déconfiture de la banque d'investissement Bear Sterns en mars et défaillances de multiples établissements) qui secouent fortement le monde financier à l'été 2008 avant de muer en tsunami national et même planétaire à la rentrée, avec, entre autres, le quasi-effondrement des géants du refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddy Mac, puis de l'assureur AIG, tous trois sauvés in extremis par l'intervention du gouvernement fédéral, au contraire de la vieille et prestigieuse banque d'affaires Lehman Brothers qui fait faillite en septembre.
L'onde de choc atteint l'économie réelle, qui, faute de crédit, vacille également, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières, au point de laisser place à la survenue d'une dépression majeure. Répudiant le laisser-faire qui lui est cher, mais donnant l'impression d'être dépassée par les événements, l'Administration se voit contrainte de débloquer, avec l'accord du Congrès, des centaines de milliards, dans des plans successifs de soutien aux banques, puis à des secteurs comme l'automobile, au bord du dépôt de bilan. Elle laisse en fait à la future équipe la tâche de gérer une crise sans doute sans précédent depuis celle de 1929 avec des caisses vides (le déficit public anticipé pour 2009 dépasse les 1 000 milliards de dollars, représentant 7, 8 ou 9 % du PIB, voire davantage, et la dette fédérale explose, flirtant avec les 70 % du PIB).
Le rejet de l'équipe Bush dans l'opinion se reflète dans l'irruption dans la campagne électorale de candidats improbables ou neufs. Chez les républicains, l'éternel « outsider » J. McCain, sénateur de l'Arizona et rival malheureux du président sortant aux primaires de 2000, l'emporte finalement assez rapidement dans la compétition interne. Il affiche une affiliation incontestable en même temps qu'une stature de héros de guerre et un profil de non-conformiste qui séduisent.
Le parti démocrate, lui, produit des personnalités improbables, marquées sous le signe de la diversité, en particulier la sénatrice de New York Hillary Clinton, première femme à briguer l'investiture avec de réelles chances de l'emporter (elle est perçue comme la « candidate naturelle »), le gouverneur du Nouveau-Mexique B. Richardson, d'origine latino, qui s'efface très vite devant le sénateur de l'Illinois Barack Obama, métis, lui aussi premier Afro-Américain à prétendre pouvoir représenter sa formation aux élections du 4 novembre.
Or c'est lui qui arrive en tête dans le caucus de l'Iowa, État du Midwest « très blanc » qui ouvre la saison des primaires. C'est un signe fort du besoin de changement auquel aspirent les Américains et dont il fait le mot d'ordre de sa campagne. Il donne le coup d'envoi d'une lutte acharnée qui mobilise les militants et ne s'achève qu'en juin, lorsque H. Clinton annonce son retrait et se rallie à son jeune collègue.
Intrônisés par les conventions de leurs partis respectifs à la fin de l'été, les deux grands concurrents révèlent l'identité du colistier qu'ils ont choisi : Joseph Biden, sénateur du Delaware et vieux routier de la politique comme des questions internationales, pour B. Obama, et Sarah Palin, nouvelle gouverneure de l'Alaska et chantre des valeurs, qui remet en selle la candidature de J. McCain mais brouille son image de modération et de discernement. L'accentuation de la crise ajoutée aux atermoiements du sénateur républicain à propos des solutions à lui apporter, la difficulté qu'il a dès lors de se démarquer de la politique de l'administration en place, le charisme de son rival et la machine implacable que celui-ci a mise en place expliquent la très large victoire du parti démocrate : non seulement les Américains portent le premier Noir à la Maison-Blanche avec une confortable avance (53 % des voix et 375 grands électeurs), mais ils lui donnent un véritable « mandat » de réforme et les moyens de la réaliser (net renforcement des majorités aux deux assemblées du Congrès). L'entrée en fonction de B. Obama, effectuée dans la liesse populaire et une affluence record malgré le froid, témoigne à ce titre des espoirs de renouveau que celui-ci a fait naître au sein de la population.
7. La présidence Obama
7.1. Le changement dans la continuité ou la thématique des cent premiers jours
Un cabinet constitué d'experts, de conseillers scientifiques
Les cent premiers jours de la présidence Obama sont marqués par la constitution relativement rapide du cabinet, l'adoption de programmes ambitieux de lutte contre la crise, la définition des priorités en matière de chantiers de réforme, et des inflexions en matière politique étrangère – en somme, le changement sans la rupture, avec de surcroît l'obtention de résultats significatifs.
Certes, la composition de l'exécutif douche quelque peu les attentes de renouveau des plus radicaux : le chef de l'État confie les postes de responsabilité à des personnalités expérimentées, plus pragmatiques qu'idéologues, et de sensibilité plutôt centriste. Ce sont souvent des poids lourds du monde politique, anciens membres des équipes de Bill Clinton ou vieux routiers de Washington. Mais il a également recours à des experts, scientifiques, ce qui tranche avec les usages de la précédente administration, mal à l'aise avec la communauté des chercheurs. Il nomme Hillary Clinton secrétaire d'État, tandis que Robert Gates, ministre de la Défense de G. W. Bush, reste à la tête du Pentagone, avec pour mission de mener à bien le retrait d'Iraq, et de renforcer conjointement le front afghan en vue de sa pacification. Le général James Jones, ancien commandant de l'OTAN, devient conseiller à la Sécurité nationale ; Janet Napolitano obtient la Sécurité intérieure, et le général Eric Shinseki, qui s'était opposé à D. Rumsfeld sur la stratégie en Iraq, se voit chargé des Anciens combattants. Leon Panetta, chef de cabinet de la Maison-Blanche sous B. Clinton, chapeaute la CIA. Symboliquement, la supervision de la politique antiterroriste échoit en partie à l'Attorney General (ministre de la Justice) Eric Holder, le premier Afro-Américain placé à ce poste de responsabilité.
L'ensemble de ces affectations donne sens et consistance au changement préconisé par B. Obama : poursuite des engagements américains en cours (notamment en matière de lutte contre le terrorisme), mais redéploiement des forces et révision des modalités comme des champs d'action des États-Unis, écoute des partenaires internationaux, et, plus généralement, ouverture sur le monde.
Dans le domaine économique et social, de nouveaux arbitrages se dessinent avec netteté. Alors que le républicain centriste Tim Geithner, jeune président de la Réserve fédérale de New York et artisan des plans de sauvetage de Bear Stern et d'AIG, prend la direction du Trésor, les spécialistes Paul Volcker et Lawrence Summers sont appelés à la Maison-Blanche pour aider B. Obama à dégager les grands axes de son action, que le choix de ces différentes personnalités place à mi-chemin entre le statu quo et l'inflexion régulatrice keynésienne.
La nouveauté provient davantage de l'accent porté sur l'environnement et la réduction de la dépense énergétique. La nouvelle équipe parie sur l'innovation écologique et le secteur en plein essor de l'économie verte pour sortir les États-Unis de la très grave crise dans laquelle ils sont plongés en même temps que de la dépendance pétrolière qu'ils ont contractée envers l'étranger. Ainsi, John Holdren, physicien de Harvard et critique de la politique environnementale de G. W. Bush, ainsi que Carol Browner, proche d'Al Gore, rejoignent le président en qualité de conseillers scientifiques, pendant que ce dernier élève symboliquement au secrétariat à l'Énergie le Prix Nobel de physique Steven Chu, fervent partisan des énergies renouvelables, et qu'il l'assiste de Jane Lubchenko, une biologiste spécialiste des fonds marins, pour former une sorte de « green team » préposée à la définition de ces objectifs comme à leur mise en œuvre.
Premières mesures
Les premiers gestes du président à son entrée en fonction se veulent significatifs du changement d'ère à Washington, même si – réalisme politique et nécessités conjoncturelles obligent – ils n'induisent pas de bouleversement majeur dans l'ordre des priorités antérieures. Ainsi B. Obama ordonne-t-il symboliquement la suspension des procédures judiciaires en cours à Guantánamo puis la fermeture du centre de détention d'ici au plus tard un an ; il met de même hors-la-loi la pratique de la torture par les forces armées et les services américains, et interdit à la CIA d'organiser des prisons secrètes.
Soucieux de circonscrire les foyers de tension qui fragilisent le Moyen-Orient, il s’engage dans la réouverture du dossier israélo-palestinien et fait de la zone Afghanistan-Pakistan un champ d’intervention prioritaire. Sans négliger les alliés européens, il multiplie les gestes envers la Russie, l’Iran, Cuba, le Venezuela ou encore la « rue arabe ».
Autre urgence : le réchauffement climatique, à propos duquel B. Obama en appelle à la concertation internationale, et, pour ce qui est de son ressort, l'échelle fédérale, à l'accélération de la mise en œuvre de normes drastiques d'émission de CO2, prenant ostensiblement le contrepied de son prédécesseur à la Maison-Blanche.
Sur le plan intérieur, il remporte à la mi-février sa première victoire législative en obtenant promptement du Congrès, moyennant quelques concessions, l'adoption d'un vaste plan de relance de 787 milliards de dollars, destiné à créer 2 à 3 millions d'emplois (certes insuffisants pour compenser les destructions concomitantes) et à financer l'investissement dans la santé, l'éducation, les infrastructures, l'environnement et les nouvelles énergies.
Quelques semaines plus tard, T. Geithner expose un nouveau programme de sauvetage et de réglementation (minimale) des banques, afin de venir à bout des actifs toxiques qui plombent leurs résultats et menacent leur survie comme plus généralement le maintien de l'activité. Après une aide massive en novembre, Citigroup, mastodonte bancaire en pleine déconfiture, est partiellement nationalisé à la fin de février, cependant que le gouvernement procède à de nouveaux renflouements de l'assureur AIG ou, en mars, avril, puis mai, des constructeurs automobiles eux aussi au bord de la banqueroute.
Ces différentes initiatives ont néanmoins un coût exorbitant : les prévisions de déficit budgétaire pour 2009 le situent à 1 750 milliards de dollars, c'est-à-dire près de 12,5 % du PIB (et encore près de 11 % pour 2010), un niveau inédit en temps de paix. Mais elles s'inscrivent pleinement dans le plan de relance concertée que B. Obama parvient à arracher à ses collègues du G20 réunis à Londres au début d'avril.
7.2. Le temps des difficultés et de la désillusion ?
Des engagements édulcorés voire abandonnés
Ces différentes mesures semblent enrayer la spirale récessionniste. Mais elles peinent à consolider la reprise et notamment à remettre en marche la machine à créer des emplois : le taux de chômage continue à grimper, pour avoisiner les 10 %, ce qui suscite inquiétude et mécontentement au sein d’une population alarmée par l’ampleur de la dépense fédérale et l'extension de ses nouveaux champs d’intervention. Symboles des difficultés prégnantes du pays, GM est nationalisée et Chrysler passe aux mains de Fiat en juin.
L’opposition à l’Administration capitalise notamment sur le rejet croissant par l’opinion du projet phare de la campagne du candidat Obama, le programme d’assurance santé universelle : beaucoup en effet estiment qu’il ne s’agit pas d’une priorité, qu’il va grever un peu plus les finances publiques et par ailleurs octroyer davantage de pouvoir au gouvernement fédéral et à sa bureaucratie. Aussi les débats qui s’engagent au Capitole sont-ils houleux et leur issue plus qu’incertaine.
La remise en cause par le président de certains de ses engagements, comme celui de fermer Guantánamo dans l’année, ajoute aux déceptions de ses partisans et n’est pas pour rien dans les mauvais résultats électoraux enregistrés par les démocrates en novembre (perte des États du New Jersey et de la Virginie notamment), même si la défaite d’un républicain new yorkais très conservateur laisse penser que la radicalisation de l’opposition emmenée par un mouvement émergent, mais de plus en plus influent, les Tea Party, ne semble pour l'heure guère payante.
Pourtant, en janvier 2010, presque un an jour pour jour après l’entrée en fonction d’Obama, c’est bien un nouveau venu adoubé par cette aile droite du Grand Old Party, Scott Brown, qui prend le siège de sénateur du progressiste Massachusetts, laissé vacant par le décès de Ted Kennedy à l’été ; non sans tétaniser le parti de l’âne, le placer désormais sur la défensive et le priver de la supermajorité au Sénat que le ralliement d’un républicain modéré fin avril et la validation d’une élection en juillet lui avaient permis d’acquérir.
Finalement, c’est un plan santé quelque peu édulcoré (concernant toutefois 31 millions d’Américains supplémentaires, sur les 50 millions privés de couverture maladie) qui est voté par le Congrès et signé par le président à l’orée du printemps 2010. Le projet de régulation des opérations spéculatives des banques est lui aussi adopté fin juin, moyennant nombre de concessions.
Malgré l’impact de la marée noire qui souille les côtes de la Louisiane après l’explosion d’une plateforme pétrolière fin avril, torpillé par les lobbies industriels, le plan climat proposé par l’Administration échoue à passer devant le Sénat. À ce titre, la lenteur de la réaction et l’impuissance patente du gouvernement face au désastre écologique accroissent les déceptions accumulées.
De surcroît, devant les tensions que suscite le sujet, le président renonce à présenter une réforme de la législation sur l’immigration. Aussi, malgré la nomination à la Cour suprême de deux femmes, Sonia Sotomayor en 2009 (la première Hispanique à entrer dans l’institution) et Elena Kagan en 2010, le camp libéral ou progressiste déchante. Et la vague populiste soulevée par les groupes Tea Party, elle, se déchaîne, emmenée entre autres par Sarah Palin, au point de menacer des républicains sortants modérés lors des primaires internes pour la désignation des candidats aux midterms de novembre, et de pousser un peu plus vers la droite le Grand Old Party, dont les caciques signent un « serment pour l’Amérique » ultraconservateur.
La sanction des midterms
En proie aux attaques (sur sa nationalité, sa religion, sa capacité à protéger le pays après les attentats terroristes déjoués dans un avion le 25 décembre et à Times Square à New York le 1er mai, enfin sur sa politique, qualifiée de socialiste), le président voit ses soutiens peu à peu le quitter. Après son directeur du Budget en juin, c’est au tour de ses conseillers économiques Cristina Romer et Larry Summers pendant l’été, puis en octobre du proche et fidèle secrétaire général Rahm Emmanuel et enfin du chef du National Security Council, le général James Jones, de quitter la Maison-Blanche, comme si l’équipe de choc avait failli ou devait laisser place à de nouvelles têtes, plus à même de s’entendre avec les futurs nouveaux leaders républicains du Congrès.
Et de fait, à la faveur d'une campagne plus que jamais sous le sceau de la polarisation, les midterms consacrent le retour de ces derniers sur le devant de la scène politique : avec un gain record de 65 sièges, le Grand Old Party reprend les rênes de la Chambre, et, s’il ne parvient pas conquérir le Sénat, il réduit nettement la majorité démocrate dans la haute assemblée (perte de 5 postes). Avec, en sus, le contrôle de 7 nouveaux États (dont les importants pivots que sont l'Ohio, le Michigan et la Pennsylvanie), et d’une vingtaine de nouvelles législatures locales, il se trouve en position de force pour définir le cadre voire l'issue des élections de 2012.
7.3. Vers un rebond ?
Prenant acte de la sanction, B. Obama s’engage à travailler avec les républicains, non sans toutefois laisser la Réserve fédérale injecter à nouveau des centaines de milliards de dollars dans l’économie et presser le Congrès sur le départ à faire passer une série de mesures en suspens : levée du tabou sur les orientations sexuelles des militaires, approbation par le Sénat du traité START conclu avec la Russie, indemnisation des dépenses de santé des travailleurs du chantier de Ground Zero…
Pour satisfaire les républicains réfractaires à toute idée de hausse des impôts, il accepte le report de la réforme fiscale qu’il envisageait de mener ainsi qu’un gel des salaires des fonctionnaires sur deux ans, mais en contrepartie obtient notamment la prolongation sur treize mois des allocations chômage. Après le fiasco du jugement civil à New York à la mi-novembre du premier détenu de Guantánamo Ahmed Ghailani (un seul chef d’accusation retenu contre ce Tanzanien responsable des attentats de Nairobi et Dar-es-Salaam en 1998, contre 285 prévus), et suivant l’interdiction faite par les représentants de tout nouveau transfèrement de prisonniers sur fonds fédéraux, Obama revient officiellement sur l’un de ses engagements initiaux et signe en mars 2011 un décret exécutif légalisant la détention illimitée sur place. D’où, en définitive, un bilan législatif conséquent, que reconnaissent nombre de ses adversaires, même s’il peut aussi décevoir ses plus fervents partisans.
Poursuivant sa recherche de compromis tant avec les républicains que les milieux d’affaires et peaufinant son recentrage politique, Obama nomme en janvier William Daley, un ancien banquier porte-parole de la Maison-Blanche, place Gene Sperling, lui aussi très proche du monde financier, à la tête de la commission d’experts économiques et accepte la démission de Paul Volcker de cette dernière.
En effet, le président doit composer avec la Chambre qui engage un bras de fer sur la politique environnementale menée par l’Administration, la reconduction du plan décennal de 2001 d’allègement massif des impôts, le déficit budgétaire et la dette publique cumulée, qui atteint en avril le plafond autorisé (100 % du PIB). Des concessions aboutissent in extremis à un accord sur les coupes à opérer dans les programmes fédéraux en 2011 , moins drastiques que prévues (38,5 milliards de dollars d’économies, contre 100 originellement, et la préservation du planning familial, pourtant dans la ligne de mire des partisans du mouvement du Tea Party) ; mais la réforme fiscale et de nouveaux plans de réduction des dépenses, repoussés, sont amenés à faire l’objet des débats de la campagne présidentielle de 2012, à laquelle B. Obama déclare le 4 avril son intention de concourir.
Bien que déconsidérés par la violence des attaques verbales qu’ils ont pu mener contre leurs adversaires démocrates et leurs possibles conséquences (fusillade en janvier à Tucson dans l’Arizona lors d’un meeting de la représentante démocrate Gabrielle Giffords) et par les concessions qu’ils sont amenés à faire au Congrès, les plus radicaux des républicains n’en envisagent pas moins leur retour prochain à la Maison-Blanche : parmi eux figurent Newt Gingrich, Rudolph Giuliani, Mitt Romney, ainsi que le milliardaire Donald Trump, qui relance une campagne d’interrogation sur la citoyenneté américaine du président, obligeant ce dernier le 27 avril à se fendre de la publication de son acte de naissance à Hawaï.
B. Obama se consacre à remanier pour l’été son conseil de guerre : Leon Panetta devant succéder à Bob Gates sur le départ depuis un an à la Défense, le général David Petraeus étant par ailleurs appelé à prendre la direction de la CIA et être remplacé par John Allen du Centcom à la tête des 140 000 hommes des forces internationales engagées en Afghanistan. L’annonce le 2 mai de la liquidation d’Oussama Ben Laden dans le cadre d’une opération commando lancée la veille contre son repaire au Pakistan, entraîne un grand mouvement de liesse dans le pays, de nature à valider la politique sécuritaire du président et le faire aussi temporairement renouer avec la popularité.
7.4. La campagne et la marche vers la réélection
Le contexte pré-électoral explique largement les obstacles que la Chambre, en majorité républicaine, dresse aux projets du président, et la situation de blocage législatif qui en découle. L’assemblée s’oppose tout d’abord à la décision de B. Obama d’intervenir en Libye, puis, pendant l’été, rejette la plupart de ses propositions en échange d’un accord sur le relèvement de la dette, quitte à voir la note du pays dégradée par l’agence Standard & Poor's.
Le compromis trouvé finalement début août ne fait que remettre à la fin 2012, c’est-à-dire après le prochain verdict des urnes, l’heure des véritables choix budgétaires : réduction drastique des dépenses fédérales et/ou hausse des impôts pour les plus fortunés. Confortés par le gain d’un bastion démocrate de l’État de New York lors d’une élection partielle en septembre, les prétendants républicains à la nomination donnent l’impression de n’avoir cure de l’assombrissement de la conjoncture et voient leurs rangs s’élargir avec l’entrée en lice d'une égérie des Tea Party Michele Bachman, de l’inusable Ron Paul, du successeur de G. W. Bush au poste de gouverneur du Texas Rick Perry, de l’homme d’affaires noir Herman Cain, du catholique ultra-conservateur Rick Santorum, ou du mormon modéré John Huntsman. La compétition entre eux, féroce, en élimine vite la plupart, de sorte qu’il ne reste pour les primaires de 2012 que quatre véritables concurrents crédibles.
Rick Santorum emporte de peu la première, dans l’Iowa, puis Mitt Romney la seconde dans le New Hampshire, et enfin Newt Gingrich la suivante, en Caroline du Sud, tandis que Ron Paul exprime une orientation doublement libérale et libertarienne qui garde de nombreux partisans dans les rangs des militants et sympathisants. Il faut plusieurs mois à M. Romney pour l’emporter : R. Santorum ne jette l’éponge qu’en avril, et N. Gingrich et R. Paul ne le font qu’en mai. Mais cette victoire à l’usure n’impose nullement l’ancien gouverneur du Massachusetts comme champion incontesté de son camp : ses liens avec Wall Street, sa religion (mormone), son action politique dans l’État très progressiste de Nouvelle-Angleterre au même titre que son dernier positionnement nettement marqué à droite ne sont pas de nature à rassembler derrière son nom l’ensemble de l’appareil, de la base et de l’électorat républicains.
Au même moment en revanche, B. Obama récolte le fruit de l’amélioration de la conjoncture. Son parti remobilise la machine et les équipes de terrain qui n'ont pas peu œuvré à son succès en 2008. Le candidat à sa propre succession multiplie les signes envoyés à ses possibles partisans, tels que les Latinos (infléchissement de sa politique très sévère de reconductions aux frontières des immigrés illégaux et renouvellement de son soutien au DREAM Act (Development, Relief and Education for Alien Minors, Développement, secours et éducation pour les mineurs étrangers) susceptible de permettre aux jeunes sans papiers de rester dans le pays et d’y poursuivre leurs études. Qui plus est, son plan de réforme de l’assurance-santé se voit définitivement approuver par la Cour suprême à la fin du mois de juin.
Si M. Romney parvient malgré tout à réunir le gros des conservateurs derrière le ticket qu’il leur propose en tandem avec celui qu’il a choisi comme colistier, le jeune représentant ultra-libéral, catholique et droitier Paul Ryan, la radicalité de son programme, ajoutée aux multiples maladresses dont il fait preuve à l’instar d’autres figures républicaines (à propos de l’avortement par exemple), sème le trouble chez nombre d’électeurs indépendants, de modérés, et surtout de femmes.
Mis en difficulté à la suite de l’attaque du consulat de Benghazi et de la mort consécutive de l’ambassadeur américain en Libye en septembre, puis à nouveau après une prestation jugée décevante lors du premier débat télévisé qui l’oppose à son adversaire au début d’octobre, B. Obama peaufine in extremis son image de leader et consolide son avance lors de sa gestion de l’ouragan Sandy qui s’abat sur la région de New York à la toute fin de ce mois. Porté comme en 2008 par une coalition composée des minorités en plein essor démographique, des jeunes, des citadins et d’une majorité de femmes, il est confortablement reconduit à son poste le 6 novembre, avec 51 % des voix et 332 grands électeurs, contre respectivement 47 % et 206 pour M. Romney. Les démocrates non seulement gardent le contrôle du Sénat où ils obtiennent un siège supplémentaire (54), mais ils réduisent la domination des républicains à la Chambre en leur arrachant 10 circonscriptions (ce qui porte leur nombre de représentants à 201, contre 234 pour le parti de l’éléphant).
Si le président réélu est loin d’avoir les coudées franches, le pays n'en fait pas moins clairement connaître ses priorités en termes de choix de société et de politiques fiscales et budgétaires pour les mois voire les années à venir. Il confirme aussi la relégation exprimée en 2008 dans le cadre exceptionnel de la crise financière des enjeux raciaux et son engagement désormais résolu en faveur de considérations et d’orientations post-ethniques.
7.5. Difficultés et succès du dernier mandat
La fenêtre d’opportunité qui s’ouvre pour B. Obama est cependant étroite. Aussi renouvelle-t-il son cabinet, en s’entourant de proches et en tenant compte des départs voulus (H. Clinton, au Secrétariat d’État, que remplace un routier du Sénat, John Kerry), attendus (T. Geithner, au Trésor, auquel succède Jacob Lew, rompu aux négociations difficiles ; L. Panetta, dont le républicain modéré Chuck Hagel est appelé à prendre la suite au Pentagone), ou forcés (D. Petraeus, impliqué dans un scandale de mœurs, doit laisser la place à la tête de la CIA à l’ancien agent John Brennan qui avait soutenu les méthodes anti-terroristes de l’administration Bush). Il marque aussi son souci de travailler de concert avec l’opposition au Congrès : ainsi congédie-t-il la plupart des environnementalistes purs et durs qu’il avait fait entrer au gouvernement 4 ans plus tôt pour s’entourer d’hommes et de femmes plus favorables à l’exploitation des gaz de schiste et à la relance du nucléaire civil.
Prenant acte du verdict des urnes, les responsables à la Chambre du Grand Old Party acceptent fin 2012 un budget temporaire qui prévoit une hausse marginale des impôts pour les foyers les plus riches et remettent au 1er mars 2013 la date limite pour que les deux parties trouvent un accord sur le poids relatif à attribuer à l’avenir aux prélèvements fiscaux et aux coupes dans les dépenses. Campant chacune sur leurs positions respectives, et malgré la menace que fait peser sur l’activité la perspective d’une réduction sensible de l’investissement fédéral, elles s’avèrent à ce moment butoir incapables de trouver un terrain d’entente, ce qui déclenche des mesures automatiques de taille arbitraire dans les programmes, à hauteur de 85 milliards, affectant essentiellement les services publics et la Défense. Et ce, alors même que les fruits de la croissance (2,2 % en 2012, malgré le contrecoup de l’ouragan Sandy) font diminuer plus rapidement que prévu le déficit, à 4 % du PIB.
Les projets présidentiels de relèvement de 20 % du salaire minimum, de lutte contre la pollution, de législation contre les armes à feu et de régularisation de travailleurs étrangers font aussi les frais de la recrudescence de l’opposition républicaine au Congrès et se voient rapidement condamnés à l’enlisement. Entre-temps, à la suite de l’attentat contre le marathon de Boston en avril et d’un mouvement de grève de la faim mené par les détenus de Guantánamo, B. Obama se retrouve confronté à l’épineux dossier de la lutte contre le terrorisme qu’il escomptait pourtant fermer. Au même moment, l’image de compétence et d’impartialité des services fédéraux se trouve ternie par de nouvelles révélations sur l’attaque en septembre du consulat américain à Benghazi, des fuites sur la surveillance dont ont été l’objet des journalistes de l’Agence AP (Associated Press) et la divulgation du ciblage d’organisations proches du Tea Party par les bureaux du fisc. C’est dans ce contexte passablement troublé, et alors même que le soldat Bradley Manning, à l’origine de l’affaire Wikileaks, est en passe d’être jugé par une cour martiale près de Washington, qu’éclate le scandale des écoutes de la NSA (National Security Agency).
À l'indignation de l'opinion publique, les informations transmises à partir de juin aux médias par l’ex-agent Edward Snowden (réfugié à Hong Kong) font état d’une surveillance massive des communications électroniques passées par les Américains ; développée dans le cadre de la lutte anti-terroriste et en vertu des dispositions du Patriot Act sous l’Administration Bush, cette activité n’a nullement pris fin avec l’arrivée au pouvoir de B. Obama.
L’affaire s’envenime pendant l’été, quand Vladimir Poutine avec lequel les rapports sont exécrables, offre l’asile politique à l’ex-agent, enfonçant un coin supplémentaire dans les relations entre Moscou et Washington. Et c’est en outre l’obstruction russe dans le dossier syrien qui contraint B. Obama à faire machine arrière et à repousser voire enterrer tout projet d’intervention militaire internationale contre le régime de Damas au début de septembre.
La crise budgétaire refait surface à la fin du mois, quand, emmenés par leur frange Tea Party, les Républicains à la Chambre, appelés à se prononcer à nouveau sur le financement des programmes gouvernementaux, se mobilisent pour enterrer la réforme santé d’Obama en la privant des fonds nécessaires à son entrée en fonction. S’ensuit un bras de fer entre le législatif et l’exécutif, qui conduit à suspendre pendant 16 jours les activités non indispensables des services fédéraux (government shutdown) et à mettre près d’un million de fonctionnaires au chômage technique. L’opinion, outrée avant tout par l’intransigeance du Grand Old Party, permet au président d’emporter cette nouvelle manche en soutirant au Congrès un répit supplémentaire qui prolonge le fonctionnement des services centraux et autorise un relèvement du plafond de la dette publique jusqu’à la réouverture des tractations prévue pour le début 2014. Mais le crédit acquis par l’exécutif, éphémère, pâtit bientôt et durablement des multiples difficultés informatiques que rencontre la mise en place de l’assurance santé – toutes choses qui avalisent l’idée de gabegie publique dénoncée par les républicains. Or si ces ratés initiaux disparaissent au cours de 2014, si le Congrès vote sans difficultés ni contrepartie l’augmentation du montant autorisé des emprunts fédéraux en février, et si la vigueur de la reprise se confirme (2,4 % de croissance en 2014, avec un chômage repassé à la fin de l’été sous les 6 %), une majorité d’Américains continue d’estimer ne pas en voir les fruits et fait porter la responsabilité de l’accroissement des inégalités à l’administration en place. Aussi le parti de Lincoln remporte-t-il le Sénat et accroît son contrôle de la Chambre lors des élections de midterm (novembre) renforçant d’autant sa puissance d’entrave à l’action d'un président en fin de mandat.
Dès lors pourtant, comme libéré des enjeux partisans, celui-ci n’a de cesse de prendre à rebours le front élargi de ses opposants : si les républicains au Congrès se font d’abord conciliants en autorisant en décembre un énième prolongement du financement de l’État fédéral, ils ne peuvent empêcher B. Obama de multiplier des initiatives qu’ils réprouvent, comme la régularisation par décrets de millions de travailleurs sans papiers, puis la normalisation à la fin de l’année des relations avec Cuba, le blocage de la construction de l’oléoduc Keystone, la conclusion en avril 2015 d’un accord international avec l’Iran ou la définition pendant l’été de nouvelles normes de pollution destinées à réduire significativement la contribution du pays en gaz à effet de serre. Le président obtient en outre à la fin juin le soutien de la Cour suprême, qui coup sur coup confirme une nouvelle fois la validité de son plan santé et avalise le mariage homosexuel en faveur duquel il s’est prononcé. D’abord entravé par ses amis démocrates de la Chambre, il finit par recevoir en juillet un blanc-seing parlementaire pour lier plus étroitement aux États-Unis 11 nations riveraines dans le cadre d’un traité transpacifique de libre-échange conclu en octobre. Et, prolongeant son action environnementale, il approuve en décembre 2015 l’accord international de Paris sur le climat.
Avec une croissance située à 2,9 % en 2015, puis à 1,5 % en 2016, un chômage ramené à son niveau d’avant la crise (5 %, voire moins), et une couverture santé étendue à quelque 20 millions de nouveaux assurés, B. Obama peut se targuer d’un bilan honorable, même si ses limites (inégalités en hausse et faiblesse du taux d’activité, dysfonctionnement du gouvernement fédéral, recrudescence de la violence et exacerbation des tensions raciales) entretiennent la rancœur des déçus et mécontentent les laissés-pour-compte. De surcroît, les attentats djihadistes de Chattanooga en juillet 2015 (5 militaires tués), San Bernardino en décembre (14 morts dans un centre social), ou Orlando en juin 2016 (49 victimes dans une boîte de nuit gay), ainsi que tous ceux déjoués par les services de sécurité nourrissent une sourde inquiétude dans le pays. Ainsi, tandis qu’il regagne la confiance de ses concitoyens, le président fait face à des obstacles qui menacent la solidité de son legs. Tout d’abord, et contre toute tradition institutionnelle, mais au motif que ce choix crucial pour la future sensibilité de la Cour suprême doit in fine revenir aux électeurs de novembre, il se voit priver par les sénateurs républicains de la possibilité de donner un successeur au très droitier juge Scalia, décédé en février 2016. Ensuite, après avoir suspendu les derniers décrets exécutifs en matière d’énergie propre et de climat, cette même Cour suprême, désormais également partagée entre progressistes et conservateurs, remet en cause la régularisation des sans-papiers édictée par le chef de l’État.
La campagne des primaires témoigne des insatisfactions et des peurs accumulées, ainsi que d’une forte demande de renouveau : dans le camp républicain, alors que les membres du Tea Party à la Chambre obtiennent la tête de leur Speaker qu’ils jugent trop modéré au début de l’automne 2015, les sondages placent très vite en tête des intentions de vote les outsiders Donald Trump et Ben Carson – loin devant les routiers du parti que sont Scott Walker, Jeb Bush, Chris Christie, John Kasich ou même les jeunes élus Marco Rubio et Ted Cruz. Chez les démocrates, H. Clinton doit composer avec un concurrent inattendu sur sa gauche, Bernie Sanders, un sénateur indépendant du Vermont qui n’hésite pas à se dire socialiste et qui suscite bientôt l’engouement chez les jeunes militants.
Entourée d’un parfum de scandale (à propos de la gestion privée de sa boîte mail et d’hypothétiques conflits d’intérêts lors de son passage au secrétariat d’État de 2009 à 2013), affublée d’une réputation de pragmatique modérée dépourvue de véritables convictions, et privée de réel charisme, H. Clinton ne s’impose que tardivement et difficilement, cependant que, de son côté, déjouant tous les pronostics, à grand renfort de slogans souvent volontairement simplistes et même incendiaires, le magnat de l’immobilier new-yorkais et ex-figure de la télé-réalité D. Trump vient progressivement à bout de ses différents concurrents, y compris les plus expérimentés et les mieux entourés.
Mais, de la même manière que celle qui devient pendant l’été sa principale concurrente peine à rassembler sa base électorale, le trublion républicain ne parvient pas, loin de là, à réunir derrière sa personne, très contestée, et son programme, tout aussi insaisissable et hétérodoxe, l’ensemble du parti. En dépit d’une convention nationale républicaine et de débats télévisés jugés ratés, malgré l’opposition quasi-unanime de la presse et des sondages continûment plutôt défavorables, D. Trump et son colistier, le très religieux gouverneur de l’Indiana Mike Pence, s’emploient à jeter le doute sur la fiabilité et l’intégrité d’H. Clinton et à capitaliser sur les difficultés que rencontre sa campagne (problèmes de santé, rebondissement de l’affaire des mails, défiance). Multipliant les déplacements comme les contacts via les réseaux sociaux, déchaînant les passions par ses propos et ses propositions, D. Trump galvanise et mobilise le gros des hommes blancs peu éduqués, sans pour autant vraiment se couper des classes moyennes et supérieures. Contre toute attente, il arrache, avec les pivots que sont la Floride, l’Ohio, la Pennsylvanie, mais aussi le Michigan, ou encore le Wisconsin, une incontestable majorité au collège électoral (306 contre 232). Avec certes près de 3 millions de voix de moins que le ticket démocrate, il n’en emporte pas moins le scrutin du 8 novembre et permet aux républicains de conserver le contrôle des deux chambres du Congrès, de renforcer leur emprise sur les États (33 sur 50) – et d’avoir ainsi désormais les moyens de démanteler l’héritage Obama…
7.6. Réalisme politique dans les relations avec le reste du monde
La stratégie du « pivot »
Conscient des limites de la superpuissance américaine et réticent à l’idée de la déployer sur des fronts extérieurs supplémentaires, B. Obama s’emploie à nouer de multiples partenariats visant à résoudre au cas par cas ou en retrait, selon une stratégie dite du « pivot », les problèmes qui se posent à l’échelle de la planète, n’hésitant pas à solliciter davantage la contribution des alliés ou à privilégier l’option multilatérale. Cette doctrine, mise en œuvre successivement avec la Chine, la Russie, l’Europe, le Pakistan, l’Inde, l’Afrique, le Moyen-Orient – avec plus ou moins de bonheur – est formalisée comme telle à partir de mai 2010 et est ensuite régulièrement confirmée (février 2013, mai 2014).
Asie
En concertation avec l’Empire du Milieu, l’Administration cherche à répondre aux premières crises diplomatiques qui se posent véritablement à elle, à savoir la menace nucléaire nord-coréenne dès la fin mai 2009. Sans grand succès…
En effet, les États-Unis prêtent main forte à Séoul dans la mer Jaune à la fin novembre 2010 à la suite du bombardement de l’île de Yongpyong par les Nord-Coréens (et plus tôt, en mai 2010, de l’explosion de la corvette Cheonan imputée à Pyongyang). Ces derniers procèdent à des lancers de fusées en avril et décembre 2012 puis en février 2013, en mars 2014, et tout au long de l’année 2016, en les couplant alors à des essais nucléaires. La Corée du Nord agite en outre la menace d’une invasion du Sud au printemps 2013, organise à l'extrême fin 2014 le piratage d’une major de Hollywood pour l’inciter à déprogrammer le lancement d’un film ridiculisant Kim Jong-un, et réagit au déploiement en 2016 du bouclier anti-missiles américain Thaad, ainsi qu’aux manœuvres militaires menées conjointement avec les troupes sud-coréennes, par une escalade de la tension.
L’opération de séduction menée par Washington envers Pékin (sommet à Washington en juillet) fait long feu et laisse vite place à de nombreux points d’achoppement : qu’il s’agisse des questions économiques, financières et monétaires exprimées tant lors des différents G20 (Pittsburg en septembre 2009, Séoul en novembre 2010) qu'à l'issue de la crise budgétaire de l'été 2011, de l’enjeu climatique (échec du sommet de Copenhague en décembre 2009, demi succès à Cancún un an plus tard), de la compétition pour l’approvisionnement en ressources stratégiques, en Afrique notamment, ou encore des contentieux frontaliers avec le Japon (îles Senkaku) que les autorités chinoises agitent régulièrement contre le grand allié des États-Unis dans la région.
À la déférence initiale succèdent les sujets de crispation : ainsi le renforcement des liens avec Taïwan à la fin janvier 2010 ou la rencontre d’Obama avec le dalaï-lama en février ne manquent-ils pas d’indisposer les dirigeants chinois. Ceux-ci s’inquiètent aussi du lien ostensiblement renoué avec New Delhi lors de la réception du Premier ministre Manmohan Singh à Washington en novembre 2009 et de la visite en Inde du président des États-Unis un an plus tard, car ils y voient un message signifiant que les deux puissances entendent dorénavant contrer l’influence régionale de Pékin. Après avoir tout d’abord privilégié un axe sino-américain considéré comme majeur, l’Administration Obama redécouvre durablement l’importance du contrepoids indien mis en avant par l'équipe Bush. L’annonce faite en marge du sommet de l’ASEAN en novembre 2011 de la construction prochaine d’une base militaire américaine sur les côtes septentrionales de l’Australie, le long voyage fait par le président en Afrique au début de l'été 2013, la signature, en octobre 2015, d’un ambitieux traité transpacifique (TTP) qui regroupe autour des États-Unis 11 États riverains pour créer une immense zone de libre-échange et prendre de court l’initiative parallèle menée par les autorités chinoises, la patrouille de navires de l’US Navy au large de l’archipel Spratley que celles-ci revendiquent au même moment, ou encore la levée de l’embargo sur la vente d’armes au Viêt Nam décrétée en mai 2016 se lisent comme autant de manifestations de la volonté de Washington d’endiguer l’influence grandissante de l’Empire du Milieu. Il reste que, malgré les contentieux, les rivalités, et les accusations de dumping proférées par le candidat D. Trump, de par leur place dans les équilibres du monde, notamment en matière économique, financière et écologique, les deux pays sont plus que jamais contraints à la concertation. Ils signent ainsi le plan international de réduction des gaz à effet de serre à la COP21 de Paris en décembre 2015…
Russie
La dénucléarisation est une autre priorité définie par Obama. Celle-ci passe par Moscou, avec qui les relations se détendent dès mars 2009. La relance des négociations avec la Russie, gelées sous la précédente Administration, aboutit pendant l’été à l’annonce de la conclusion prochaine d’un nouveau traité bilatéral de réduction substantielle (de l’ordre de 30 %) des arsenaux nucléaires : avancée significative, un nouvel accord START est conclu entre les deux parties à la fin mars 2010 et ratifié en décembre par le Sénat. Mais les suites de l’affaire Magnitski (du nom d’un avocat fiscaliste spécialisé dans les affaires de corruption des hauts dignitaires russes et mort dans des conditions suspectes lors de son emprisonnement à Moscou à la fin de 2009) ravivent à l’été 2011 les contentieux réciproques et ouvrent une période de net refroidissement fait d’escalade dans les mesures de rétorsion prises de part et d’autre.
À cet égard, les années qui suivent renouent avec l’ère de glaciation qui prévalait antérieurement : V. Poutine, convaincu que les Américains ont orchestré les manifestations d’opposition à son retour à la tête de la fédération à l’hiver 2011-2012, a donc beau jeu de multiplier les crocs-en-jambe, que ce soit à propos de la Syrie de Bachar al-Assad, dont il ne manque pas de faire savoir qu’il n’est nullement disposé à la lâcher jusqu’à soutenir le régime de Damas directement par les armes à partir de septembre 2015, ou encore, sur un tout autre registre, au sujet de l’affaire des écoutes de la NSA, puisqu’au cours de l’été 2013 le maître du Kremlin prend soin d'accueillir le lanceur d’alerte à l’origine du scandale, l’ex-agent E. Snowden, et même, comble de la provocation, de lui accorder l’asile politique.
Les relations se détériorent plus encore lors de la crise ukrainienne du tournant 2014. Tandis que les autorités de Moscou voient dans le renversement du pouvoir allié de Kiev en février la main des Occidentaux et en particulier celle de Washington, les États-Unis multiplient les mesures de rétorsion contre les dirigeants russes après la décision que ces derniers ont prise d’envahir, d’occuper puis d’intégrer la Crimée à partir de mars. Depuis, ils s’emploient régulièrement à rassurer les partenaires frontaliers que sont les pays Baltes, la Pologne et la Roumanie en renforçant sur place les moyens militaires mis à disposition de l’OTAN, et en faisant même entrevoir une possible participation de l’Ukraine à cette organisation de défense – tout en s’attachant à tarir les sources d’affrontement direct avec la grande puissance de l’Est.
C’est un climat de guerre froide qui s’abat entre Est et Ouest en fin de mandat, tant du fait de l’intensification de l’intervention russe en Syrie que des soupçons, par la suite avérés, de piratage cybernétique et de l’immixtion de Moscou dans le processus électoral américain – au détriment de l’ex-secrétaire d’État H. Clinton, et pour le compte de D. Trump, qui, lui, ne fait guère mystère de son admiration pour V. Poutine et de sa volonté de ressouder le partenariat entre les deux pays.
Europe
La dimension transatlantique n’est pas non plus négligée, même si celle-ci semble devoir tout d'abord être davantage incarnée par le vice-président Joe Biden ou la secrétaire d’État H. Clinton, à charge pour eux de rappeler aux Européens leurs engagements dans le conflit en Afghanistan, grand sujet d'inquiétude de l’équipe Obama à son arrivée au pouvoir. Les impératifs budgétaires et notamment l’impact que prend, à partir de la mi-2011, le sauvetage de la zone euro dans la poursuite de la sortie de crise des États-Unis incitent le chef de l’État à s’impliquer davantage et à multiplier les recommandations et pressions à l’égard de ses homologues et partenaires de l’autre côté de l’Océan.
Par ailleurs, les discussions en vue de la signature d’un traité de libre-échange s’intensifient, mais elles sont durablement perturbées à partir de la mi-2013 par les révélations et rebondissements successifs de l’affaire Snowden sur les activités de surveillance des populations et de leurs dirigeants auxquelles se livrent les services secrets américains. A la fin de l’été 2013, l’hypothèse d’une intervention conjointe avec le Royaume-Uni et la France en Syrie tourne finalement court, devant la défection des Britanniques, du fait de l’obstruction des Russes , et faute d’une véritable impulsion venue de la Maison-Blanche. Cet échec qui affecte la « relation spéciale » Londres-Washington fait officiellement de Paris le principal partenaire européen des États-Unis, même si en définitive l’échec de l’initiative isole ce dernier dans le traitement du dossier. Il est vrai que depuis le début de l’année les deux capitales travaillent de concert dans les opérations d’endiguement de la menace terroriste au Mali et en Afrique saharienne. Et qu’à la fin de l’été 2014, les progrès de l’État islamique en Syrie et en Iraq contraignent le président américain à revoir sa stratégie et à organiser, en coopération notamment avec la France et le Royaume-Uni, une coalition internationale contre l’avancée sur place des djihadistes.
Faisant suite aux événements d’Ukraine, B. Obama renouvelle à maintes reprises son attachement au lien transatlantique et confirme l’implication de son pays dans la défense de l’Europe. S’il rejette toute idée d’implantation de bases militaires permanentes à l’Est, il dépêche des avions militaires de l’OTAN en Pologne et Roumanie en mars 2014 et, face aux menées du voisin russe, assure en septembre les États baltes du soutien de la puissance américaine – toutes choses qu’il réitère par la suite. Enfin, au printemps 2016, il s’implique dans la campagne sur le Brexit, en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne – en vain.
Moyen-Orient et Maghreb
Le Moyen-Orient reste au cœur des préoccupations des décideurs américains. Si conformément à l’une de ses promesses de campagne, B. Obama accélère le retrait d’Iraq, engagé à la fin août 2010 (pour ne laisser stationner, malgré le blocage politique consécutif aux élections législatives de mars 2010 et la recrudescence en parallèle des violences, qu’une cinquantaine de milliers d’hommes, chargés du maintien de l’ordre) puis effectif en décembre 2011, c’est pour étoffer dès février 2009 le front afghan, qui donne alors de multiples signes de faiblesse.
Pourtant la situation à Bagdad reste fragile : s’appuyant sur les chiites, le Premier ministre Nuri al-Maliki dresse contre son gouvernement le gros de la population sunnite et ne parvient à restaurer ni la stabilité ni la sécurité. Les attentats sont légion, tout comme les dissidences au sein du pays. Les élections législatives d’avril 2014 qui semblent devoir reconduire l’équipe en place s’accompagnent de l’avancée de groupes djihadistes sécessionnistes qui ne tardent pas à proclamer sur place et à l’ouest l’instauration d’un califat, l’État islamique (EI), au point de précipiter l’intervention des Américains, qui imposent en août avec l’agrément des Iraniens une nouvelle tête au gouvernement irakien, Haïdar al-Abadi, puis, dès la fin de l’été, dans le cadre d’une coalition internationale ad hoc, des frappes aériennes contre les places fortes des rebelles. Et en novembre, remisant les plans initiaux, Washington se prononce pour le renforcement et de fait le doublement des effectifs militaires toujours présents en Iraq, avant de dépêcher, à la fin de l’année 2015 puis au cours de 2016, des forces spéciales ayant pour mission de décapiter Daech. Sans grand effet dans un premier temps, malgré les pertes régulièrement essuyées par l’organisation terroriste, laquelle prospère sur ses bastions syriens et profite des hésitations de la communauté internationale au sens large et de l’administration Obama en particulier sur ce dossier brûlant. Le soutien américain, crucial, contribue néanmoins au reflux de l’EI, consacré par la reprise de Ramadi par les forces irakiennes à l’extrême fin de 2015, puis par la reconquête de Fallouja au tout début de l’été 2016, et enfin par la bataille de Mossoul engagée à partir de l’automne 2016.
En Afghanistan, l’imbroglio politique qui reconduit en novembre 2009 Hamid Karzai à la tête d'un État sans véritable administration n’aide en rien l’action des forces internationales, qui, par ailleurs, dans leur traque des terroristes talibans multiplient les bévues et s’aliènent un peu plus des civils lassés par la violence et la corruption dominantes.
Le limogeage, à un an d’intervalle, des commandants en chef des forces internationales David McKiernan en mai 2009 et de son successeur Stanley McCrystal en juin 2010 témoigne des dissensions internes voire du désarroi qui règne en haut lieu à propos des stratégies à adopter dans ce qui apparaît de plus en plus comme un nouveau « bourbier ». David Petraeus, l’architecte du « surge » iraquien appelé à diriger les forces en présence sur place (avant de prendre la tête de la CIA en septembre 2011), poursuit l’intensification de l’offensive menée dans le sud-est du pays depuis le début de l’année et l'« américanisation » de l'opération internationale actée lors du sommet de l'OTAN à Lisbonne fin novembre 2010. En parallèle, les responsables exécutifs avouent mener des négociations avec les différentes parties en présence, dont les talibans, afin de mettre en œuvre un processus de réconciliation nationale – et d’aboutir à un désengagement militaire, évoqué publiquement et amorcé par le président Obama dès le début de la seconde moitié de 2011, avec comme objectif le rapatriement d’un tiers des 100 000 hommes sur place d’ici l’été 2012 et le retour aux États-Unis de la majeure partie du contingent pour 2014.
Mais le président Karzaï rechigne à signer le traité bilatéral de sécurité concocté par les responsables américains et prévoyant des garanties pour le maintien à court terme de 12 500 soldats internationaux chargés de la sécurité. Son successeur, Ashraf Ghani, vainqueur contesté du second tour de la présidentielle de 2014 mais imposé à l’issue d’âpres tractations entre parties menées sous l’égide du Département d’État, paraphe, lui, le texte au lendemain de son intronisation fin septembre, augurant un plus grand alignement des autorités de Kaboul envers Washington. Mais la défiance n’en reste pas moins vive, repoussant d’autant l’objectif de pacification. De fait, la dégradation de la situation intérieure à la fin de 2015 (instabilité généralisée, permanence des attentats, emprise renforcée des talibans et même implantation de l’EI) contraint B. Obama à revenir sur son engagement de rapatrier l’ensemble des forces armées d’ici à la fin de son mandat et à prolonger au contraire leur mission jusqu’en 2017.
Conjointement, les politiques s’attachent aussi à renforcer le volet pakistanais du conflit, en particulier en augmentant l’aide attribuée à Islamabad. Mais l’allié et voisin apparaît de moins en moins fiable : fragilisé par des inondations catastrophiques de l’été 2010 et le discrédit de ses leaders, il ne manque pas de s’émouvoir du réchauffement qui prévaut dorénavant entre Washington et l’ennemi indien. En outre, les populations locales s’irritent de plus en plus de l’intensification d’opérations qui leur semblent attenter à la souveraineté nationale : multiplication des attaques de drones à la frontière avec l’Afghanistan, exfiltration d’un agent lié à la CIA en mars 2011, raid et exécution d’O. Ben Laden près de la capitale au début de mai. La vive réaction d’hostilité aux États-Unis qui s’ensuit dans l’opinion s’ajoute aux soupçons croissants que Washington nourrit à l’endroit de l’armée pakistanaise et de son possible double jeu envers les islamistes, ce qui obère les chances de la coalition. L’aide militaire américaine est de la sorte temporairement suspendue à l’été 2011 et les relations entre les deux partenaires tournent dès lors à l’aigre. La mort de 24 soldats lors d’une opération de l’OTAN contre un poste frontière le 26 novembre 2011 suscite dans le pays une vague d’indignation telle que le gouvernement d’Islamabad décide en rétorsion de bloquer le ravitaillement des forces internationales présentes en Afghanistan.
En outre, la poursuite par les Américains de la stratégie de liquidation des chefs d’al-Qaida et des talibans après la levée de l’embargo en juin 2012 ne chasse en rien les malentendus ni n'allège les tensions accumulées – d’autant plus qu’elle contrecarre la politique de dialogue et de réconciliation nationale préconisée par la nouvelle équipe dirigeante pakistanaise, portée au pouvoir par les élections de mai 2013.
Dans ce contexte, les discours successifs d’Obama pour rassurer et apaiser la « rue musulmane » – propos du Caire du 4 juin 2009, faisant suite à ceux d’Ankara et appelant plus explicitement à la refondation des liens entre Occident et Orient autour de l’idée selon laquelle « l’Amérique et l’islam ne s’excluent pas » ; allocution de Jakarta du 10 novembre 2010 – comme les efforts, répétés, redoublés mais infructueux, qu’il entreprend pour remettre autour de la table des négociations Israéliens et Palestiniens et désamorcer ce différend majeur qui nourrit les tentations de djihad, ne semblent guère devoir aller au-delà du stade de la pétition de principe ou de la déclaration d'intention.
Pourtant, prise de court par les soulèvements populaires du Maghreb (en partie liés aux fuites de Wikileaks rendant publics 250 000 télégrammes du Département d’État et de ses ambassades à la fin novembre 2010), l’Administration Obama salue le courage des Tunisiens lorsque ceux-ci forcent au départ leur président Ben Ali le 14 janvier 2011 dans le cadre de la « révolution de jasmin ». Mais, craignant un scénario à l’iranienne, elle peine à trouver, lors du « printemps arabe » qui s’ensuit, une ligne claire s’agissant du fidèle allié égyptien. Elle finit malgré tout par presser Hosni Moubarak à quitter ses fonctions, puis entérine, bon gré mal gré, les évolutions de la situation politique au Caire au point de se trouver à nouveau en porte-à-faux quand les militaires manœuvrent pour destituer le président islamiste Morsi au début de l’été 2013. Condamnant la répression violente des manifestations des Frères musulmans qui se succèdent jusqu’à l’automne, Washington se retrouve dans l’obligation de jouer, temporairement, l’opposition au nouveau pouvoir. Et de payer cette posture par une brouille prolongée avec le gouvernement du maréchal al-Sissi.
De même, en mars 2011, Obama se rallie non sans hésitation à une action militaire contre la Libye du colonel Kadhafi, sous l’égide de l’OTAN, ce qui crée finalement un nouveau foyer majeur d’agitation et de déstabilisation islamiste. La crainte d’attiser la menace terroriste et de favoriser le terreau djihadiste explique largement qu’il se contente de condamner la répression menée par les autorités de Damas contre la population en colère et qu'il évite toute ingérence trop marquée dans les troubles qui secouent le Yémen ainsi que Bahreïn, deux États pivots dans la lutte que les États-Unis mènent contre al-Qaida. Ce qui n’empêche pas les militaires américains de multiplier les attaques de drones dans le sud de la péninsule arabique, de soutenir les forces régulières contre les islamistes en Libye, de cibler les chefs de l’EI par des tirs aériens en Syrie, ou d’intervenir régulièrement contre les chababs somaliens.
Un coup fatal est de fait porté à al-Qaida lorsque dans la nuit du 1er au 2 mai 2011 un commando américain liquide Ben Laden dans sa retraite pakistanaise d’Abbottabad, suscitant un immense soulagement et une vague d’enthousiasme dans l’ensemble des États-Unis. La protestation sur place se double en revanche de celle qui émane de la « rue musulmane », de Tunis à Khartoum, et du Caire à Dacca, lors de la diffusion sur Internet par des fondamentalistes de Floride et de Californie d’un film-pamphlet contre l’islam en septembre 2012. Ces mouvements conjoncturels de colère ou plus profonds de réaction coûtent d’ailleurs la vie à l’ambassadeur américain de Libye, victime au même moment d’un guet-apens à Benghazi. Les manifestations d’indignation populaire, qui découlent des opérations de liquidation des organisations terroristes, et la renaissance de puissants mouvements djihadistes, en Iraq et en Syrie mais aussi en Libye et en Afrique subsaharienne, témoignent de la persistance du fossé qui existe entre les différentes civilisations, ce qui alimente l’idée de clash qu'Obama était pourtant initialement bien décidé, par son action, à démentir. Cette contradiction attise un peu plus le foyer de la radicalisation et nourrit le vivier des candidats au djihad, non sans entretenir, voire élargir, la spirale de la violence.
Les Américains ne parviennent pas plus tout d’abord à arrêter le programme nucléaire iranien, au risque de voir les alliés israéliens mener par eux-mêmes des opérations militaires qui déstabiliseraient un peu plus un Moyen-Orient déjà en proie à de graves troubles. Toutefois, l’élection en juin 2013 à Téhéran d’un nouveau président, le modéré Rohani, ouvre une nouvelle page dans les relations entre les deux pays, comme en témoignent l’échange téléphonique historique que B. Obama passe à son homologue à la fin de septembre puis la position ouvertement plus conciliante désormais affichée par Washington. De surcroît, le délitement intérieur de l’Iraq, la guerre civile en Syrie et les progrès de l’État islamique dans la région rendent d’autant plus nécessaires la reprise et l’approfondissement du dialogue avec cet acteur majeur du Moyen-Orient qu’est l’Iran. L’accord international sur le nucléaire iranien appelé de ses vœux par la Maison-Blanche procède à la fois de ces évolutions et de ces considérations : il met fin en avril 2015 à une douzaine d’années de tractations, de sanctions et de mise en quarantaine de cette grande puissance du Golfe, mais suscite la vive irritation des alliés (ennemis) saoudiens et israéliens – ainsi que celle de leurs relais au Congrès… Il n’empêche : Téhéran, dès lors poussé par Washington, semble devoir faire son grand retour à la fois sur la carte régionale, dans le concert mondial, et parmi les grandes destinations des flux globaux d’investissement.
Amérique
La conduite des affaires portant sur l’ensemble du continent, longtemps « pré carré » des États-Unis, témoigne d’une grande continuité : priment toujours la protection des nombreux intérêts économiques et la priorité donnée à l’intensification des échanges, ainsi que la lutte coordonnée contre les trafics de drogue et l’immigration clandestine, notamment à la frontière mexicaine. C’est à cette aune plurielle qu’il convient d’appréhender le soutien accordé par la nouvelle administration de Washington au coup d’État qui renverse le président Zelaya et suspend les institutions démocratiques honduriennes en 2009. Toutefois une orientation plus nettement humanitaire et tournée vers le développement interne se dessine en parallèle, en particulier à la suite du terrible tremblement de terre qui dévaste Haïti au début 2010. De surcroît, le continent rassemble de nombreux pays émergents qui comptent, à commencer par le Brésil. Aussi les rapports entre les États-Unis et les autres nations d’Amérique continuent-ils en sous-main de se normaliser et de se rééquilibrer. De fait, B. Obama parvient à enrôler dans le traité transpacifique de libre-échange qu’il promeut en octobre 2015 les voisins et grands partenaires économiques que sont le Canada et le Mexique, mais aussi le Pérou et le Chili.
Si l’apaisement semble devoir toujours davantage prévaloir entre les différentes parties, il demeure autour du Venezuela des présidents Chavez puis Maduro un arc de résistance au magistère désormais plus discret des États-Unis ; regroupant Cuba, le Nicaragua de D. Ortega, l’Équateur de R. Correa et la Bolivie d’E. Morales, il reste prompt à dénoncer ce que les uns et les autres peuvent estimer participer de tentatives d’influence et de manœuvres de déstabilisation. Mais si les relations avec le pouvoir chaviste ou post-chaviste à Caracas demeurent exécrables, l’administration Obama parvient en revanche à les normaliser avec La Havane, opérant à partir de décembre 2014 un rapprochement historique qui vise à mettre un terme à plus d’un demi-siècle de guerre froide entre les deux nations.
8. La présidence Trump
« Rendre l’Amérique grande à nouveau » (Make America Great Again) et « L’Amérique d’abord » (America First), tels sont les deux slogans de campagne que Donald Trump entend mettre en application au lendemain de son investiture le 20 janvier 2017. Une cérémonie qui, accueillie par une gigantesque manifestation organisée par ses opposants, révèle la profonde division de la société américaine, accentuée par la personnalité très clivante du nouvel occupant de la Maison blanche.
Les déclarations à l’emporte-pièce du président, assumées comme « politiquement incorrectes », focalisent les débats et les commentaires des médias. La presse libérale (Washington Post et New York Times en tête) se pose en contre-pouvoir, concentrant ses attaques sur les possibles empiètements sur la démocratie américaine, tandis que, soutenu en particulier par la chaîne de télévision Fox News, D. Trump fait de CNN sa bête noire.
L’opposition à D. Trump rassemble surtout les États côtiers de l’Est (New York, Virginie, New Jersey, notamment) et de l’Ouest (Californie). Approuvé par seulement 45 % des Américains lors de sa prise de fonctions, raillé ou méprisé par l’intelligentsia, D. Trump bénéficie d’un soutien plus appuyé et fidèle dans certains États de l’Ouest (Wyoming, Idaho, Montana) et du Sud (Oklahoma, Alabama, Kentucky, Tennessee, Arkansas), et en Virginie occidentale, bassin houiller en crise qu’il a promis de ressusciter. Au-delà des fluctuations de sa popularité qui oscille autour de 40 % en moyenne au cours des deux années suivantes, il conserve un socle solide de partisans, y compris dans la vingtaine d’États très partagés dont ceux de la « ceinture de la rouille » (Ohio, Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan), qui ont été déterminants dans sa victoire.
8.1. Rompre avec l’héritage Obama
Sans aucune expérience politique, D. Trump s’entoure d’une équipe de collaborateurs à orientation fortement conservatrice, à l’instar du ministre de la Justice (Attorney General) Jeff Sessions, et issue en partie du monde des affaires, à commencer par le secrétaire d’État Rex Tillerson, P-DG d’ExxonMobil. Il en est de même pour le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, financier et ancien dirigeant de Goldman Sachs, et pour Wilbur Ross au Commerce. Mike Pompeo, lié au Tea Party au sein du camp républicain, prend la tête de la CIA tandis que le général à la retraite James N. Mattis, à la tête de l’US Central Command (CENTCOM) en 2010-2013, est nommé secrétaire à la Défense.
Au bureau exécutif, la promotion de son directeur de campagne, Steve Bannon, cofondateur de Breitbart News, site internet d’extrême droite, au poste de « conseiller stratégique » est la plus controversée, plus que les nominations du gendre du président, Jared Kushner, plus modéré, ou de Stephen Miller, autre éminence grise qui se distingue surtout pour son intolérance à l’égard des immigrés.
Alors que D. Trump choisit comme mode de communication privilégié la messagerie Twitter, réagissant ainsi à l’actualité et s’adressant directement et sans filtre aux Américains, l’exécutif peine à se stabiliser : de nombreux postes administratifs ne sont pas pourvus et une série de démissions et de révocations ponctue la première année de la présidence. Outre l’impréparation des nouveaux arrivants à la Maison Blanche, les positions divergentes entre le président et certains de ses collaborateurs, ainsi que l’enquête sur l’ingérence russe dans la campagne électorale contribuent à ce désordre au sommet de l’État. En témoignent les vicissitudes du Conseil de la Sécurité nationale (démission de Michael T. Flynn en février 2017, suivie de celle de H. R. McMaster, jusqu’à la nomination du néoconservateur John Bolton en mars 2018), le remplacement (juillet 2017) comme chef de cabinet de la Maison blanche de Reince Priebus par John F. Kelly, auparavant à la Sécurité intérieure, ou la révocation de R. Tillerson, remplacé par M. Pompeo (mars 2018). Les tensions au sein de la nouvelle équipe dirigeante et du camp républicain conduisent également à la « disgrâce » de S. Bannon (août 2017).
Repli nationaliste et déréglementation
L’une des toutes premières décisions du président Trump est de suspendre, au nom de la sécurité nationale et de la lutte antiterroriste, l’entrée sur le territoire américain des citoyens originaires de six pays majoritairement musulmans. Ce décret (executive order signé le 27 janvier et dénoncé comme un Muslim Ban par ses détracteurs) est toutefois bloqué par les juges avant d’être modifié, puis finalement validé par la Cour suprême en juin 2018. Cette dernière version restreint ou interdit l’entrée aux États-Unis des ressortissants de six pays : Yémen, Syrie, Libye, Iran, Somalie et Corée du Nord, interdiction étendue aux représentants officiels du Venezuela.
Cette mesure s’inscrit dans une politique plus générale contre l’immigration, qui vise particulièrement le Mexique avec le projet d’un mur frontalier, annoncé pendant la campagne électorale et source de fortes tensions entre les deux pays. La menace migratoire est un leitmotiv du « trumpisme » et la ligne dure sur l’immigration illégale s’impose, défendue en particulier par J. Sessions et S. Miller. Le gouvernement doit cependant revenir sur la décision de séparer de leurs familles les enfants d’immigrants détenus (juin 2018) tandis que le sort des « Dreamers », quelque 700 000 jeunes sans papiers régularisés à partir de 2012, reste en suspens.
Toujours dans la foulée de son investiture, satisfaisant les revendications des organisations anti-avortement (« pro-life »), dont les positions sont partagées par plusieurs de ses collaborateurs, au premier rang desquels le vice-président Mike Pence et le ministre de la Santé Alex Azar, le président remet à l’ordre du jour la question du droit à l’IVG, à l’instar de certains États républicains comme le Texas ou le Tennessee. Les subventions aux ONG internationales défendant cette dernière sont ainsi fortement diminuées. Cette question est cependant délicate, car susceptible d’éloigner son électorat féminin, déjà choqué par certains de ses propos sexistes et qui reste (pour plus d’un tiers) plutôt favorable à ce droit (« pro-choice »), alors que dans leur grande majorité, ses électeurs ne soutiennent guère une révision en profondeur de la politique de planning familial.
La volonté de D. Trump de défaire les réalisations de son prédécesseur s’illustre en premier lieu par la tentative de revenir sur la réforme de la santé en abolissant le Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) ou « Obamacare ». Mais la loi ne peut être supprimée faute d’un soutien du Sénat (à trois voix près) sur le texte censé la remplacer (juillet 2017) et, bien qu’obstruée ou sabotée dans certains de ses programmes, elle reste en vigueur dans ses grandes lignes.
Si ce désaveu est un premier échec, d’autres importantes mesures de déréglementation sont adoptées. La réforme fiscale – réduisant fortement l’impôt sur les sociétés et, dans une moindre mesure, l’impôt sur le revenu – est votée en décembre 2017, tandis que la loi Dodd-Frank de 2010, destinée à mieux réguler la finance à la suite de la crise de 2008, est assouplie en mars-mai 2018 par le Congrès.
La même logique, censée soutenir une croissance repartie à la hausse (2,2 % en 2017, estimée à 2,9 % en 2018), inspire la politique environnementale : la relance de projets d’oléoducs auparavant suspendus ou la levée de dispositifs de protection de la nature et de restrictions imposées à l’exploitation des ressources minières et gazières sont des exemples de cette vision, que l’annonce (juin 2017) du retrait attendu des États-Unis des accords de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique (COP21) ne fait que confirmer.
Avec la baisse systématique des dépenses sociales et environnementales au profit de la Défense et de la sécurité intérieure, les priorités du gouvernement sont clairement exprimées dans le premier projet de budget fédéral (baptisé « L’Amérique d’abord »), présenté par le président. Des exigences qui sont toutefois corrigées dans le texte adopté par le Congrès en mars 2018, après deux shutdowns, dont une forte réduction des fonds alloués à la construction du mur à la frontière avec le Mexique.
L’autre volet du programme « trumpien », axé sur des investissements massifs dans la rénovation des infrastructures, est reporté avant d’être remis sur la table l’année suivante, les principales orientations étant reprises dans le projet de budget pour 2019.
Un recours hésitant au protectionnisme
Outre les menaces de l’immigration et du terrorisme, celle que le libre-échange ferait peser sur l’industrie et l’emploi américains (délocalisations, importations chinoises) a été l’un des thèmes porteurs de la campagne électorale de D. Trump.
La révision de la politique commerciale devient ainsi l’un des principaux axes de la politique économique de la nouvelle administration. Elle se traduit tout d’abord (janvier 2017) par le désengagement des États-Unis du projet (non ratifié) d’accord transpacifique de libre-échange (Partenariat transpacifique, TPP), au risque d’affaiblir la position des États-Unis dans cette région et, paradoxalement, de renforcer celle de la Chine. Le président chinois Xi Jinping profite ainsi de cette occasion pour s’afficher comme le champion du libre-échange, en promouvant notamment le projet alternatif de partenariat économique régional global (RCEP) réunissant plusieurs pays d’Asie et du Pacifique autour de l’ASEAN.
Également pourfendu, l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain, unissant les États-Unis, le Canada et le Mexique depuis 1993) échappe cependant à une refonte trop périlleuse et laisse la place, après une révision à la marge de certaines clauses et la suppression significative du terme « libre-échange », au United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA, octobre 2018).
8.2. Les élections de mi-mandat : un référendum sur le « trumpisme » ?
Si la sanction du président en place lors des élections intermédiaires au Congrès est une tradition dans l’histoire politique des États-Unis, les élections de novembre 2018 prennent une dimension particulière, deux ans après l’élection de D. Trump. Ce dernier s’engage directement dans la campagne en apportant son soutien aux candidats qui lui sont le plus dévoués tandis que le parti démocrate tente de se remettre du traumatisme de la défaite de 2016 en surmontant ses divisions et en se concentrant sur la défense de tout ce qui menace toujours d’être détruit comme l’ACA (Obamacare), ou les droits des minorités et des femmes. Toujours marqué par une forte polarisation, le scrutin est troublé notamment par l’interception, entre le 22 et le 29 octobre, de colis piégés adressés à des adversaires politiques du président.
Avec un gain net d’une quarantaine de sièges à la Chambre des représentants, le parti démocrate fait mieux qu’en 1982 (présidence Reagan) et 2006 (second mandat de G. W. Bush) mais les républicains conservent le contrôle du Sénat avec 53 sièges. S’ils ravissent 4 sièges aux démocrates (Indiana, Missouri, Dakota du Nord et, d’extrême justesse, Floride) ces derniers limitent leurs pertes et se maintiennent notamment dans certains des États du Midwest ainsi qu’en Pennsylvanie. Dans les États, le parti démocrate progresse également en prenant le contrôle de 7 gouvernorats et de 6 chambres contrôlés par le GOP, mais ses gains restent modestes.
Qualifiée de « vague » par certains, la victoire démocrate – qui se traduit aussi par une avance de près de 9 millions de voix – est ainsi moins ample qu’escompté, notamment par rapport aux Midterms de 2010, remportées par les républicains.
Dans le sillage de ces élections, D. Trump annonce un remaniement de son cabinet : le ministre de la Justice J. Sessions, l’un de ses premiers soutiens mais qui s’était récusé dans l’enquête sur l’ingérence russe, est poussé à la démission tandis que John F. Kelly, dont les relations avec le président s’étaient fortement dégradées, quitte également le gouvernement.
La première réunion du nouveau Congrès, le 3 janvier 2019, suivie de l’élection de Nancy Pelosi à la présidence de la Chambre des représentants, intervient alors qu’un nouveau shutdown a été provoqué le 22 décembre par le président, toujours intransigeant sur son projet de mur entre les États-Unis et le Mexique pour lequel il réclame quelque 5 milliards de dollars.
8.3. La politique extérieure : un rejet du multilatéralisme au risque de l’isolement
Les critiques indiscriminées portées par le président sur les organisations internationales – Nations unies, OTAN, Union européenne ou OMC –, le manque de visibilité et les contradictions de la politique extérieure américaine au cours des premiers mois de la présidence suscitent interrogations, crainte, scepticisme ou attentisme.
La priorité donnée à la la souveraineté nationale conduit non seulement à la dénonciation d’accords internationaux, mais aussi à la révision de l’engagement américain dans le système des Nations unies comme l’illustrent le retrait de l’Unesco, du Conseil des droits de l'homme ou l’annonce d’une réduction de la participation financière aux programmes onusiens.
Étranger aux subtilités de la diplomatie, D. Trump donne la priorité au marchandage (au « good deal ») et aux accords bilatéraux, une politique qui s’inscrit dans une profonde hostilité au multilatéralisme, principale caractéristique de sa politique étrangère.
D’aucuns y voient la marque de la « stratégie du fou », qui consiste à perturber le jeu établi par son imprévisibilité, en brandissant sans cesse de nouvelles revendications pour déstabiliser ses adversaires, les obliger à plier ou à faire des concessions.
Un allié embarrassant pour l’Europe
L’élection de D. Trump a été fraîchement accueillie dans de nombreux pays européens, parmi lesquels la France – dont le nouveau président, E. Macron, noue toutefois des rapports cordiaux, mais peu convaincants, avec son homologue américain – et l’Allemagne, avec laquelle les relations s’avèrent en revanche plutôt exécrables. Alors que l’Union européenne connaît des tensions internes sans précédent, les États-Unis soutiennent la sortie du Royaume-Uni de l’UE, allant jusqu’à prôner un « Brexit dur » sans pour autant proposer un accord de libre-échange américano-britannique, projet caressé à Londres.
Dans une vision purement commerciale, le magnat de l’immobilier considère avant tout l’Union européenne comme une bureaucratie inutile et un concurrent, « instaurée pour tirer avantage des États-Unis, pour attaquer notre cochon-tirelire », une formulation choisie lors d’un de ses meetings (juin 2018), moins inquiétante que celle d’« ennemi » (au même titre que la Chine et, « dans une certaine mesure », la Russie) utilisée dans une interview à CBS (juillet). Ces tensions se traduisent par la taxation des importations d’acier et d’aluminium (1er juin 2018), premier jalon vers un conflit potentiellement plus grave que la Commission européenne s’efforce de désamorcer.
Semblant considérer ses alliés comme un fardeau, il les somme également d’acquitter leur part dans la sécurité collective et sème le doute au sein de l’organisation atlantique. Mais sa participation au sommet de l’OTAN (11-12 juillet 2018) se veut rassurante. La déclaration commune rappelle notamment « le lien transatlantique immuable et infrangible qui unit l’Europe et l'Amérique du Nord pour que celles-ci fassent front ensemble contre les menaces et les défis, d'où qu’ils viennent », « l’engagement indéfectible en faveur de la défense collective énoncé dans l’article 5 du traité de Washington » et souligne le rôle déstabilisateur de la Russie qui « viole le droit international, mène des activités militaires provocatrices et cherche à affaiblir nos institutions et à semer la désunion ».
La nature des relations entre les États-Unis et la Russie, que d’aucuns voient avec pessimisme comme une convergence de vues vers une transformation de l’ordre mondial fondé sur de purs rapports de force, reste cependant encore largement une inconnue.
L’ambiguïté des relations avec la Russie
Accusée de s’être immiscée dans la campagne électorale américaine dans le but de discréditer la candidate démocrate H. Clinton et sanctionnée pour cette raison par le Congrès, la Russie, avec laquelle le candidat Trump annonce vouloir normaliser les relations, met ce dernier en porte-à-faux. Visé par l’enquête du FBI sur cette affaire qu’il ne cesse de dénoncer comme une « chasse aux sorcières », il doit montrer sa fermeté sur plusieurs dossiers urgents (Ukraine, Syrie, désarmement) tout en clarifiant une stratégie particulièrement floue.
Les deux présidents se rencontrent pour la première fois en marge du sommet du G20 de juillet 2017 et, un an plus tard, une réunion officielle se tient à Helsinki, quelques jours après le sommet de l’OTAN. Assombrie par l’affaire de l’ingérence russe, cette séance semble tourner à l’avantage de V. Poutine, D. Trump adoptant un ton résolument conciliant. Devant les protestations, jusque dans les rangs des républicains, il tente de rectifier ses déclarations.
Le traité INF (Intermediate-range nuclear forces treaty) signé par M. Gorbatchev et R. Reagan en 1987, est une autre source de litige. Depuis 2014, les États-Unis accusent la Russie de ne pas respecter l’accord : en octobre 2018, D. Trump annonce ainsi le possible retrait des États-Unis du traité, une décision qui pourrait être principalement motivée, selon certains, par la nécessité de ne pas se lier les mains en Asie.
Les relations sino-américaines sous tension et la crise nord-coréenne
Confirmant le principe d’« une seule Chine », D. Trump rencontre pour la première fois Xi Jinping en avril 2017, après une visite du secrétaire d’État à Pékin. Un accord commercial sur un certain nombre de produits est annoncé dans la foulée. Alors qu'il est présenté par l’administration américaine comme une avancée dans la correction des déséquilibres commerciaux entre les deux pays (375 milliards de dollars de déficit commercial en 2017), les désaccords l’emportent. L’année suivante, accusant la Chine de pratiques « déloyales » et de « vol de propriété intellectuelle », les États-Unis imposent ainsi une taxation de 25 % sur un ensemble de produits représentant un montant annuel de 50 milliards de dollars. Avec la riposte de Pékin et la menace américaine d’une extension des tarifs douaniers, les deux États semblent bien entrer dans un bras de fer commercial.
Étroitement liée aux relations sino-américaines, la question nord-coréenne réapparaît subitement et dramatiquement à l’été 2017. Les nouveaux essais balistiques effectués par la Corée du Nord, suivis du renforcement des sanctions internationales, entraînent les présidents américain et nord-coréen dans une escalade verbale inhabituelle, faite d’invectives et de menaces. Le double moratoire que prône la Chine (gel des exercices militaires conjoints américano-sud-coréens contre celui des programmes militaires nord-coréens) est rejeté par Washington et la crise se prolonge jusqu’à la fin de l’année avant de se résorber.
Le sommet intercoréen d’avril 2018, puis la rencontre entre Kim Jong-un et D. Trump à Singapour, en juin, marquent une étape vers l’apaisement même si la déclaration d’intention en vue d’une dénucléarisation de la péninsule reste encore vague. Les exercices militaires sont cependant suspendus, tandis que les deux Corées confirment leur engagement en faveur d’une détente lors d’un nouveau sommet en septembre.
Moyen-Orient : l’axe anti-iranien
En février 2017, D. Trump reçoit Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche, mettant ainsi fin à la mésentente persistante entre Israël et les États-Unis sous la présidence Obama. À cette première réunion succèdent plusieurs autres rencontres et l’annonce du transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, une décision votée par le Congrès américain en 1995 et systématiquement repoussée par les prédécesseurs de D. Trump. Parallèlement, la suspension de la participation financière américaine à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) fragilise davantage encore un processus de paix déjà dans l’impasse, même si le principe de la « solution des deux États » reste officiellement à l’ordre du jour.
À cette alliance traditionnelle se greffe celle, également au plus bas, avec l’Arabie saoudite, à laquelle le président américain réserve son premier déplacement à l’étranger, en mai 2017. Le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, se rend ensuite à Washington, en mars 2018. L’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul (octobre 2018) embarrasse la Maison-Blanche mais, malgré le vote par le Sénat (décembre) de deux résolutions hostiles à Riyad, cette relation privilégiée reste centrale.
L’ennemi commun à isoler est en effet l’Iran, redevenu l’adversaire principal de Washington et dont les interventions extérieures sont présentées comme la principale source de déstabilisation. À la satisfaction de ses alliés israélien et saoudien, cette politique d’endiguement conduit ainsi au retrait des États-Unis, annoncé en mai 2018, de l’accord international sur le nucléaire iranien, signé en 2015, et au rétablissement des sanctions – en août puis en novembre, pour les transactions concernant le pétrole –, qui, du fait de leur extraterritorialité, menacent également les entreprises européennes.
En Iraq et en Syrie, l’intervention des États-Unis contre l’organisation « État islamique », qui perd son assise territoriale après sa défaite à Mossoul et à Raqqa entre juillet et octobre 2017, est confirmée dans un premier temps, tandis que l’appui aux forces kurdes des « Forces démocratiques syriennes » est maintenu malgré l’opposition de la Turquie, engagée militairement dans le nord de la Syrie depuis août 2016.
Cependant, la guerre en Syrie ayant désormais tourné à l’avantage du régime d’Asad, avec le soutien de la Russie essentiellement (mais aussi de l’Iran), les États-Unis semblent prendre acte ce nouveau rapport de force tout en exigeant la fin de la présence iranienne. Par ailleurs, ils doivent ménager la Turquie, autre acteur déterminant dans la région – et allié des États-Unis au sein de l’OTAN.
L’annonce par D. Trump, en décembre 2018, d’un retrait des troupes américaines de Syrie (quelque 2 000 hommes) en est la conséquence. Contestée par le Pentagone, cette décision provoque la démission du secrétaire à la Défense, J. M. Mattis, tandis que les États-Unis doivent rassurer leurs alliés arabes et Israël (janvier 2019).
8.4. L’élection présidentielle de 2020
Le 3 novembre a lieu l’élection présidentielle, opposant principalement Donald Trump, président sortant du Parti républicain, et le démocrate Joe Biden, vice-président sous Barack Obama. La crise sanitaire ayant entraîné de nombreux votes par correspondance ou par anticipation, le comptage des voix est particulièrement long. Le 7 novembre, Joe Biden est donné vainqueur par l’agence Associated Press, malgré l’annonce de nombreux recours juridiques de la part des républicains.