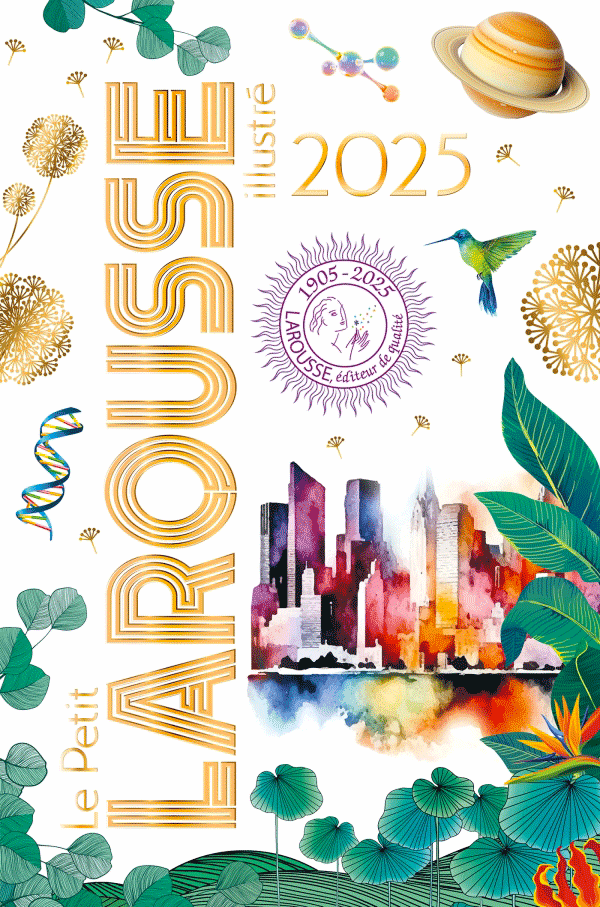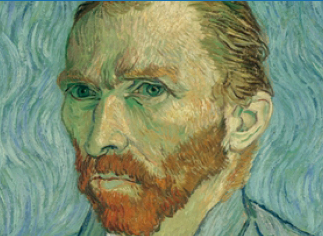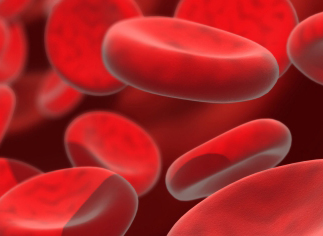John Fitzgerald Kennedy

Homme d'État américain (Brookline, près de Boston, Massachusetts, 1917-Dallas 1963).
1. Un jeune patricien de Nouvelle-Angleterre
1.1. Le clan Kennedy
Pur produit de l'establishment catholique aux États-Unis, John Fitzgerald Kennedy va accomplir le parcours type d'un fils de famille. L'histoire de son « clan » commence en 1849, lorsque débarque à East Boston Patrick Kennedy, immigrant irlandais. Ce dernier est le père de Joseph Patrick, alias Joe Kennedy, homme d'affaires qui a neuf enfants. John Fitzgerald, le deuxième, est diplômé de Harvard.
Sous l'influence de Joe, les enfants apprennent à rester unis, à former un clan qui se retrouve dans le malheur comme dans le bonheur.
1.2. Un élève médiocre

John suit des études dans les meilleurs établissements d'enseignement : Choate Academy à Wallingford (Connecticut), la London School of Economics, Princeton, enfin Harvard. Ses résultats scolaires et universitaires ne sont pas brillants. En 1937, puis en 1939, son père lui fait visiter l'Europe, et sa thèse de science politique, « Why England Slept » – sujet d'une actualité brûlante – remporte un beau succès de librairie.
1.3. L'officier de marine héroïque
De retour aux États-Unis, John s'inscrit à Stanford, où il ne reste que quelques mois, et part pour l'Amérique du Sud. Quand les États-Unis entrent en guerre, il parvient, malgré une colonne vertébrale fragile, à obtenir un poste de combattant dans la marine ; en 1943, il accomplit un exploit dans le Pacifique en sauvant plusieurs de ses camarades, en dépit de ses propres blessures. Il termine la guerre à l'hôpital et en convalescence.
2. L'ascension politique
2.1. Représentant démocrate de l'État du Massachusetts (1946-1953)
En 1945, la politique l'attire, à moins que son père l'ait convaincu qu'après la mort de l'aîné il se devait de briguer un mandat. De fait, la politique est une passion familiale, et l'esprit de clan n'est pas absent : « Je suis entré dans la vie politique, dira-t-il plus tard, parce que Joe est mort. Si quelque chose m'arrivait demain, mon frère Bobby se présenterait à mon siège de sénateur. Si Bobby mourait, Teddy lui succéderait. » John commence donc par tenter sa chance dans un quartier ouvrier de Boston lors des élections à la Chambre fédérale des représentants. Il dépense sans compter, fait jouer les relations de sa famille, utilise ses amis de Harvard, mène une très efficace campagne et se fait élire.
Réélu en 1948 et en 1950, il fait partie des libéraux et s'oppose, par exemple, à la loi Taft-Hartley.
2.2. Sénateur du Massachusetts (1953-1960)
En 1952, le voilà candidat aux élections sénatoriales ; son adversaire s'appelle Henry Cabot Lodge, un grand nom du Massachusetts, le président du Comité national républicain. Les Kennedy, frères, sœurs et conjoints, se lancent dans la bataille. Si, dans l'élection présidentielle, Dwight David Eisenhower remporte le Massachusetts par plus de 200 000 voix, Lodge, lui, est battu dans l'élection au poste de sénateur. En 1958, contre un rival moins prestigieux, Kennedy sera réélu triomphalement, avec une avance de plus de 870 000 suffrages.
Le sénateur Kennedy se marie en 1953 avec Jacqueline Lee Bouvier (1924-1994), et subit l'année suivante deux opérations délicates, que ses blessures de guerre ont nécessitées. Il profite de sa convalescence pour écrire Profiles in Courage (1956), où il trace le portrait de quelques sénateurs américains. La maladie l'empêche de voter lorsqu'en 1954 Joseph McCarthy est censuré ; sans doute est-il hostile, plus que ses électeurs, aux excès du sénateur du Wisconsin, mais son frère Robert sert quelques mois comme conseil juridique auprès du sous-comité de McCarthy.
Émergence d'une nouvelle personnalité politique
À la fin de l'année 1955, John Fitzgerald Kennedy devient une personnalité de premier plan. Il propose des mesures législatives qui visent à améliorer la condition des travailleurs, mais celles-ci sont rejetées ou modifiées. Il prend la parole sur la limitation des importations de pétrole et de laine, sur l'aide à l'étranger, sur les subventions fédérales aux villes, sur les droits civiques. Dès 1956, il réclame l'indépendance de l'Algérie, critique le président Eisenhower et sa politique chinoise, intervient plusieurs fois dans les débats de politique étrangère.
Vers la présidence des États-Unis…
C'est que John Fitzgerald Kennedy a décidé, dès ce moment-là, de se présenter à l'élection présidentielle. À la convention démocrate de 1956, Adlai Stevenson reçoit l'investiture du parti. Comme candidat à la vice-présidence, John Fitzgerald Kennedy est battu de peu par Estes Kefauver (1903-1963).
Son succès aux sénatoriales de 1958 augmente ses chances ; le 2 janvier 1960, il annonce qu'il sera candidat dans une dizaine d'élections primaires. Il élimine l'un de ses rivaux, Hubert Horatio Humphrey, en remportant la victoire dans le Wisconsin et surtout en Virginie-Occidentale, État foncièrement protestant. Reste le sénateur Lyndon Baines Johnson, qui ne s'est pas présenté aux primaires et qui compte beaucoup d'amis et de partisans chez les démocrates modérés. À la convention de Los Angeles, l'organisation Kennedy, dirigée par Robert, fonctionne parfaitement : John est investi dès le premier tour de scrutin. Songeant au poids politique de Lyndon Baines Johnson, il propose à ce dernier – à la surprise de son propre frère – d'être candidat à la vice-présidence. Lyndon Baines Johnson accepte.
… pour remettre l'Amérique en mouvement
Chez les républicains, le candidat à la présidence est Richard M. Nixon, le bras droit et l'héritier du général Eisenhower. Les sondages lui donnent l'avantage jusqu'à la fin de septembre : les Américains ne paraissent croire que modérément au projet de « Nouvelle Frontière » du démocrate, une invitation à remettre l'Amérique en mouvement ; ils préfèrent Richard M. Nixon, qui possède une certaine expérience du pouvoir.
Puis, dans les dix dernières semaines de la campagne, quatre débats télévisés mettent aux prises les deux adversaires : le charme, l'esprit de repartie, les connaissances précises de John Fitzgerald Kennedy impressionnent, d'autant plus que Richard M. Nixon est particulièrement maladroit. Le lendemain des élections, un avantage de 100 000 voix sur 68 millions de suffrages exprimés donne à John Fitzgerald Kennedy la présidence. Celui-ci a bénéficié du soutien des Noirs, qui ont applaudi l'appui du candidat au pasteur Martin Luther King – alors emprisonné en Géorgie. Il a surtout inspiré confiance à cette Amérique, riche mais inquiète, puissante mais menacée, qui s'incarne dans cet homme de quarante-trois ans.
3. Le 35e président des États-Unis (1960-1963)
3.1. Mille jours pour réussir
Kennedy prévient les Américains : il a fallu cent jours à Roosevelt pour recueillir les premiers fruits du New Deal ; il en faudra mille au nouveau président pour réussir. Comme son illustre prédécesseur, il s'entoure de jeunes collaborateurs, sortis des universités de la côte Est, et attache une importance particulière à la communication politique.
3.2. Politique intérieure : un bilan décevant
Elle vise à atteindre deux objectifs : faire sortir les États-Unis de la récession et stimuler la croissance économique – aider les groupes socio-économiques défavorisés. Or, il est clair qu'en trois ans de pouvoir les résultats ont été médiocres. Certes, 5 milliards de dollars sont alloués à la construction de logements sociaux ; le salaire minimum est porté de 1 à 1,25 dollar par heure ; 400 millions de dollars sont attribués aux régions victimes de la stagnation économique ; les sociétés sidérurgiques qui voulaient augmenter leurs prix, en dépit de la politique anti-inflationniste de la Maison-Blanche, se soumettent à la volonté du président ; enfin, le Trade Expansion Act de 1962 réduit les droits de douane de 50 % et quelquefois de 100 % sur les produits échangés avec le Marché commun.
Échec en matière de relance économique
Mais les échecs sont plus nombreux que les réussites : le projet d'aide fédérale aux écoles, le contrôle de la production du blé, l'assistance médicale gratuite aux personnes âgées (Medical Care), la création au sein du cabinet d'un département des Affaires urbaines et cet allégement fiscal que les conseillers économiques du président jugent indispensable pour relancer l'expansion, toutes ces mesures se heurtent à l'hostilité ou à l'inaction du Congrès.
En effet, si les démocrates sont majoritaires dans les deux Chambres fédérales, ils n'éprouvent pas tous des sympathies pour John Fitzgerald Kennedy ; les conservateurs du Sud, qui détiennent un pouvoir d'autant plus grand que leurs circonscriptions sont « sûres », s'unissent aux républicains pour empêcher le passage d'une législation progressiste. Pourtant, John Fitzgerald Kennedy s'est efforcé de rassurer le monde des affaires : il refuse de suivre une politique de grosses dépenses ; il tâche de redonner confiance dans le dollar.
La lutte pour les droits civiques
Le président fait ce qu'il peut pour tenir ses promesses envers la communauté noire. L'attorney général, Robert Francis Kennedy, est actif ; il protège les « Freedom Riders », ces libéraux blancs et noirs qui se rendent dans le Sud en autocars pour abattre directement et immédiatement les dernières traces de la ségrégation. En novembre 1962, il est interdit de procéder à une discrimination raciale dans les logements construits ou achetés avec des fonds fédéraux. La Maison-Blanche emploie la force pour contraindre l'université du Mississippi à accepter la présence de James H. Meredith, dont la faute impardonnable est d'être le premier étudiant noir à vouloir pénétrer dans cet établissement. En 1963, dans sa campagne en faveur des droits civiques, le pasteur King sait qu'il peut compter sur l'appui du président Kennedy.
Mais celui-ci ne parvient pas à faire voter une nouvelle loi sur les droits civiques. L'opposition d'une partie du Congrès paraît irréductible. Aussi faut-il bien admettre que le programme de 1960 n'est toujours pas, trois ans plus tard, réalisé.
3.3. Politique extérieure : une nouvelle approche
Endiguer l'expansion du communisme dans le tiers-monde
Au début de 1961, la CIA (Central Intelligence Agency) soumet un projet de débarquement à Cuba, qui serait exécuté par des exilés cubains ; les États-Unis fourniraient une aide matérielle et politique. Ce projet, préparé sous la présidence d'Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy l'accepte finalement, après avoir beacoup hésité.
Le débarquement a lieu le 17 avril, dans la baie des Cochons. L'échec est total : Fidel Castro capture 1 200 hommes et tire le plus grand parti de cette agression. Les États-Unis sortent de l'aventure affaiblis et ils ont été mis en accusation par l'opinion américaine et internationale. De cette tragique erreur, John Fitzgerald Kennedy a assumé l'entière responsabilité ; il a même consenti à livrer du matériel aux Cubains, malgré l'embargo, pour obtenir la libération des prisonniers.
En mai, il fait voter un crédit de 500 millions de dollars pour aider l'Amérique latine dans le cadre d'une « Alliance pour le progrès ». Créé en mars 1961, le Peace Corps (Corps de la paix)– armée de volontaires qui enseignent des méthodes agricoles dans les régions en voie de développement – contribue à améliorer l'image des États-Unis. Même limités, les résultats de cette politique valent d'être soulignés.
Entre crise et détente avec l'Union soviétique
La seconde crise de Cuba touche aux relations entre l'Union soviétique et les États-Unis. Dès 1961, John Fitzgerald Kennedy se déclare partisan d'une réponse graduelle si les Soviétiques déclenchent une attaque contre l'Ouest ; en conséquence, il accroît les forces conventionnelles. En même temps, il cherche à rattraper le retard que son pays a pris sur l'URSS dans le domaine des expériences spatiales et à gagner la course à la conquête de la Lune.
En juin 1961, il rencontre à Vienne Nikita S. Khrouchtchev : les deux hommes s'entendent sur la neutralisation du Laos, mais ne tombent d'accord sur aucun autre problème. Bien plus, l'Union soviétique déclenche une nouvelle crise à Berlin. John Fitzgerald Kennedy demande alors et obtient du Congrès la mobilisation de 250 000 réservistes ; les Soviétiques préfèrent la prudence et se contenteront, en août, de construire le mur de Berlin.

Les négociations sur le désarmement progressent peu ; le 31 août, Moscou décide de reprendre ses expériences nucléaires. Les Américains répliquent qu'ils feront de même si un traité d'interdiction n'est pas immédiatement signé. Les Russes refusent. Les relations entre les deux pays se tendent, lorsqu'en octobre 1962 éclate la crise de Cuba. Des photographies aériennes révèlent que l'URSS installe une quarantaine de missiles nucléaires à moyenne portée. Le 22, dans un discours télévisé, John Fitzgerald Kennedy annonce le blocus des côtes cubaines pour tous les bateaux transportant des armes offensives ; mais, en même temps, il négocie avec Nikita S. Khrouchtchev, qui, le 28, s'incline.
Sauvegarder la coexistence pacifique
Les États-Unis viennent de remporter une belle victoire, avec l'aide de leurs alliés. Une étape de la guerre froide s'achève. Russes et Américains s'orientent vers une nouvelle conception de leurs relations : chaque camp sait jusqu'où il peut aller s'il ne veut pas affronter l'autre directement ; tous les deux s'efforcent d'éviter une guerre nucléaire.
En 1963, l'Union soviétique propose que les puissances nucléaires renoncent à leurs essais ; les États-Unis acceptent. C'est que, désormais, la puissance de la Chine hante les imaginations. Les Chinois dénoncent la complicité objective des deux super-grands, qui, selon eux, se partagent le monde aux dépens des autres nations. Aussi s'efforcent-ils de brouiller les cartes.
L'engagement au Viêt Nam
L'Asie du Sud-Est devient un problème brûlant de la politique américaine. En juillet 1962, le Laos est neutralisé à la suite de la conférence de Genève, mais, au Viêt Nam du Sud, le régime de Ngô Dinh Diêm lutte contre des maquis communistes. John Fitzgerald Kennedy envoie des armes, des hélicoptères, des conseillers militaires, des soldats enfin (il y a 16 000 Américains en novembre 1963). Quand Ngô Dinh Diêm est assassiné – quelques jours avant John Fitzgerald Kennedy –, Saigon connaît une période d'instabilité et une vacance de pouvoir qui déroutent les États-Unis. John Fitzgerald Kennedy ne veut pas abandonner cette partie du monde à ce qu'il croit être l'influence chinoise ; sa politique est hésitante et ouvre la voie à toutes les aventures. Il est vrai que la Chine ne fait rien pour rassurer : en octobre 1962, à propos de la question des frontières himalayennes, elle entre en conflit avec l'Inde, que les États-Unis soutiennent.
Un « grand dessein » pour l'Europe…

John Fitzgerald Kennedy se préoccupe de l'évolution de la situation européenne. Ses voyages lui donnent, dans cette partie du monde, une popularité qui n'a d'égale que celle de sa femme. Quand il crie à Berlin en 1963 « Ich bin ein Berliner », il devient un héros en Allemagne. Le président veut réaliser un « grand dessein » : unir par des intérêts communs son pays et la Communauté européenne élargie à la Grande-Bretagne. Il imagine une zone de libre-échange qui permettrait aux Américains d'écouler leurs produits et de limiter leurs dépenses militaires.
… contrecarré par le général de Gaulle
Mais la France se montre un partenaire difficile : elle fait exploser sa première bombe atomique en 1960 et refuse en 1963 de signer le traité sur les essais nucléaires ; elle ne ménage pas son appui dans les affaires de Cuba ou de Berlin, mais prend ses distances à l'égard de l'OTAN.
En janvier 1963, le général de Gaulle met son veto à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun et signe un traité de réconciliation avec le chancelier Konrad Adenauer. Quelques mois plus tard, John Fitzgerald Kennedy se rend en Europe pour rassurer l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne sur les intentions de son pays, qui s'engage une nouvelle fois à protéger l'Europe occidentale contre une éventuelle agression soviétique.
4. Le mystère Kennedy

Sur le trajet de John Fitzgerald Kennedy, en visite à Dallas le 22 novembre 1963, trois coups de feu retentissent. Atteint en pleine tête dans sa limousine, le président s'écroule, aux côtés de son épouse Jacqueline, épargnée par l'attentat. Le 29 novembre 1963, le nouveau président Lyndon B. Johnson crée une commission d'enquête, qui est placée sous la responsabilité du juge Earl Warren, président de la Cour suprême. Dix mois plus tard, le rapport Warren conclut au geste d'un déséquilibré agissant en son nom personnel : Lee Harvey Oswald (1939-1963), qui, peu après, est lui-même abattu par Jack Ruby (1911-1967), dont le mobile n'a jamais été clairement établi.
Aucune hypothèse n'a été écartée pour expliquer le meurtre du président américain. On y a vu tour à tour la main de l'URSS, celle de la Mafia, celle des exilés cubains anticastristes, celle des sudistes d'extrême droite. Les soupçons pesèrent même sur le FBI et sur la CIA. L'une des plus grandes énigmes du xxe siècle n'a jamais trouvé de réponse définitive.
Pour en savoir plus, voir l'article États-Unis : vie politique depuis 1945.