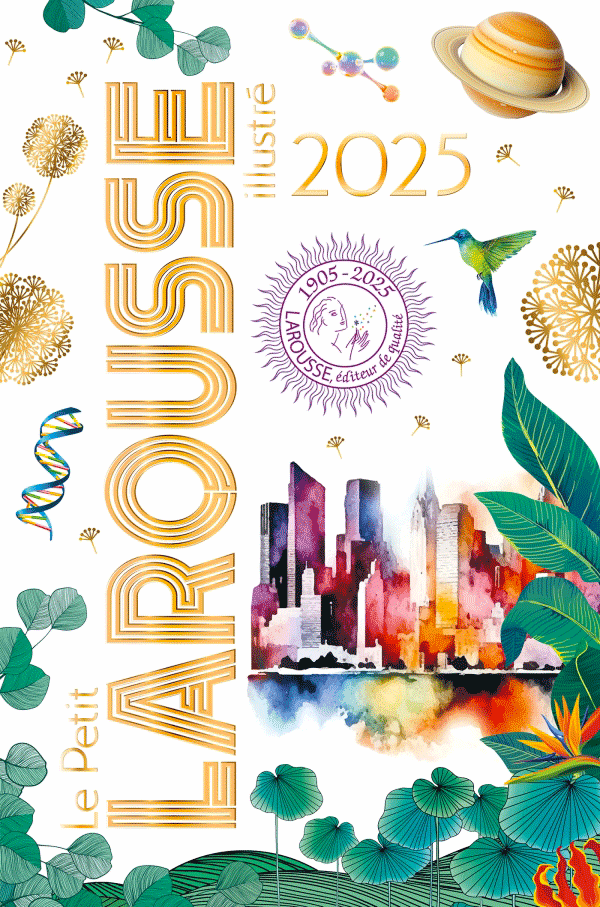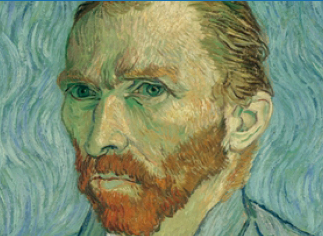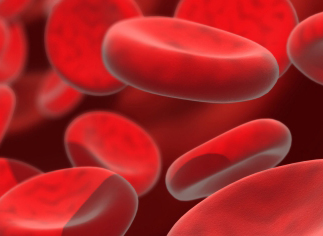Grande-Bretagne : cinéma britannique
Par ses multiples crises tout au long du siècle, le cinéma britannique pose la question de l'existence d'un cinéma national.
Il a, dès l'origine, souffert de la concurrence étrangère, française jusqu'en 1914, puis américaine – cette dernière en raison de la communauté de langue et de la force économique que l'industrie de Hollywood a su développer depuis les années 1920.
Un déficit d'image de marque
Dans les années 1950, François Truffaut n'hésitait pas à écrire : « Dire que le cinéma anglais est mort serait excessif puisque aussi bien il n'a jamais existé. Le film anglais actuel est incolore, inodore et sans saveur particulière. » Pourtant, dix ans plus tard, en 1966, il ira réaliser son Fahrenheit 451 à Londres, et en langue anglaise. Il est vrai qu'entre-temps la génération des « jeunes gens en colère » avait donné des films dont on pouvait difficilement dire qu'ils étaient sans saveur (Samedi soir et dimanche matin, de Karel Reisz, 1960 ; Un goût de miel, de Tony Richardson, 1961). Et dans les années 1980, les longs métrages des réalisateurs issus de la télévision (Peter Greenaway, Kenneth Loach, Stephen Frears, Terence Davies et bien d'autres) ont spectaculairement renouvelé la production britannique.
S'il est un moyen d'expression peu considéré par l'intelligentsia britannique – qui lui préfère le théâtre ou la littérature –, le cinéma anglais a donc permis la naissance, à intervalles réguliers, d'œuvres fortes et originales, malgré une tendance dominante à l'académisme et la redoutable concurrence des studios américains.
Cinéma britannique et littérature
La tentation littéraire a toujours existé dans la production anglaise : dès les années 1910, on adapte Oliver Twist (Thomas Bentley, 1912) et Hamlet (interprété par John Forbes Robertson, 1913), deux titres que l'on retrouve dans les années 1940 (Oliver Twist, David Lean, 1948 ; Hamlet, Laurence Olivier, 1948). Charles Dickens et William Shakespeare seront ainsi régulièrement adaptés ; David Lean a signé en 1946 une version mondialement célèbre des Grandes Espérances de Charles Dickens.
Une école documentaire
La grande force du cinéma britannique demeure, toutes époques confondues, son inspiration documentaire et son fort ancrage dans la société. Cette caractéristique apparaît dès les débuts de la production anglaise, avec les œuvres des pionniers de l'école de Brighton (Fire !, de James Williamson, 1902 ; Rescued by Rover, de Cecil Hepworth, 1905 : deux films tournés en décors naturels, ce qui reste exceptionnel au début du siècle). Elle se renforce au début du parlant avec l'œuvre du grand documentariste et théoricien du cinéma John Grierson (Drifters, 1929), qui rassemble autour de lui quelques auteurs marquants comme Basil Wright (Windmill in Barbadoes, 1933), Paul Rotha (Shipyard, 1934) et l'Américain Robert Flaherty, à qui il permet de réaliser l'Homme d'Aran (1934), l'un des chefs-d'œuvre incontestés du film documentaire. Même les films romanesques des années 1940 et 1950 porteront cette empreinte réaliste, notamment Brève Rencontre de David Lean (1945).
Les œuvres personnelles du free cinema des années 1960 s'inscrivent également dans ce courant documentaire, ainsi que le montrent la Solitude du coureur de fond, de Tony Richardson (1962), et le Prix d'un homme, de Lindsay Anderson (1963). C'est enfin une vision sociale très critique de l'Angleterre contemporaine que l'on retrouve dans les films de Kenneth Loach (Family Life, 1971 ; Looks and Smiles, 1981) et de Stephen Frears (Prick up Your Ears, 1986).
Un cinéma de genre
Le cinéma britannique s'est illustré dans la reconstitution historique (la Vie privée d'Henri VIII, du producteur et réalisateur Alexandre Korda, avec Charles Laughton, 1933), le film de guerre (le Pont de la rivière Kwaï, de David Lean, 1957 ; les Canons de Navarone, de Jack Lee Thompson, 1960), le film fantastique, spécialité des studios Hammer dans les années 1950 (films de Terence Fisher, comme Frankenstein s'est échappé, 1957, et le Cauchemar de Dracula, 1958), et, bien sûr, tout au long de son histoire, le film policier – avec notamment la période anglaise d'Alfred Hitchcock, avant son départ pour Hollywood, de Chantage (Blackmail, 1929) à Une femme disparaît, 1938.
Le cinéma britannique a également créé un genre spécifique, le film d'humour, très riche dans les années d'après-guerre avec des films comme Passeport pour Pimlico (Henry Cornelius, 1949), Whisky à gogo (Alexandre Mackendrick, 1948) et le chef-d'œuvre du genre, Noblesse oblige (Kind Hearts and Coronets, Robert Hamer, 1949). Dans la même lignée, le burlesque et l'absurde marquent les films plus contemporains des Monthy Python (Sacré Graal, 1974 ; la Vie de Brian, 1979 ; le Sens de la vie, 1982), le film le plus célèbre de cette école étant Brazil, de Terry Gilliam (1985).
Londres-Hollywood, et retour
La Grande-Bretagne a marqué de son empreinte toute l'histoire du cinéma hollywoodien, lui fournissant nombre d'acteurs – Vivien Leigh, Richard Burton, Sean Connery, Michael Caine, Jeremy Irons – et de réalisateurs, tels Alfred Hitchcock et Charlie Chaplin, pour ne citer que les plus célèbres. Plusieurs superproductions américaines ont été mises en scène par des réalisateurs anglais (Blade Runner, de Ridley Scott, en 1982), et certains films britanniques à grand spectacle ont surpassé, dans leur succès auprès du public, les films de Hollywood : ainsi Lawrence d'Arabie, de David Lean (1962), la Bataille d'Angleterre, de Guy Hamilton (1969), et Gandhi, de Richard Attenborough (1982). Ce phénomène touche parfois des films de genre, comme les films d'espionnage, avec notamment la série des James Bond. Certains réalisateurs britanniques poursuivent une carrière américaine plus personnelle, tels John Boorman (le Point de non-retour, 1967 ; Délivrance, 1972) et John Schlesinger (Macadam Cowboy, 1969 ; Marathon Man, 1976).
Inversement, des réalisateurs d'origine américaine viennent à Londres pour réaliser des films importants. Ainsi, Joseph Losey, fuyant les persécutions maccarthystes dans les années 1950, a poursuivi une très brillante carrière en Grande-Bretagne, de Temps sans pitié (1957) au Messager (The Go Between, 1971), et plus encore Stanley Kubrick, de Docteur Folamour (Dr. Strangelove, 1963) à Barry Lyndon (1975).
Les films de science-fiction qui ont marqué l'histoire du genre sont des films britanniques (tournés à Londres dans les très performants studios de Pinewood, comme 2001 : l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, en 1968), ou réalisés par des auteurs anglais, comme Alien, de Ridley Scott, en 1979. Le cinéma britannique permet ainsi à l'industrie cinématographique américaine de retrouver une certaine originalité et de prendre un second souffle dans ses périodes de perte d'inspiration.