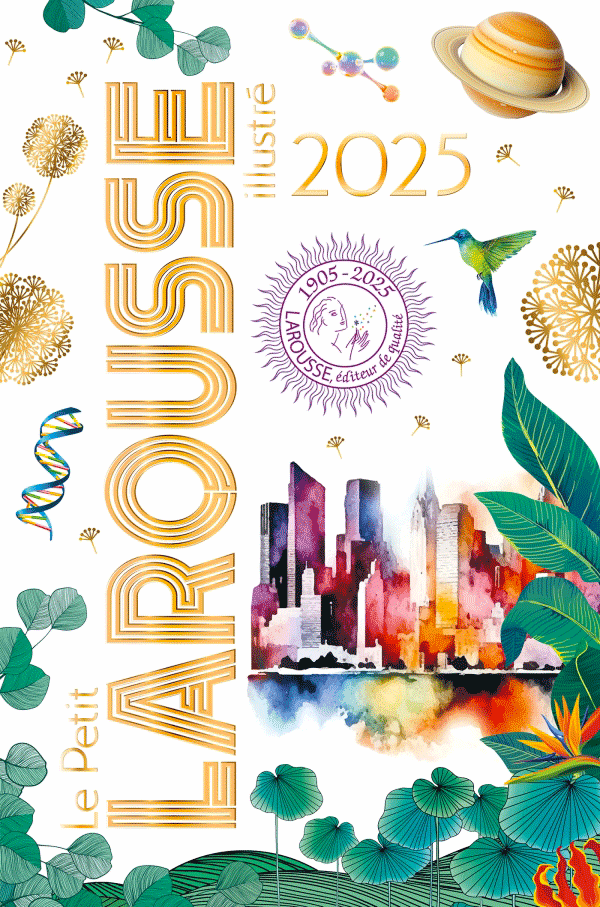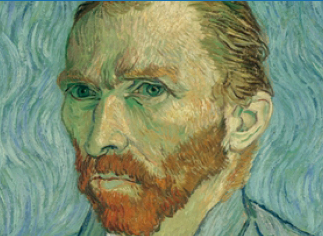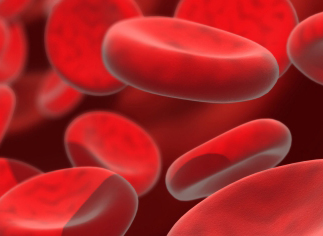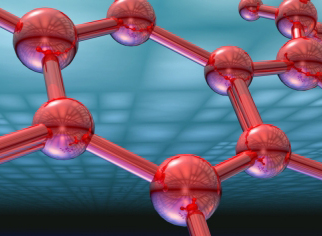Grande-Bretagne : vie politique depuis 1979
1. Le retour au libéralisme (1979-1997)
1.1. La révolution conservatrice de Margaret Thatcher (1979-1990)
Depuis l'élection de Margaret Thatcher à la tête du parti en 1975, les conservateurs ont rompu avec le consensus dirigiste de l'après-guerre. À partir de 1979, devenue Premier ministre, celle-ci met en œuvre un programme ultralibéral et entreprend de lutter en priorité contre l'inflation, de diminuer la fiscalité, les dépenses budgétaires, le poids de l'État et des syndicats, et d'encourager les initiatives privées.
Comme toute première conséquence de cette politique, le pays connaît de 1979 à 1982 sa plus grave récession depuis 1929. L'inflation est divisée par trois (4,6 % en 1984), mais la production industrielle plonge, les entreprises ferment ou licencient (13 % de chômage en 1982), et si la reprise s'amorce à partir de 1982, la « Dame de fer » ne doit sa survie politique, aux élections de 1983, qu'à l'impact de la victoire des Falkland (ou Malouines).
Cependant, de 1983 à 1989, l'économie britannique croît rapidement (+4,5 % par an) : le déclin séculaire apparaît enrayé, voire inversé. La productivité augmente fortement (+7,5 %), le chômage retombe au-dessous de 7 %, le secteur de la finance se développe à vive allure et le gonflement du secteur tertiaire compense plus ou moins les pertes industrielles. La livre inspire à nouveau confiance et Londres, avec son centre financier de la City, libéralisé et informatisé (1986), redevient une place mondiale de premier plan. Ce bilan flatteur vaut à M. Thatcher d'être reconduite en 1987.
L'État se désengage de la production : progressivement sont mises en vente les compagnies nationalisées qui ont survécu à la crise. L'énergie, les transports, l'aérospatiale, l'automobile repassent dans le secteur privé, entre les mains d'investisseurs institutionnels, de groupes étrangers, et de 11 millions de petits actionnaires. La manne des privatisations permet, non pas de réduire comme prévu les dépenses publiques, mais de les contenir tout en allégeant la fiscalité des particuliers et du capital. L'État vend également le parc immobilier des collectivités locales, avec l'objectif de faire du pays une nation de propriétaires. La sécurité sociale n'est pas démantelée, mais les principes libéraux visent à la rendre plus efficace et moins coûteuse pour les caisses publiques : ainsi la concurrence anime-t-elle les hôpitaux, le même principe s'appliquant par ailleurs au système de l'éducation.
Le gouvernement s'attaque aussi aux syndicats : l'Employment Act de 1980 réglemente la pratique des piquets de grève et interdit les grèves de solidarité. Le monopole d'embauche que détenaient les syndicats est supprimé en 1982. L'échec de la grande grève des mineurs (mars 1984-mars 1985) et les restructurations industrielles affaiblissent plus encore les trade unions (8 millions d'adhérents, contre 12 millions en 1979). Le marché du travail est assoupli et le pays accueille de nombreux investisseurs étrangers attirés par les faibles coûts de la main-d'œuvre et la proximité du grand marché européen.
Le gouvernement réforme également le fonctionnement des collectivités locales, jugé dispendieux, et souvent contrôlé par les travaillistes. Il supprime les échelons intermédiaires entre les municipalités et l'État (abolition du Great London Council en 1986), contribuant à centraliser davantage l'administration du pays. Un projet de réforme des impôts locaux (poll tax), fort impopulaire, entraîne une révolution de palais qui oblige M. Thatcher à céder la place à son chancelier de l'Échiquier, John Major, le 22 novembre 1990, alors que se profile une récession (inflation à 10 %, arrêt de la croissance, taux d'intérêt élevés).
L'euphorie des années 1980 a été sélective : les plus riches ont vu leurs revenus augmenter de 80 %, les classes moyennes se sont étoffées, mais la précarité du travail et la pauvreté se sont aggravées. Face à une Angleterre du Sud prospère, verte et tertiaire, les pays noirs du Nord se sont enfoncés dans la crise, voire la violence. Des émeutes ponctuelles (Liverpool en 1981, Birmingham en 1985), la montée du hooliganisme (stade du Heysel en 1985) témoignent de la misère d'une large fraction de la population, étendue à des régions entières.
1.2. Une diplomatie énergique
Margaret Thatcher s'emploie à rendre au pays un rôle diplomatique important. Partageant l'antisoviétisme de Ronald Reagan, elle renforce les relations avec les États-Unis, tandis que s'améliorent les rapports avec Moscou, après l'arrivée au Kremlin de Mikhaïl Gorbatchev.
Le 2 avril 1982, les Argentins envahissent les îles Malouines dont ils revendiquent la souveraineté ; ils sont condamnés par l'ONU. L'Angleterre envoie un corps expéditionnaire (20 000 hommes, 113 navires) et, en l'espace de deux mois, reconquiert l'île.
La conférence de Londres de 1979 parvient à un accord à propos de l'émancipation de la majorité noire en Rhodésie du Sud, qui, à l'issue des élections de 1980, devient le Zimbabwe. Cependant, contre l'avis d'un grand nombre de pays du Commonwealth, M. Thatcher refuse de prendre des mesures trop sévères contre l'Afrique du Sud. Elle négocie en outre, en 1984, des aménagements à la rétrocession de Hongkong à la Chine populaire, prévue pour 1997.
L'intransigeance prévaut à l'égard des indépendantistes d'Irlande du Nord (mort de 10 prisonniers de l'Irish Republican Army [IRA] grévistes de la faim en 1981). En 1984, le Premier ministre échappe à un attentat au congrès conservateur de Brighton, mais signe en 1985 les accords de Hillsborough avec son homologue irlandais Garret Fitzgerald, qui reconnaît à la République d'Irlande un droit de regard sur l'Ulster et ouvre la voie au dialogue entre les parties. Celui-ci tardera néanmoins à se concrétiser.
S'agissant de l'Europe, Margaret Thatcher se prononce contre tout abandon de souveraineté. Elle obtient la réduction de la contribution britannique au budget communautaire (accords de Fontainebleau de 1984), parvient à infléchir dans un sens libéral l'Acte unique de 1986, qui accompagne l'entrée du Portugal et de l'Espagne dans la CEE, mais ne décide que tardivement (octobre 1990) de faire entrer la livre dans le système monétaire européen (SME) ; elle refuse de signer la Charte européenne des droits sociaux en 1989 ou les accords de Schengen de 1990, sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures.
1.3. L'héritage thatchérien : le gouvernement du conservateur John Major (1990-1997)
John Major hérite d'une situation économique difficile (grave récession de 1990-1992). Le chômage repasse au-dessus de 10 %, la production industrielle diminue, les services et la région londonienne, jusque-là épargnés, sont touchés à leur tour, le budget redevient gravement déficitaire (7,7 % du PIB en 1993). Le retrait de la livre du SME et sa dévaluation de fait (1992) aident à la reprise, qui permet de poursuivre le processus de privatisations (British Telecom, distribution de l'électricité et des eaux, houillères, compagnies ferroviaires) et de réduire déficit budgétaire et dette publique.
Le parti conservateur remporte de justesse et contre toute attente les élections de 1992, mais très vite, malgré la prospérité retrouvée, son influence se délite : la crise des traditions – illustrée notamment par le déclin du prestige de la famille royale (monarchie britannique) –, les scandales divers qui touchent certains des membres du parti, la fronde de son aile droite antieuropéenne, l'absence de charisme du Premier ministre, enfin le vieillissement des infrastructures – négligées par les budgets successifs – et la précarisation d'une large partie de la population lui valent des revers électoraux significatifs : aux élections européennes de 1994, les tories passent de 32 à 18 sièges, les travaillistes de 45 à 54. Lors des élections locales de 1995, le parti n'arrive qu'en troisième position avec 22 % des voix, derrière les travaillistes (48 %) et les libéraux-démocrates (30 %). De 1993 à 1995, la défection de nombreux députés réduit la majorité au Parlement à un siège.
John Major a obtenu des Européens un traitement de faveur : la Grande-Bretagne est autorisée à ne pas signer le chapitre social du traité de Maastricht et à ne pas adhérer à l'union monétaire. Mais il lui faut engager la question de confiance au Parlement pour que sa majorité accepte finalement de ratifier l'accord (1993).
Toujours « brillant second » des États-Unis, le royaume fournit le 2e contingent occidental lors de la guerre du Golfe (1990-1991) et s'efforce de trouver une solution négociée en Yougoslavie en dépêchant troupes et médiateurs.
Le gouvernement doit cependant renoncer à l'obtention par Pékin d'un engagement à poursuivre la démocratisation des institutions de Hongkong. La question d'Irlande du Nord semble se débloquer avec la déclaration de Downing Street (décembre 1993), la reprise des pourparlers, et le cessez-le-feu des milices catholiques et protestantes. Prisonnier des voix des députés unionistes (partisans du maintien de l'Ulster au sein du Royaume-Uni) au Parlement, John Major ne peut aller plus avant ; les négociations s'enlisent et l'IRA rompt la trêve (1996).
2. Les « nouveaux travaillistes » : nouvelle identité britannique et « troisième voie » (1997-2010)
2.1. Les débuts de Tony Blair
Depuis 1992, le recentrage du parti travailliste, entamé en 1983, s'accélère. Neil Kinnock est remplacé par John Smith, qui supprime le pouvoir représentatif des syndicats au sein du parti. Son successeur, Tony Blair, retire en 1995 la clause IV des statuts du parti qui préconise la nationalisation des secteurs clés de l'économie. C'en est fini du marxisme doctrinal. Le « New » Labour séduit les classes moyennes, déçues par les conservateurs. Les élections de mai 1997 donnent une majorité absolue de sièges aux travaillistes (43 % des voix). Tony Blair devient Premier ministre.
Le chancelier de l'Échiquier, Gordon Brown, donne aux entrepreneurs des gages de « bonne conduite » financière : la Banque d'Angleterre devient indépendante ; l'imposition sur les sociétés est abaissée, des coupes dans les dépenses publiques sont effectuées, le budget est comprimé puis équilibré et enfin excédentaire, ce qui permet la réduction de la dette publique.
Après le secteur des prisons, le gouvernement envisage, avant de les abandonner, de nouvelles privatisations (lignes de métro de Londres). La croissance se poursuit, le chômage continue à reculer. Les travaillistes au pouvoir administrent ainsi la preuve qu'ils sont de bons gestionnaires et qu'ils peuvent mener une politique sécuritaire musclée (mesures répressives à l'égard des mineurs et des familles des jeunes délinquants).
Le gouvernement mène parallèlement une politique sociale. Il fait valoir un « plan emploi-jeunes », fait voter un salaire minimal national (avril 1999), rend obligatoires au moins trois semaines de congés payés et signe le chapitre social du Traité européen. Mais la solidarité nationale ne saurait se réduire à une politique d'allocations ; elle implique de la part de ses bénéficiaires des devoirs. Le chantier de la réforme de l'État providence est ouvert, le Welfare State, devant se muer en workfare, aide à la remise au travail des chômeurs. Le « New Deal » social vise à lutter contre les inégalités et l'exclusion tout en éliminant les fraudeurs et en décourageant l'assistanat. De même, le partenariat secteur privé-secteur public a pour but d'insuffler à des systèmes nationaux de santé et d'éducation le dynamisme du marché, d'améliorer leurs performances jugées déficientes, et par là, de servir l'ensemble des usagers. Ainsi Tony Blair a-t-il l'ambition, à l'instar d'un Bill Clinton, d'incarner une « troisième voie », opposée au néolibéralisme pur et dur et à la social-démocratie à l'ancienne.
2.2. Les réformes constitutionnelles et le début de règlement de la question de l'Irlande du Nord
Tony Blair entend répondre à la menace de délitement de l'idée de nation qui s'exprime dans les revendications indépendantistes des pays « celtiques » (pays de Galles et Écosse), la diversité culturelle, la demande de proximité manifestées par la population, le relâchement des liens avec le Commonwealth, l'intégration dans l'Europe (par l'économie et le « tunnel »), la fin de l'Empire (rattachement de Hongkong à la Chine en juillet 1997).
Il entreprend une série de réformes destinées à renouveler le pacte d'union entre les citoyens et le gouvernement, le centre et la périphérie : transparence gouvernementale et administrative, extension des recours judiciaires des citoyens vis-à-vis des pouvoirs, reconnaissance formelle des libertés civiles, incorporation de la Convention européenne des droits de l'homme dans la loi.
Cette politique libérale va de pair avec une volonté de démocratisation et de modernisation des institutions. Une commission prépare une réforme électorale, qui instillerait une dose de proportionnelle et supprimerait le droit des pairs héréditaires à siéger et à voter à la Chambre des lords ; la décentralisation doit créer un contact étroit entre gouvernants et administrés, et réduire les charges du gouvernement central : d'où le projet de dévolution de pouvoirs étendus au pays de Galles et à l'Écosse, par le biais de Parlements élus, que les populations concernées approuvent par référendum en septembre 1997 ; d'où également la nouvelle autorité du Grand Londres (GLA), abolie par M. Thatcher en 1986, et redonnant à la capitale les moyens d'une politique d'envergure.
S'agissant du problème de l'Irlande du Nord, Tony Blair, rompant un tabou, négocie avec le Sinn Féin et presse au dialogue les différentes parties. Il est un artisan majeur des accords de Stormont (avril 1998), qui prévoient le partage du pouvoir entre protestants et catholiques et qui assurent un droit de regard de la République d'Irlande sur l'Ulster en échange de son maintien dans l'Union. Comme pour le pays de Galles et l'Écosse, c'est un gouvernement local (paritaire) qui aura la responsabilité des affaires courantes de la province.
2.3. La fin de l'état de grâce
Populaire, Tony Blair paraît dès 1999 subir l'usure du pouvoir. Le projet formulé par la commission chargée de dépoussiérer les institutions n'a rien de radical. L'idée de proportionnelle est abandonnée. Il est seulement mis fin au vote de la plupart des pairs héréditaires à la Chambre des lords : à l'exception d'un petit nombre (92) d'entre eux, élus par leurs collègues.
Les élections aux Parlements d'Écosse et du pays de Galles voient en 1999 des coalitions travaillistes-libéraux prendre le pouvoir : la menace nationaliste est repoussée, mais peut-être moins qu'il n'y paraît.
En Irlande du Nord, la normalisation prévue achoppe sur la question du désarmement des groupes paramilitaires. Les élections européennes sont un échec pour les travaillistes ; ces derniers sont en effet distancés par les conservateurs ; le taux d'abstention atteint 76 %. Les élections locales de mai 2000 confirment ces tendances.
Objet d'une demande d'extradition émise par la justice espagnole, Augusto Pinochet est arrêté à Londres en octobre 1998. Les tribunaux britanniques appelés à statuer sur le cas estiment illégale la détention de l'ancien dictateur chilien, mais la Chambre des lords refuse en appel de lui accorder l'impunité… En mars 2000, le gouvernement britannique décide finalement de libérer, « pour raisons de santé », l'ex-dictateur chilien, qui regagne alors son pays, non sans susciter un certain trouble dans l'opinion publique.
En outre, le rythme des mesures se ralentit (grands projets de réformes des retraites et santé gelés), une série d'accidents de train pointe les déficiences de la politique gouvernementale, l'éducation demeure insuffisante et inadaptée, le racisme se traduit par des échauffourées entre communautés.
Surviennent en février 2001 les premiers cas de fièvre aphteuse. L'épizootie menace bientôt l'ensemble du cheptel britannique, malgré les mesures spectaculaires prises par le gouvernement pour en venir à bout. Après la crise dite de la « vache folle », les Britanniques n'ont plus confiance dans leurs agriculteurs et remettent en cause le productivisme agricole, financé depuis près de trente ans par la politique agricole commune (PAC). La gestion de l'affaire par le Premier ministre se retrouve au centre des attaques.
2.4. Un deuxième mandat sous les auspices de la croissance (2001-2005)
L'essoufflement de l'action réformatrice du gouvernement et les difficultés rencontrées n'empêchent toutefois pas Tony Blair de remporter les élections législatives anticipées de juin 2001. Son parti obtient 42 % des suffrages (6 sièges seulement de moins qu'en 1997), les conservateurs, 33 % (1 siège de plus), les libéraux-démocrates, 19 % (6 sièges de plus). Seul point noir pour le gouvernement, le fort taux d'abstention, qui atteint 41 %.
Le parti conservateur, qui a entamé en 1997 une longue traversée du désert et qui est handicapé par un leader impopulaire, William Hague, n'a pas réussi à gêner Tony Blair. Il cherche à opérer son aggiornamento en changeant de leader : Iain Duncan Smith prend la relève mais ce dernier se révélant aussi peu charismatique que son prédécesseur, c'est Michael Howard qui, en novembre 2003, prend les rênes de la formation. Arrivés en tête lors des consultations européennes et locales de juin 2004 (avec respectivement 26,7 % des voix et 27 députés, et 38 % des voix et 51 sièges de conseillers, contre 22,6 %, soit 19 députés, et 29 %, soit 39 sièges de conseillers pour le New Labour), les conservateurs peinent à paraître crédibles aux yeux de l'opinion publique. Ils souffrent aussi de la concurrence et de la bonne tenue de partis tiers – à l'instar de l'United Kingdom Independence Party (UKIP), formation ultra-nationaliste, qui milite depuis 1994 pour le retrait du pays de l'Union européenne (16,1 % des voix aux européennes) – et des libéraux-démocrates (14,9 % des voix aux européennes, 26 % aux élections locales). Ces derniers ont alors le vent en poupe, au point de contester les tories dans leur statut de principal groupe d'opposition.
Une santé économique florissante
Le gouvernement poursuit sa gestion habile des grands équilibres : les excédents dégagés par le budget permettent, face à la détérioration des services de la santé, de l'éducation et des transports, de prévoir en 2002 une augmentation des dépenses d'investissement collectif et du secteur public. Ce retournement keynésien permet au pays de surmonter le ralentissement de l'activité mondiale du tournant des années 2000. La santé de l'économie reste florissante (2,3 % en 2003, 3 % en 2004) ; l'activité, la confiance et la consommation se maintiennent, l'inflation est contenue, les taux d'intérêt peu élevés, le chômage a pratiquement disparu (au plus bas depuis 30 ans).
Le royaume traverse la plus longue période de prospérité ininterrompue depuis les débuts de la révolution industrielle, et fait bien mieux que la zone euro, ce qui repousse d'autant l'idée de son éventuelle adhésion à la monnaie unique. Cette injection de fonds gouvernementaux (hors dépenses militaires) vise à améliorer les services publics, préoccupation majeure des Britanniques. Les investissements, multipliés par deux entre 1999 et 2004, ont des effets déjà perceptibles : réduction des listes d'attente de soins de 18 à 6 mois ; rénovation des bâtiments éducatifs ; amélioration du transport ferroviaire.
Mais le déficit budgétaire se creuse et dépasse 3 % du PIB en 2003 et en 2004, tandis que le poids de la dette publique remonte à plus de 40 % du PIB. En outre, le surendettement des ménages (à plus de 110 % de leurs revenus) constitue une menace pour la pérennité de la croissance, au même titre que le renchérissement constant de l'immobilier, au sujet duquel des spécialistes évoquent une possible bulle. Il n'empêche que le royaume – fort de sa City et de son secteur tertiaire –, demeure la 4e puissance économique mondiale, et continue à attirer les investissements étrangers.
2.5. L'ombre portée de l'engagement en Iraq
Tony Blair entend exploiter politiquement ces bons résultats, qu'il doit à son chancelier de l'Échiquier et grand rival au sein du New Labour, Gordon Brown.
Après une année 2003 consacrée aux questions internationales, notamment à l'engagement britannique aux côtés des Américains en Iraq, il cherche à retrouver un crédit, une popularité et un soutien parlementaire que sa politique d'alignement atlantique et une succession d'affaires (débat sur les armes de destruction massive irakiennes, affaire Kelly, démissions volontaires ou forcées de ministres et conseillers) ont fortement érodés en revenant sur la scène intérieure. Non sans mal : la guerre – que l'on dit « la guerre de Tony Blair », voire de « Tony Bliar » (le menteur) – est impopulaire. Fondée sur de fausses allégations, coûteuse et entourée de pratiques peu morales, délégitimant un des arguments avancés par le Premier ministre (révélation des sévices et tortures sur des civils et des prisonniers irakiens, écoutes téléphoniques de responsables onusiens), elle entrave son action et fait chuter sa cote de popularité.
Entre-temps, la réforme institutionnelle de la Chambre des lords s'est arrêtée. Le succès des ultras protestants aux élections du Stormont en novembre 2003 remet aussi en cause le règlement de la question de l'Irlande du Nord.
Certaines des solutions préconisées pour l'amélioration des services publics (ouverture des hôpitaux aux capitaux privés, augmentation des droits d'inscription universitaire) rencontrent l'interrogation de l'opinion et suscitent, après l'engagement militaire en Iraq, la nouvelle fronde des députés du parti (vote de justesse, aux Communes, des projets de loi relatifs en janvier 2004).
Le fiasco des élections européennes et locales de juin 2004 atteste ces difficultés. Mais l'été 2004 remet en selle Tony Blair : innocenté par le rapport Butler, qui, en revanche, se montre sévère envers les services secrets, et conforté par la réélection de son ami George W. Bush et le succès de la consultation électorale de janvier 2005 en Iraq, il étaie son autorité sur le parti et le gouvernement – en particulier face à son possible successeur désigné, Gordon Brown.
2.6. Le troisième et dernier mandat de Tony Blair (2005-2007)
Malgré lassitude et déceptions, mais reconnaissant à Tony Blair un bon bilan économique, les Britanniques le reconduisent au pouvoir lors des élections générales de mai 2005. Ils accordent cependant avant tout leur confiance à l'artisan de la croissance, l'ombrageux partenaire, Gordon Brown, promis à se succéder à l'Échiquier.
C'est la première fois que le parti travailliste remporte une troisième victoire consécutive, mais ce succès historique n'est acquis qu'avec 35,2 % des voix, soit près de 7 points de moins qu'en 2001, et une majorité absolue aux Communes réduite de 47 sièges (356 députés). Au total, il n'a rallié qu'à peine plus d'un cinquième de l'électorat : ce score médiocre – le plus mauvais pour une formation au pouvoir depuis 1921 – dénote un choix par défaut. Le New Labour profite du manque de crédibilité de ses concurrents. Il devance le parti conservateur de M. Howard, qui obtient 32,3 % des suffrages et 197 sièges, et les libéraux-démocrates, qui s'imposent comme la troisième force du pays avec 22 % des voix et 62 sièges, mais ne parviennent pas à ravir aux tories la place de principale force d'opposition ni à jouer le rôle de formation charnière ou pivot escompté au Parlement.
Le succès de la candidature de Londres pour les jeux Olympiques de 2012 rejaillit sur l'aura du Premier ministre, qui s'est personnellement impliqué dans la promotion de la capitale.
Les attentats de Londres (juillet 2005)
Le lendemain, le 7 juillet 2005, sa démonstration de fermeté en réponse aux attentats qui frappent la ville et ses transports publics (56 morts et environ 700 blessés) ressoude l'opinion publique derrière le chef du gouvernement. Une nouvelle série d'actions projetée par des kamikazes islamistes formés dans le pays est déjouée le 21 juillet, ce qui renforce le tournant sécuritaire amorcé précédemment. Tony Blair s'engage, entre autres, à développer l'arsenal juridique destiné à combattre le terrorisme, à rendre obligatoire la possession d'une carte d'identité, et à redéfinir dans un sens restrictif et sélectif les politiques d'immigration. Ces différents projets soulèvent l'inquiétude des défenseurs des droits fondamentaux qui redoutent la mise en place d'un État policier. Elle est relayée par une partie des parlementaires qui rejettent un premier projet de loi antiterroriste en novembre 2005. Ce revers, qui incite le chef du gouvernement à davantage d'écoute et de concessions, n'empêche pas que l'instauration de la carte d'identité obligatoire et une nouvelle mouture du texte soient votées en février 2006, ainsi qu'une loi sur l'immigration choisie et d'autres mesures renforçant la sécurité du pays – et la surveillance des citoyens.
Fin de règne
La fronde des députés se poursuit toutefois, avec le vote difficile en mars d'un projet prévoyant d'accorder une plus grande autonomie aux écoles et de les mettre en concurrence, ce qui ajoute à l'impression de « fin de règne » et alimente les spéculations sur le départ prochain du Premier mininistre.
Ayant en effet annoncé préalablement au dernier scrutin général qu'il ne solliciterait pas de quatrième mandat, Tony Blair a relancé le débat sur sa succession. Face à l'impatience manifestée par les partisans de Gordon Brown au sein du parti, du Parlement et du gouvernement, il affiche cependant sa détermination à poursuivre l'agenda des réformes programmées (services publics, éducation, sécurité, immigration) et à conserver la maîtrise du calendrier politique.
Mais les difficultés s’accumulent. Des révélations sur le financement de la campagne électorale de 2005 éclaboussent le chef du gouvernement dont la cote de popularité est au plus bas. Les conservateurs profitent de son affaiblissement : d'une part, dès la fin de 2005, ils décident de combattre les travaillistes sur le terrain de l'image et de la jeunesse en se choisissant pour nouveau leader un député du centre droit de 38 ans, David Cameron : de l'autre, ils remportent un spectaculaire succès lors des élections locales de mai 2006 à l’issue desquelles le New Labour perd plus de 300 sièges.
Tony Blair tire les leçons de cet échec historique en remaniant largement son cabinet et en renforçant sa garde rapprochée. Pendant l’été, le silence du Premier ministre lors de l’attaque d'Israël contre le Liban le déconsidère un peu plus et le fait apparaître comme le « caniche de Bush », tandis qu’une vague d’attentats déjouée in extremis par Scotland Yard le 10 août ternit son bilan en matière de lutte contre l’insécurité et le terrorisme international. Aussi 17 députés travaillistes le pressent-ils publiquement, lors de la rentrée, de se retirer de la vie politique pendant que 7 membres subalternes de son cabinet démissionnent pour la même raison. En septembre, peu avant le congrès annuel du parti travailliste qui fait de G. Brown le futur successeur de Tony Blair, ce dernier annonce effectivement son départ dans l’année, sans toutefois en préciser la date.
Le règlement de la question nord-irlandaise
Soucieux de peaufiner son image et son bilan, assombris par l'engagement en Iraq, jugé par lui catastrophique fin 2006, Tony Blairr s’emploie à règler pour de bon la question nord-irlandaise. Après avoir fait de nouvelles propositions au début 2006, avec son homologue irlandais, le Premier ministre obtient des diverses parties qu'elles se rencontrent et discutent en octobre à Saint Andrews, en Écosse. D'où l'élaboration d’une feuille de route pour la restauration des institutions semi-autonomes suspendues depuis 2002 et la formation d'un gouvernement biconfessionnel. En contrepartie de la reconnaissance officielle de la légitimité de la police nord-irlandaise par le Sinn Féin, effective à partir du 28 janvier 2007, et malgré d'ultimes atermoiements de la part du DUP, les élections parlementaires locales du 7 mars 2007, qui voient la victoire de ces deux grandes formations, aboutissent finalement à la constitution d'un gouvernement provincial dirigé par le vieux leader de la formation protestante ultra, Ian Paisley – secondé par le républicain Martin McGuinness –, et à la fin d'un long conflit.
Malgré ce succès, le Premier ministre doit composer avec l'hostilité de l'opinion et une majorité toujours plus rétive, prête à lui refuser en mars les crédits de défense qu'il demande et qu'à nouveau seul le ralliement de conservateurs lui permet d'obtenir. En mai 2007, les travaillistes subissent une défaite aux élections locales, avec la perte de 500 mandats, et notamment le basculement du vieux bastion écossais dans les mains des indépendantistes. En outre, ils ne conservent qu'une majorité relative dans l'assemblée du pays de Galles. La décentralisation, projet phare des années Blair, semble se rertourner contre son maître d'œuvre. Aussi celui-ci annonce-t-il son retrait de la vie politique nationale pour la fin juin : G. Brown lui succède sans surprise à la tête du parti le 24 juin, puis à celle du pays le 27.
2.7. Les cent premiers jours de Gordon Brown (juin 2007)
Gordon Brown affiche une volonté de renouveau sans reniement, en composant un cabinet d'ouverture (aux libéraux-démocrates) et de rassemblement, qui promeut des jeunes, comme David Miliband, passant de l'Environnement aux Affaires étrangères, ainsi qu'une femme, Jacqui Smith, la première à se voir confier l'Intérieur, en même temps qu'il nomme pour la première fois deux musulmans à des secrétariats d'État.
À peine entré en fonction, le Premier ministre fait face aux attentats terroristes déjoués à Londres et à Glasgow les 28 et 29 juin, puis, durant l'été, à des inondations centenaires dans l'ouest de l'Angleterre, à la réapparition accidentelle de la fièvre aphteuse dans le Sud, et enfin, à la quasi faillite de la banque Northern Rock. L'impression de sérieux et de compétence qu'il donne rassure l'opinion et fait remonter dans les sondages les travaillistes, placés à nouveau devant les conservateurs.
En outre, il opère un début de désengagement des troupes d'Iraq, pour les réaffecter en Afghanistan, où la situation s'aggrave dangereusement, tirant progressivement un trait sur l'héritage le plus controversé de son prédécesseur. Aussi, lorsque confronté à l'assaut renouvelé des tories, il renonce à provoquer des élections générales anticipées au début de l'automne, l'opinion comme ses partisans ne le comprennent-ils guère : l'état de grâce ne passerait-il pas les premiers cent jours d'un parcours jugé pourtant sans faute ?
2.8. Une impopularité irréductible
Le désastre des élections locales de mai 2008
Dès lors, la cote du Premier ministre comme celle des travaillistes, affectés par la révélation de nouveaux scandales et le retournement de la conjoncture (inflation, ralentissement de la croissance, crise financière, chute de l'immobilier) s'effondre. À l'inverse, celle des conservateurs, dopée par la popularité de leur jeune leader et de ses propositions de baisse d'impôts, s'envole. Pour le parti au pouvoir, rien ne semble permettre de renverser la tendance : ni le sauvetage de la banque Northern Rock, ni non plus le virage sécuritaire pris par le gouvernement.
Aux handicaps personnels de G. Brown, devenus patents à la fin 2007 (difficulté à communiquer, austérité et isolement, défaut de charisme), s'ajoutent au début de 2008 des erreurs politiques : ainsi du projet d'allongement de la détention des suspects de terrorisme qui suscite des dissensions internes à la majorité et de la réforme fiscale qui provoque un tollé au sein du parti et un vif mécontentement social, au point d'obliger le gouvernement à adopter en urgence une série de mesures compensatoires.
Le scrutin local de mai 2008 fait par conséquent figure de coup de semonce : le parti n'arrive qu'en troisième position, derrière les tories (44 % des voix) et les libéraux-démocrates (25 %), avec seulement 24 % des suffrages et une perte sèche de 350 sièges, dont ceux, plus que symboliques, de Londres. À l'issue de cette débâcle électorale, sans recours immédiat, et de peur de plonger davantage, les travaillistes font bloc derrière celui qui reste leur leader, adoptant aux Communes le projet de loi répressif contesté et, à la Chambre haute, malgré le non irlandais, le traité européen de Lisbonne. Pendant l'été, à la suite de la perte d'un énième bastion lors d'une partielle en Écosse, de la révélation de nouveaux dysfonctionnements au sein de l'administration et de l'aggravation de la conjoncture économique, la contestation interne reprend.
Face à la tempête financière
Mais la tempête financière qui ébranle la City après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers en septembre ressoude les rangs du parti, de la majorité parlementaire et du gouvernement autour du leadership du Premier ministre. Pour éviter que d'autres compagnies ne s'effondrent, celui-ci nationalise la banque spécialisée dans le prêt immobilier Bradford & Bingley et pousse la Lloyds TSB à racheter une HBOS (Halifax Bank of Scotland) au bord du dépôt de bilan. Au début d'octobre, un mini remaniement réintègre les blairistes Peter Mandelson (Commerce), Margaret Beckett (Logement) et Geoff Hoon (Transports), tandis que le portefeuille de l'Énergie et du Réchauffement climatique échoit à Ed Milliband, frère du ministre des Affaires étrangères et possible prétendant à la succession de G. Brown, ce qui concrétise l'idée d'une union sacrée face à la crise. Le plan de soutien au système bancaire concocté alors met à disposition des groupes financiers en grande difficulté d'abondantes lignes de crédit et autorise la recapitalisation des principaux établissements à hauteur de 50 milliards – en contrepartie d'un droit de regard de l'État. Ces prises de participation publique s'accompagnent d'un vaste plan d'aide aux PME et aux ménages (de l'ordre de 350 milliards) qui accentue le tournant interventionniste amorcé par le gouvernement. Plutôt bien reçu par la population, il redore le crédit du Premier ministre et le blason d'un New Labour qui conserve contre toute attente le fief de Glenrothes en Écosse lors d'une partielle en novembre.
La double annonce de la baisse immédiate pour un an de la TVA de 17,5 à 15 % et d'une réduction des impôts – sauf pour la tranche la plus élevée – à compter de 2011 (en cas de victoire des travaillistes aux élections générales) ne permet toutefois pas de prolonger cette embellie sondagière que l'amplification d'une crise qui menace de se muer en dépression historique, la flambée du chômage et la perspective de la banqueroute d'un pays dont les déficits filent dangereusement, ont tôt fait de dissiper.
Au début de 2009, de nouvelles secousses financières font trembler l'économie britannique, alors que les caisses de l'État, désormais désespérément vides, interdisent la mise en œuvre de tout nouveau plan de relance. Aussi l'apparent succès du sommet du G 20, qui se tient à Londres en avril, et la série d'actions concertées de lutte contre la crise qu'il dévoile, se révèlent-ils insuffisants pour faire retrouver au pays le chemin de la croissance et restaurer durablement la confiance.
La multiplication des « affaires »
Dans ce contexte, la cascade de révélations à partir de mai sur l’existence de multiples abus dans les notes de frais des députés et des ministres éclabousse l’ensemble de la classe politique et notamment le gouvernement. L’onde de choc du scandale se ressent tout particulièrement à la veille des consultations européenne et locales de juin ; en quelques jours, une dizaine de membres de l’exécutif, dont des poids lourds, sont amenés à quitter leurs fonctions. Les réaffectations qui s’ensuivent ne peuvent empêcher la déroute électorale des travaillistes : avec 15,7 % des voix, ils s’effondrent, loin derrière les conservateurs (27,7 %), pourtant eux aussi compromis, et même l’eurosceptique UKIP (16,5 %), qui confirme son implantation. Le BNP (British National Party) d’extrême droite, qui obtient 2 élus, fait son entrée au Parlement européen. La sanction des urnes est aussi locale : le Labour qui abandonne les 4 comtés qu’il dirigeait encore sur les 27 remis en jeu affiche une perte sèche de quelque 290 postes de conseillers, contre un gain net de 244 pour les tories et une quasi stabilité pour les libéraux. Là encore, le BNP fait une percée, avec 3 élus.
Après cette nouvelle « Beresina », les travaillistes adoptent un profil bas : la contestation interne échoue à réunir les 72 signatures de députés nécessaires pour demander le départ de Gordon Brown. En annonçant le report de la privatisation programmée de la poste, le gouvernement entend renouer avec l’électorat populaire du Nord qui lui a fait défaut lors des précédents scrutins. Il réitère son engagement en vue de l’amélioration des services publics. Mais la crise se poursuit, l’été se fait meurtrier sur le front afghan et de nouvelles affaires compromettent le gouvernement.
Toutefois, à l’automne, le retour de David Cameron sur sa promesse de tenir un référendum à propos du traité de Lisbonne, puis les scandales fiscaux concernant des pontes du parti conservateur font quelque peu douter l’opinion de la capacité de cette formation et de son leader à diriger à terme le pays. Le Premier ministre présente ensuite un budget qui prévoit d’augmenter les impôts des plus riches, de réduire de 20 % sur 3 ans le traitement des fonctionnaires les mieux payés, mais de poursuivre la politique d’investissement, notamment dans l’éducation.
Le parti travailliste affaibli
Les dissensions internes aux travaillistes se font à nouveau jour au début de l’année 2010 quand deux anciens ministres appellent G. Brown à démissionner et à laisser la place à un nouveau leader, pour éviter un désastre aux prochaines élections générales. Plombé par la révélation de nouvelles exactions fiscales de certains de ses chefs, le parti conservateur voit reculer son avance dans les sondages. La bataille électorale s’annonce dès lors serrée, et ce d’autant plus qu’emmenés par leur jeune leader Nick Clegg, les libéraux-démocrates (qui ont dénoncé l’engagement en Iraq, et, avant la crise, les dérives du système financier) ont plus que jamais la cote et semblent être en mesure de jouer les faiseurs de roi.
Le résultat du scrutin du 6 mai reflète l’indécision des électeurs (65,1 % de participation). Toutes les grandes formations sont perdantes. Les conservateurs arrivent certes en tête avec 36,1 % des voix et 306 députés, mais ils leur manquent 20 sièges pour s’assurer d’une majorité aux Communes. Contre toute attente, les travaillistes obtiennent 29 % des suffrages et 258 élus (leur plus mauvais score depuis la sanction de 1983), mais ils peuvent envisager de former une coalition avec certains petits partis (28 sièges au total) et avec les libéraux-démocrates, qui eux, réalisent une contre-performance par rapport aux intentions relevées par les instituts de sondage (23 % et 57 représentants, soit moins que dans la précédente législature).
Se dessine pendant quelques jours d’incertitude et de tractations la perspective d’un « hung Parliament », sans majorité claire. Une chose paraît toutefois certaine : le départ de G. Brown, qui annonce le 10 mai qu’il quitte la direction du Labour, puis le lendemain Downing Street. Et en effet, le 11 mai, un accord scellé entre les tories et les libéraux aboutit à la constitution, sans précédent, d’un gouvernement de coalition entre les deux formations, dirigé conjointement par leurs deux jeunes leaders, David Cameron, placé à sa tête, et Nick Clegg, nommé vice-Premier ministre.
3. Les conservateurs et libéraux-démocrates au pouvoir (2010-2015)
3.1. Les débuts de l'improbable tandem Cameron-Clegg/tory-lib-dem
Après tractations, le 11 mai 2010, David Cameron compose un gouvernement de coalition avec les libéraux-démocrates et devient le plus jeune occupant du 10 Downing Street depuis près de 200 ans. Secondé par un leader du même âge, Nick Clegg, promu vice-Premier ministre, il forme ainsi une alliance politique entre deux partis, inédite depuis 1945 et par ailleurs sans équivalent dans l’histoire des deux formations, ce qui implique de multiples concessions : si les libéraux-démocrates obtiennent des postes importants, l’engagement de ne pas provoquer un nouveau scrutin général avant 5 ans, le relèvement du plancher de l’imposition fiscale et la tenue d’un référendum pour ou contre l’ajout d’une dose de proportionnelle dans le système électoral, ils doivent aussi composer avec l’hostilité à l’UE des tories, leur souhait de privilégier la « relation spéciale » que le pays entretient avec les États-Unis, un durcissement vraisemblable des lois sur l’immigration et des perspectives de coupes sévères dans les dépenses publiques. Le chef du cabinet, qui s’entoure par ailleurs de fidèles, montre qu’il entend diriger un gouvernement stable et fort, même s’il doit remplacer au débotté l'un de ses secrétaires, impliqué dans le scandale des défraiements des députés. Si, logiquement, le nouveau ministre des Affaires étrangères, William Hague, effectue sa première visite officielle à Washington, David Cameron prend le soin de confier le dossier européen à un modéré et renonce à sa promesse de campagne qui consistait à exiger de Bruxelles le rapatriement à Londres des compétences communautaires déléguées.
La lutte contre le déficit budgétaire
Pour faire face à l’explosion du déficit budgétaire (plus de 12 % du PIB en 2010), le gouvernement présente un avant-projet de rigueur, qui s’avère sans précédent depuis 1945 et prévoie une réduction de £150 milliards des dépenses sur 5 ans (pour ramener le premier à 1 % voire l’éliminer), fondée pour les trois-quarts sur des coupes drastiques dans les programmes de redistribution (gel des allocations sociales et des salaires des fonctionnaires, baisse sensible du nombre de ces derniers, diminution des transferts de tous ordres, relèvement de l’âge de la retraite et réduction de son montant) et pour un quart sur une augmentation des impôts (TVA passant de 17,5 % à 20 %, renforcement des taxes sur les plus-values, non-remise en cause de la hausse de 40 à 50 % de la tranche des plus aisés décidée par G. Brown, mais révisions du seuil fiscal qui exonère près de 900 000 foyers, concessions faites au monde des affaires en général, et en revanche, soumission des banques à un apport annuel supplémentaire de l’ordre de 2 £milliards).
Alors qu’il annonce fin juin des restrictions de l’octroi des visas aux ressortissants non-européens puis, un mois plus tard, en déplacement à New Delhi, donne de la voix contre le Pakistan qu’il accuse d’« exporter la terreur », D. Cameron fait aussi savoir qu’il compte alléger le modèle de l’État providence en invitant les Britanniques à se faire les promoteurs d’une « Big Society », où les services publics jugés déficients seraient remplacés par des institutions mises en place et gérées directement par les usagers – projet mis à l’essai dans 4 comtés tests dès juillet.
Tiraillements au sein de la coalition
De même, le Premier ministre s’engage pour la tenue d’un référendum sur la réforme électorale exigée des libéraux, à laquelle lui-même et ses propres troupes s’opposent cependant. De fait, l’attelage lib-dem/tory suscite des tensions au sein de chacune des deux formations : les plus à droite des conservateurs reprochent à « Dave the Red » (« David le rouge »), la hausse de l’imposition des foyers les plus riches et sa volte-face vis-à-vis de Bruxelles, tandis que les libéraux-démocrates s’inquiètent des répercussions sur les classes moyennes, les familles les plus modestes et l’activité en général de la réduction draconienne des dépenses publiques. Au vu des sondages, l’opinion sait pourtant gré au Premier ministre de prendre des mesures radicales, cependant que la cote des libéraux s’effondre. Simultanément (fin septembre), l’opposition se dote d’un nouveau leader en la personne d’Ed Miliband, élu de justesse à la tête du Labour.
Si David Cameron refuse de remettre en cause la suppression des allocations familiales pour les plus aisés, il décide de privatiser partiellement la Poste, d’imposer aux chômeurs des tâches d’utilité publique et de permettre aux universités de tripler le montant des frais d’inscription. Ce dernier projet est voté de justesse au Parlement en décembre, malgré l’opposition de quelques conservateurs et de nombre de libéraux-démocrates ainsi que de multiples manifestations d’étudiants dès novembre. Des tiraillements se font jour dans la coalition : les plus progressistes des libéraux-démocrates ne manquent pas d’exprimer leurs réticences à propos de la politique radicale menée par le gouvernement, tandis que l’aile droite des tories dénonce le maintien à son poste du ministre du Commerce et vitupère les mesures qui ciblent et pénalisent les Britanniques les plus fortunés.
Entre-temps, convaincu par les libéraux et soucieux d’attester que son parti s’ouvre aux évolutions de la société, David Cameron soutient un projet d’adoption de l’équivalent du mariage homosexuel. Mais la création d’une Big Society (ou Grande société) destinée à remplacer l’État providence semble faire long feu, cependant que sous la pression de l’opinion, le gouvernement revient sur son programme de privatisation de la moitié des quelque 260 000 hectares de forêts qu’il détient.
Une rigueur impopulaire
Les manifestations organisées par les syndicats contre la rigueur le 26 mars 2011 connaissent un succès inattendu, les Britanniques ayant enregistré un recul trentenaire (- 0,8 %) de leur pouvoir d’achat en 2010 et s’apprêtant à connaître une année 2011 plus difficile encore, avec une croissance atone, des programmes de redistribution en chute libre, un chômage désormais situé à plus de 8 % de la population active et une poussée de l’inflation au-delà de 4 %. Face au mécontentement, D. Cameron décide de repousser la réforme programmée du service public de santé
S’ils oublient momentanément les difficultés économiques et la cure d’austérité en assistant en nombre au mariage de Kate Middleton et du Prince William le 29 avril, les Britanniques sanctionnent sévèrement les libéraux-démocrates le 5 mai en rejetant à près de 70 % leur projet de réforme du scrutin électoral, et en leur infligeant le plus mauvais score de leur histoire aux consultations locales (15 % des voix), ce qui leur fait perdre des centaines de postes de conseillers territoriaux. Comme immunisés des mesures drastiques prises dans l’année mais imputées à leurs partenaires par l’opinion, les conservateurs au pouvoir sortent en définitive quelque peu renforcés, avec 35 % des voix, cependant que le parti travailliste consolide sa position de leader de l’opposition avec 37 % des suffrages, soit 10 points de plus qu’en 2010.
En parallèle, les nationalistes du SNP, emmenés par Alex Salmond, obtiennent la majorité absolue des sièges au Parlement écossais, tandis que le Pays de Galles confirme son ancrage à gauche, donnant au Labour un quasi contrôle de son assemblée. Parmi les quelque 300 municipalités dont le conseil devait être renouvelé, au total les tories gagnent 4 villes (pour en diriger 179), les travaillistes 26 (57), et les libéraux-démocrates qui en perdent 9 n’en dominent plus que 10.
Au début de l’été, le scandale News of the World, du nom d’un tabloïd anglais impliqué dans des écoutes téléphoniques illégales et la mise au point d’un vaste système de collusion entre journalistes, policiers et responsables publics, affecte durablement la crédibilité des institutions, dont celles du gouvernement et de son chef. Le 6 août, une manifestation à la suite de la mort d’un jeune Antillais lors d’un affrontement avec la police dégénère et embrase les quartiers difficiles de Londres, puis, trois journées durant, la plupart des grandes villes anglaises, faisant quatre autres victimes, des centaines de blessés, plus de 200 millions de livres de dégâts.
Si le discours de fermeté adopté par le Premier ministre convainc l’opinion, celle-ci ne manque toutefois pas de voir dans ces troubles la faillite de ses propres projets sociétaux, le résultat de la cure d'amaigrissement de l'État providence et des services publics ainsi que la confirmation de l’avènement, à la place des uns et des autres, d’une « Broken Society » (« société en miettes »).
La faiblesse de l’activité (croissance poussive de 0,9 % en 2011) contraint la Banque d’Angleterre à continuer à faire marcher de plus belle la planche à billets, cependant que les préconisations du rapport Vickers sur la séparation des dépôts et des activités commerciales et spéculatives des grands groupes bancaires ne parviennent pas à enrayer la protestation de plusieurs centaines d’« indignés » réunis spectaculairement pendant des semaines sur le parvis de St Paul à Londres, pas plus qu’elles n’empêchent près de deux millions de fonctionnaires de témoigner de leur attachement à leur système de retraite et de faire grève le 30 novembre, dans l’un des plus importants mouvements sociaux depuis 1979.
3.2. Constance et résistance dans les épreuves
La conjonction des difficultés
Affecté par l’enquête sur les pratiques du groupe médiatique Murdoch (le Premier ministre comparaît devant la justice en juin 2012), le parti au pouvoir doit aussi composer avec d’autres scandales et démissions consécutives, comme celle du très conservateur ministre de la Défense Liam Fox en octobre 2011. Les dissensions au sein de la coalition ajoutent aux difficultés : d’une part, l’influence grandissante des eurosceptiques au sein de la première formation du pays explique en partie le refus de D. Cameron d’engager le Royaume-Uni dans la discipline budgétaire communautaire exigée de ses membres par l’UE en décembre 2011, quitte à froisser la fibre pro-européenne des alliés libéraux-démocrates. Dès janvier 2012, certains centristes n’hésitent pas à joindre leurs voix à celles des travaillistes pour retoquer à la chambre haute les projets gouvernementaux de plafonnement des aides sociales familiales et de modification de l’activité des médecins.
D’autre part, les programmes de révision constitutionnelle divisent les partenaires au pouvoir : la double proposition soutenue en avril par N. Clegg et son parti – qui consiste à faire élire 80 % des lords et à diviser leur nombre par près de deux – rencontre la résistance de l’establishment politique britannique, et notamment l’hostilité des conservateurs, qui, d’ailleurs, finissent par la rejeter en juillet.
Plus tard dans l’été, c’est l’architecture du redécoupage électoral ébauché par les tories qui dresse les membres des deux formations les uns contre les autres, au point de décider le vice-Premier ministre à se saisir de la pomme de discorde qu’est devenue, en ces temps de crise, la fiscalité des plus riches et de proposer, au grand dam des conservateurs, son relèvement.
Ce contexte politique, mais aussi l’absence de redémarrage de l’économie, l’impasse budgétaire, la privatisation programmée des routes et le projet de vente par étape de la poste valent à la cote de popularité de D. Cameron de plonger. Et si, lors des élections locales partielles de mai 2012, le tory Boris Johnson sauve de peu la mairie de Londres et l’honneur de son parti, les conservateurs et libéraux-démocrates enregistrent un net recul dans leurs bastions du centre et du Sud, et une perte sèche de 12 conseils municipaux, dont ceux de Birmingham, Cardiff et Glasgow.
Tandis qu’à partir du début de l’été de grandes institutions de la City font durablement l’objet d’investigations pour pratiques frauduleuses, des voix de plus en plus nombreuses se font entendre pour protéger cette dernière du contrôle de Bruxelles et demander la sortie du pays de l’UE.
En même temps, après un an de négociations, l’Écosse, par l’intermédiaire de son Premier ministre, obtient du gouvernement central l’autorisation de tenir en 2014 un référendum sur son indépendance (octobre 2012). En revanche, la poignée de main historique du 27 juin 2012 à Belfast entre Martin McGuinness, numéro 2 du Sinn Féin, et la reine, témoigne de la normalisation des relations entre Londres et sa province nord-irlandaise.
Vers l’éclaircie ?
Le jubilé de diamant d’Élisabeth II en juin 2012 puis les Jeux Olympiques d'été de Londres font quelque peu oublier aux Britanniques la difficulté des temps et leur redonnent des repères comme des motifs de fierté et d’espoir, toutes choses sur lesquelles D. Cameron capitalise pour se remettre en selle, même s'il n’est pas question pour lui de changer de politique. Le 4 septembre, il remanie à la marge son gouvernement : à côté des poids lourds de l’équipe qu’il reconduit, il fait entrer des représentants de l’aile dure du parti, afin de mieux contrôler ses troupes. Symboliquement, il se débarrasse du modéré Kenneth Clarke à la Justice pour le remplacer par le très droitier Christopher Grayling. Pour donner plus de gages aux ultras et bénéficier de la vague d’europhobie qui déferle sur le pays, il fait connaître dès novembre son intention de consulter la population par référendum sur le maintien ou non du royaume dans l’UE… après les prochaines élections générales, prévues pour 2015… Mais sa proposition n'étouffe en rien la contestation interne portant sur son leadership. En revanche, elle fait de la question un enjeu majeur du futur scrutin et place les alliés conjoncturels lib-dem, comme a fortiori les opposants travaillistes, en position délicate pour ne pas dire en porte-à-faux vis-à-vis de l’opinion.
Attisé par la crise de la monnaie commune, ce sentiment anti-européen des Britanniques pousse le Premier ministre à l’intransigeance à Bruxelles – non sans succès, puisque, comme M. Thatcher en son temps, il arrache d’abord à ses partenaires continentaux un rabais sur la contribution du pays aux caisses de l’UE puis, au début 2013, parvient même à porter un coup d’arrêt à l’expansion systématique du budget communautaire et à imposer le principe de sa diminution pour la période 2014-2020.
Sur le front intérieur, pour contrer la grogne d’une grande partie des conservateurs hostiles au plafonnement des allocations familiales des foyers les plus aisés et au mariage homosexuel en passe d’entrer en vigueur, il stigmatise les chômeurs et dénonce les profiteurs aux aides sociales, dont il entend d’une part réduire le montant et d’autre part interdire l’octroi aux immigrés récents. Le durcissement patent de son orientation politique ne fait pourtant pas pièce à la concurrence du parti de l’Indépendance du Royaume-Uni (UKIP), formation populiste et souverainiste à droite des tories qui les devance lors d’une législative partielle en mars 2013.
Le contexte, toujours morose, reste plombé par des prévisions économiques en berne, le retrait en début d’année par deux des grandes agences financières internationales de la note du triple A conférée jusque-là au royaume, et l’approfondissement de plans de rigueur qui sabrent dans les dépenses et les effectifs de la fonction publique mais s’avèrent impuissants à maîtriser le déficit (à 7,8 % du PIB) et repoussent sans cesse l’horizon de sa résorption. Ils s’accompagnent toutefois d’une politique de l’offre offensive qui conjugue substantielles garanties immobilières, baisse sensible des cotisations sociales, des charges patronales et des impôts sur les sociétés, et allègement peu populaire des impôts des plus riches. En contrepartie, le gouvernement s’engage résolument dans la chasse à la fraude et aux paradis fiscaux, selon un programme que le Premier ministre n’a guère de mal à soumettre à l’approbation de ses collègues du G8 en juin à Enniskilen en Irlande du Nord. En matière d’environnement, D. Cameron opère un revirement notable, quand à l’été il se prononce en faveur de l’exploitation du gaz de schiste et d’une déréglementation des industries polluantes.
Les élections locales de mai 2013 permettent aux Britanniques d’exprimer leur désarroi. L’UKIP, fondé en 1993 et encore très marginal à la fin de la décennie 2000, crée la surprise en arrivant troisième, avec près de 150 postes de conseillers et 23 % des voix. Cette formation talonne désormais les conservateurs qui, à un niveau historiquement bas de 25 % des suffrages, s’effondrent et doivent concéder 335 sièges, tandis que l’allié lib-dem enregistre son plus mauvais score pour ce genre de scrutin, à 14 %, et une perte sèche de 124 représentants. S’ils finissent premiers de la consultation, à 29 %, et obtiennent 538 élus supplémentaires, les travaillistes sont pourtant fort loin d’emporter l’adhésion.
Les tories donnent alors l’impression de toucher le fond. Si la personnalité, une certaine désinvolture et les orientations de D. Cameron offrent plus que jamais prise aux interrogations, comme en témoigne le camouflet qu’il reçoit de l’opposition, mais aussi des lib-dem et d’une partie de ses troupes dans le dossier syrien (tous réunis, ils rejettent aux Communes sa proposition d’intervention armée aux côtés des États-Unis et de la France à la fin août), le redressement très net de la conjoncture et l’accélération sensible de la croissance (à près de 2% pour 2013) l’aident à redorer son bilan et à justifier la poursuite de sa politique de rigueur (nouvelles réductions des dépenses sociales, accompagnées cependant de l’annonce d’une future hausse du salaire minimum – d’environ 10 %).
Les réticences que ces coupes supplémentaires suscitent parmi les libéraux jusqu’au sein de son cabinet s’ajoutent à leur réprobation de la posture de plus en plus europhobe prise par le Premier ministre, qui ne permet pas d’ailleurs d’interrompre l’essor d’UKIP.
Avec 27,5 % des voix, c’est cette formation qui arrive en tête des élections européennes de la fin mai – privant, fait inédit en cent ans, l’un des deux grands partis de la première place dans un scrutin national. Elle devance les travaillistes (25,4 %) et les conservateurs (à peine 24 %), tandis que les libéraux, laminés, à moins de 7 %, finissent un point derrière les Verts. Les consultations locales qui se tiennent en même temps confirment son ancrage dans le paysage politique britannique – et sur l’ensemble du territoire, avec 17 % des suffrages, et quelque 150 nouveaux sièges de conseillers, pour un total désormais situé à plus de 400. Ce score (supérieur de 4 points à celui du Lib-dém) éclipse la performance en définitive peu convaincante du Labour (31 %) et la résistance somme toute très relative des tories (29 %).
En quête du rebond
Pour prendre de court les contestations internes à son parti, et avec comme point de mire les élections générales de 2015, plus que jamais incertaines, au début de l’été, D. Cameron remanie son cabinet qu’il déleste de ses poids lourds (W. Hague, K. Clarke et G. Young) tout en prenant soin de maintenir à leurs fonctions ses proches G. Osborne et T. May, ainsi que les alliés lib-dém il confie des responsabilités à nombre de jeunes affidés, en particulier des femmes.
Les perspectives d’une sécession de l’Écosse mettent un temps entre parenthèses les grandes manœuvres politiciennes : au vu des sondages qui, dès le début septembre, n’excluent plus une victoire du « oui » au référendum sur l’indépendance défendu à Edimbourg par le Premier ministre A. Salmond, les leaders des grands partis britanniques ne cessent de se relayer sur place pour défendre le maintien de la province dans le royaume et promettre à cette dernière l’octroi de prérogatives élargies, en matière fiscale notamment. Or c’est cette dernière option que finalement, le 18 septembre, dans un contexte de forte participation (près de 85 %), la population embrasse à plus de 55 %. D. Cameron réitère dès lors son engagement à conférer au Parlement régional plus de pouvoir, en l’assortissant d’une contrepartie, à savoir un réaménagement du schéma institutionnel de dévolution qui donnerait aux élus d’Angleterre la possibilité se prononcer seuls sur les propres affaires de cette dernière. Ce faisant, il aiguise non seulement les appétits autonomistes des autres pays du royaume, mais surtout il rompt le climat d’union sacrée qui prévalait sur le sujet entre les partis en brandissant un chiffon rouge à l’endroit des travaillistes, inquiets à l’idée de voir leur représentation aux Communes fondre avec l’éventuelle soustraction de leur bastion calédonien.
Confortés par les bons chiffres de l’activité (croissance 2014 à 2,6 %, chômage à 5,7 %), les tories doivent cependant faire face aux répercussions de nouveaux scandales financiers (affaire HSBC révélée en février 2015) et s’avèrent impuissants à enrayer le ralliement de certains de leurs membres et de leurs électeurs à un UKIP menaçant. En novembre 2014, A. Salmond, démissionnaire, laisse place, à la tête de l’exécutif provincial et du SNP, à sa dauphine, Nicola Sturgeon, tout aussi déterminée à porter le projet indépendantiste et à incarner le particularisme de gauche de l’Écosse. En revanche, E. Miliband peine à entraîner derrière sa personne et son programme le peuple ouvrier les classes moyennes et jusqu’à une partie de l’appareil travailliste.
En difficulté dans les sondages, D. Cameron choisit de droitiser ses positions, notamment à propos de l’Europe, de l’immigration, des menaces terroristes, du déficit (5,3 % du PIB), et de ses implications en termes de réduction des dépenses de l’État. Dès le début de l’année 2015, il se rallie à l’idée d’avancer le référendum sur le maintien ou non du royaume dans l’UE, et fait du sujet un axe majeur de la campagne qui s’ouvre, non sans embarrasser un peu plus le Labour, seule formation à ne pas soutenir le principe d’une pareille consultation populaire. Indécis, terne, privé en partie de la figure du Premier ministre qui décide de ne pas affronter directement ses concurrents pour rester au-dessus de la mêlée, au risque, effectif, de devenir leur cible conjointe, le débat porte avant tout sur le score éventuel des petits partis SNP et UKIP qu’analystes et états-majors conservateurs et travaillistes s’ingénient à présenter comme putatifs faiseurs de roi, partant comme épouvantails pour leurs électorats respectifs.
Or contre toute attente, les élections du 7 mai 2015 ne donnent pas naissance à un nouveau « hung Parliament » (Parlement « suspendu »), où l’un des deux grands partis serait contrait de former une coalition avec un tiers pour pouvoir prétendre gouverner, mais à une majorité absolue de tories : 330 députés (sans le speaker), et 36,9 % des voix, contre 232 et 30,4 % à un Labour qui ne sauve qu’un élu de son contingent écossais (40) et essuie sa pire défaite en termes de sièges depuis l’ère Thatcher. Le SNP (4,7 %) rafle pour sa part 56 des 59 circonscriptions calédoniennes, tandis que les lib-dem s’effondrent, avec seulement 7,9 % des suffrages et 8 députés. Autre surprise : si l’UKIP arrive en troisième position avec près de 4 millions de bulletins, il n’emporte que 12,6 % des suffrages et n’obtient qu’un représentant. Son leader N. Farage, battu, démissionne de la tête de sa formation conformément à son engagement de campagne avant de revenir cependant très vite sur sa décision. E. Miliband et N. Clegg pour leur part tirent les conclusions du net désaveu des électeurs en raccrochant leurs casquettes de dirigeants politiques.
4. Les conservateurs (seuls) au pouvoir (2015-)
4.1. Une rapide accumulation de nouveaux obstacles
Validé dans ses orientations et choix tactiques, et reconduit au 10 Downing Street, D. Cameron peut désormais composer un cabinet 100 % tory où il renouvelle sa confiance à ses fidèles – G. Osborne à l’Échiquier, T. May à l’Intérieur, P. Hammond au Foreign Office, M. Fallon à la Défense ou M. Gove à la Justice – en faisant plus de place aux eurosceptiques du parti. Or, malgré la victoire et ces concessions, ce sont ces derniers qui font très vite entendre une voix discordante et mettent fin avant même le début de l’été à l’état de grâce dont la nouvelle équipe bénéficie. Aux Communes en juin, ils sont une cinquantaine à se constituer en sous-groupe ouvertement favorable au « Brexit » (sortie du royaume de l’UE). Et ils sont 37 en septembre à mêler leurs votes à l’opposition travailliste et SNP pour mettre le Premier ministre en minorité et interdire à l’exécutif de fixer la date du référendum moins de 4 mois avant sa tenue et de mener campagne le mois précédant celle-ci, privant par conséquent l’un et l’autre d’un pouvoir de décision et d’une capacité d’influence stratégiques.
En parallèle, la présentation à la fin juin du projet de budget et l’annonce des coupes drastiques dans les dépenses publiques (de l’ordre de £12 milliards par an, dans le but d’abaisser leur part dans le PIB à un plancher de 36 % du PIB – et d’apurer le déficit à l’horizon 2020) précipitent des centaines de milliers de citoyens protestataires dans les rues des grandes villes du royaume. D. Cameron est aussi confronté à la pression migratoire redoublée du Kent, au débouché de Calais, et à ce titre joue de fermeté avec les autorités françaises, quitte à les indisposer, alors même que les chiffres officiels pour 2014-2015 qui font état d’un nombre record d’entrées dans le pays contredisent singulièrement les objectifs de réduction affichés en la matière. Ce dossier le place un peu plus en porte-à-faux, lorsqu’à la fin de l’été, le sort des réfugiés du Moyen-Orient émeut l’opinion et qu’une partie d’entre elle juge trop timoré l’assouplissement de leurs conditions d’accès finalement concédé.
Toutefois, l’hostilité à l’immigration semble bien l’emporter pour devenir l’une des principales motivations du vote en faveur du « Brexit » en juin 2016 (51,9 % des voix), dans un pays gagné par l’euroscepticisme depuis le début des années 2010.
4.2. Le gouvernement minoritaire de Theresa May
Succédant à D. Cameron dans la foulée du référendum en faveur du « Brexit », Theresa May forme un premier gouvernement en juillet 2016 ayant encore l’appui d’une majorité, divisée, de 330 tories. Boris Johnson, ancien maire de Londres et virulent « brexiter », est nommé aux Affaires étrangères, tandis que P. Hammond, qui s’était rallié tardivement au camp des europhiles, succède à G. Osborne à la tête de l’Échiquier. Amber Augusta Rudd, une proche de T. May, est nommée à l’Intérieur. Plusieurs membres du gouvernement Cameron sont maintenus à leur poste tandis que cinq ministres sont remerciés. Un ministère chargé du « Brexit » (Secretary of State for Exiting the European Union) est créé. Toutefois, ce cabinet est de courte durée et, dans l’intention de renforcer son assise lors des négociations à venir sur les modalités de la sortie de l’UE, T. May propose en avril 2017 des élections anticipées pour le mois de juin.
Cette décision reçoit notamment le soutien du parti travailliste, dont les militants ont largement confirmé (septembre 2016) leur nouveau chef Jeremy Corbyn, élu l’année précédente sur un programme de gauche, anti-austérité, tournant résolument le dos au « New Labour » de Tony Blair, mais en butte à l’hostilité d’une majorité d’élus. La question du « Brexit » divise également profondément ce parti, entraînant notamment l’opposition d’une cinquantaine de parlementaires à la loi, adoptée en février 2017, habilitant la Première ministre à demander la sortie de l’Union, contre laquelle se prononcent aussi cinquante députés nationalistes écossais et sept des neuf libéraux-démocrates.
Alors que le Royaume-Uni est de nouveau la cible du terrorisme – après une attaque à Londres le 22 mars et un attentat-suicide à l’issue d’un concert à Manchester le 22 mai, la capitale est encore frappée le 3 juin -, les élections du 8 juin, loin de clarifier la situation politique comme l’escomptait la Première ministre, la rendent plus complexe, plus fragile et plus instable.
Contrairement aux pronostics et bien qu’obtenant plus de 42 % des voix, son meilleur score depuis 1983, le parti conservateur perd sa majorité en reculant de 13 sièges. Avec 40 % des suffrages, le Labour obtient 30 sièges de plus qu’en 2015 et enregistre son meilleur résultat en voix depuis 2001, faisant quelque peu taire les oppositions à la nouvelle ligne politique du parti. De son côté, le SNP perd une vingtaine de députés, un recul qui incite N. Sturgeon à reporter la convocation d’un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse.
Un autre résultat de ce scrutin est l’effondrement de l'UKIP qui, ayant perdu sa raison d’être et après avoir essuyé une cuisante défaite aux élections locales de mai, ne recueille que 2 % des voix et disparaît de la Chambre. Avec 317 députés tories, T. May doit ainsi négocier avec les loyalistes nord-irlandais du DUP (Democratic Unionist Party, 10 sièges) pour obtenir une majorité serrée et former son deuxième gouvernement très largement consacré aux négociations avec l’Union européenne. Les ministres chargés des postes clés – Affaires étrangères, Intérieur, Finances, « Brexit » – sont reconduits.
Au plan économique, la politique d’austérité est dans un premier temps poursuivie, mais l’objectif d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2020 pourrait être compromis avec la sortie de l’UE dont la perspective et les incertitudes produisent déjà leurs effets sur la croissance en ralentissement depuis 2016. L’une des principales mesures est ainsi le maintien du gel des prestations sociales alors que la dépréciation de la Livre a entraîné une augmentation du coût de la vie, avec une inflation frôlant en septembre 2017, pour la première fois depuis 2012, la barre des 3 %.
En octobre 2018, le déficit public ayant été ramené de plus de 10 % du PIB en 2009 à environ 2 %, et avec une inflation se situant autour de 2 %, le gouvernement, tablant sur des prévisions plus optimistes, annonce cependant un assouplissement de la rigueur.
4.3. Boris Johnson
Après la démission de T. May en juin 2019, Boris Johnson, candidat favori par une majorité de députés du parti conservateur, est élu à la tête de ce dernier au second tour, avec 66 % des voix des adhérents devant Jeremy Hunt. Entré en fonctions en juillet, il doit cependant affronter de nouvelles difficultés : décrié par certains pour ses engagements et ses propos contradictoires, voire mensongers, il se heurte notamment à l’hostilité des parlementaires et d’une grande partie de la population à la suite de la suspension du Parlement (déclarée illégale et annulée par la Cour suprême), perd sa majorité après la défection d’une vingtaine de députés, puis essuie un nouveau camouflet à Westminster lors de la présentation du projet d’accord remanié avec l’UE sur le Brexit, ce qui l’oblige à demander un nouveau report de la date de ce dernier au 31 janvier 2020.
Afin de débloquer la situation, des élections anticipées sont finalement convoquées le 12 décembre. À l’issue d’une campagne menée en martelant surtout son slogan « get Brexit done », sans oublier cependant des promesses d’ordre sécuritaire ou social, notamment quant à l’amélioration du système de santé (National Health Service, NHS), B. Johnson gagne triomphalement son pari. Les conservateurs remportent plus de 43 % des suffrages et une majorité absolue de 365 sièges, parvenant même à s’imposer dans certaines circonscriptions traditionnellement acquises au parti travailliste qui, de son côté, essuie une lourde défaite avec 32 % des voix et 203 sièges. Desservi par la polémique sur l’antisémitisme rampant depuis plusieurs années dans les rangs du parti, J. Corbyn semble surtout avoir souffert des ambigüités de son propre projet de sortie de l’UE et n’être pas parvenu à convaincre par son programme économique et social.
Ayant décidé de faire profil bas pour ne pas diviser le camp des brexiters, le récent Brexit Party de Nigel Farage n’obtient aucun siège tandis qu’avec 11 députés, les libéraux-démocrates ne réalisent pas la percée espérée depuis leur succès au scrutin européen.
En revanche, le SNP est renforcé avec 48 sièges sur 59 tandis que le DUP perd non seulement son pouvoir d’arbitre, mais également 2 sièges, les unionistes (8) étant désormais minoritaires au sein de la représentation nord-irlandaise (17) au Parlement britannique.
Le programme du gouvernement de B. Johnson comprend en priorité la réalisation, dans le délai le plus court possible, du plan de sortie du Royaume-Uni de l’UE, mais également des mesures en faveur du NHS, des investissements dans les infrastructures et la technologie tandis qu’une augmentation du salaire minimum est annoncée en décembre. Une politique d’immigration restrictive (ou sélective) est également à l’ordre du jour.
5. La Grande-Bretagne et l'Europe
5.1. Tony Blair l'europhile
Premier ministre britannique le plus europhile depuis Edward Heath, Tony Blair entend arrimer son pays à l'Europe. La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est intégrée à la loi britannique. Il signe également le chapitre social européen, mais décide, en octobre 1997, que son pays ne participera pas à la première vague de l'euro (1er janvier 1999). Après la mise en place de la monnaie unique, le Premier ministre britannique accélère les préparatifs d'adhésion à l'Union économique et monétaire (UEM) avec l'annonce d'une série de mesures techniques concernant les administrations du pays (février 1999). Mais le débat reste très politique. L'Europe, en effet, ne semble toujours pas être un thème porteur pour les Britanniques comme le démontre le taux d'abstention considérable aux élections européennes de juin 1999. Devant cette indifférence hostile de la population, le Premier ministre décide de se donner du temps, repoussant depuis sans cesse la question de la monnaie unique.
La « troisième voie »
En 1999, la promotion de la « troisième voie », de concert avec son homologue allemand, participe du souci de construire une Europe moins fédérale, qui reposerait sur un faisceau de liens bilatéraux. Ainsi le Premier ministre multiplie-t-il les propositions de partenariat idéologique ou conjoncturel avec les responsables politiques « amis », de Schröder aux Scandinaves, et cherche à les étendre avec les chefs de gouvernement belge, espagnol et même italien. L'élargissement de l'Union européenne à l'Est lui semble pouvoir permettre le renforcement de cette politique d'accords ponctuels. Le leader britannique espère compenser la perte d'influence que la non-adhésion de son pays à la monnaie unique est susceptible d'entraîner dans le concert des nations et de la politique continentale. Il entend également contrebalancer le couple franco-allemand, qui continue de peser sur la définition des priorités de l'UE. En 2003, la question irakienne met en pleine lumière certains attendus de cette stratégie : le Royaume-Uni figure au premier rang d'une « nouvelle Europe » (Espagne, Italie, Pologne), coalition avec les États-Unis qui s'oppose à la « vieille Europe », regroupée autour de l'axe Paris-Berlin.
Au même moment toutefois, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne élaborent à nouveau un projet de défense commune et réactivent leur coopération. Les célébrations du centenaire de l'Entente cordiale, qui culminent à Paris en avril 2004, donnent aux deux partenaires l'occasion de réchauffer leurs relations quelque peu refroidies par l'affaire irakienne.
La présidence britannique de l'UE
Alors que le pays s'apprête à prendre la présidence de l'UE pour le second semestre, les questions communautaires restent singulièrement absentes de la campagne de mai 2005. Au reste, l'UKIP disparaît quasiment de la scène politique. L'échec des référendums français (29 mai) et néerlandais (2 juin) sur le traité de Constitution européenne contraint Tony Blair l'europhile à enterrer le projet de soumettre au suffrage des électeurs l'adhésion de son pays à la zone euro. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement des 16 et 17 juin à Bruxelles s'étant en outre heurté au blocage français sur la Politique agricole commune (PAC) et au blocage britannique sur la ristourne communautaire dont bénéficie le Royaume, c'est d'une Union en panne, sans prévision de budget 2007-2013, que le Premier ministre prend la tête le 1er juillet 2005. Il obtient néanmoins en octobre un accord pour l'ouverture des discussions sur l'entrée dans l'Union de la Croatie et de la Turquie, et arrache en décembre un compromis sur un budget prévisionnel pour 2007-2013, liant la diminution du rabais de 10,5 milliards d'euros à la promesse d'une renégociation de la PAC à l'horizon 2008-2009.
Peu avant de quitter Downing Street, le 23 juin 2007, T. Blair négocie âprement l'adhésion de son pays au projet de traité européen simplifié proposé par le nouveau président français Nicolas Sarkozy lors de la conférence intergouvernementale de Bruxelles, et obtient les dérogations exigées – l'exemption de l'application de la charte des droits fondamentaux et la limitation de la participation du Royaume-Uni aux politiques définies par la majorité qualifiée.
5.2. Gordon Brown
Contrairement aux attentes nées de son arrivée au pouvoir en 1997, T. Blair laisse à son successeur Gordon Brown, un pays plus que jamais éloigné de la zone euro et en marge de l'Union – perspective qui sied parfaitement au nouveau locataire de Downing Street, d'où l'acceptation par ce dernier du traité au Conseil européen d'octobre à Lisbonne. Non sans susciter dans son pays une demande de référendum étayée par des tories désireux de le déstabiliser et d'en découdre politiquement avec lui : l'Europe, outre-Manche, demeure en effet avant tout une question de politique intérieure. En mars 2008, les Communes rejettent une proposition sur le sujet et votent le texte, lui aussi finalement approuvé par les Lords en juin, malgré le « non » irlandais et de multiples démarches visant à le repousser. Signe des temps, en obtenant la ratification du traité par son pays, G. Brown l'eurosceptique apparaît comme l'un des promoteurs de la cause européenne. De même, au plus fort de la tempête financière de l'automne 2008, c'est son plan de sauvetage du système bancaire britannique qui sert de modèle aux discussions de l'Eurogroupe réuni à Paris le 12 octobre, et dont il est l'invité vedette. Mais l'aggravation de la conjoncture nationale et internationale ne permet toutefois pas d'aller plus loin dans le rapprochement : les vieux tropismes, notamment atlantiques, reprennent le dessus, ainsi que l’atteste le résultat du scrutin européen de juin 2009 : avec 16,5 %, l’UKIP confirme son score de 2004 et arrive second, derrière le parti conservateur. Quant au BNP d’extrême droite, il fait élire 2 représentants et entre ainsi au Parlement de Strasbourg. Pourtant, c’est à une Britannique, la baronne travailliste Catherine Ashton, qu’échoit le poste de chef de file de la diplomatie européenne en novembre 2009, où elle échoue par un effacement que beaucoup déplorent.
5.3. David Cameron
Par ailleurs, les tories, qui, peu avant la consultation, ont fait connaître leur intention de quitter le PPE (parti populaire européen) et de siéger dans un groupe antifédéral, finissent par rabattre quelque peu leur euroscepticisme : en novembre, David Cameron renonce à la promesse de tenir un référendum sur l’adhésion au traité de Lisbonne en cas de victoire aux élections générales de mai 2010. En outre, l’alliance qu’il noue avec les libéraux-démocrates notoirement pro-européens à l’issue de ces dernières invite les membres de sa formation à tempérer leur tendance à l’opposition frontale à l’UE.
David Cameron remise très vite son engagement de campagne en faveur du rapatriement des compétences communautaires déléguées, au grand dam des eurosceptiques majoritaires dans son parti. En revanche, il ne peine guère à trouver un accord avec ses principaux partenaires pour venir en aide (financière) à l’Irlande en novembre puis geler le budget de l’UE jusqu’en 2020, au nom de l’austérité en vigueur dans son pays comme dans le reste de l’Europe. En visite en Turquie en juillet, il ne rompt pas avec la ligne de ses prédécesseurs et se prononce pour son adhésion à l’UE.
Par ailleurs, il poursuit le rapprochement, notamment militaire, avec la France, de façon à pouvoir partager l’effort de défense et à permettre de tailler dans les budgets respectifs (novembre 2010). À partir de mars 2011, consolidant un axe Paris-Londres en nette opposition à Berlin, il prône le soutien de l’UE, de l’ONU et des États-Unis aux rebelles libyens au colonel Kadhafi, obtient l’intervention de l’OTAN à leurs côtés et participe à la chute du régime de Tripoli (22 août), prolongeant ainsi le mouvement du « printemps arabe ».
En revanche, la faillite de la Grèce, la crise de l’euro, la défense des intérêts de la City et la grogne de plus en plus manifeste des eurosceptiques conduisent D. Cameron à se singulariser lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement de Bruxelles en décembre 2011 et à rejeter l’accord de solidarité et de discipline budgétaires élaboré par les 26 autres membres de l’UE. Le débat qui s’amplifie durant l’été 2012 dans le pays oblige le Premier ministre à faire assaut d’intransigeance, à exiger de ses partenaires européens des garanties pour le royaume, et même à proposer pour après 2015 la tenue d’un référendum sur son maintien dans l’espace communautaire. Cette stratégie s’avère payante, puisqu’à la fin 2012, à l’instar de M. Thatcher, il obtient de ses partenaires un rabais sur la contribution de son pays aux caisses de l’UE puis, au début de l’année suivante, pour la première fois dans l’histoire de l’Union, une baisse du budget des 27 pour la période 2014-2020. En outre, au même moment, il contre les propositions de refonte des textes communautaires et de renforcement de la zone euro avancées par A. Merkel. Sur le front intérieur, l’idée de référendum qu’il finit par faire sienne transforme la question européenne en enjeu des futures élections générales de 2015, plaçant ses adversaires et concurrents politiques dans l’embarras.
Face à la pression qu’exerce sur une partie notable de son électorat la concurrence d’UKIP, le Premier ministre renchérit sur la double thématique anti-européenne et anti-immigration : à la fin de l’année, il dénonce un des piliers de l’UE, la libre circulation des personnes dans l’espace communautaire, au point de heurter, une fois de plus, la sensibilité des libéraux de sa coalition. Il franchit une ligne supplémentaire en demandant, au début 2014, une renégociation du traité européen, ce qui lui vaut des fins de non-recevoir et un isolement accru au sein du conseil de l’Europe. Il récidive après les élections de mai et le succès dans le royaume des europhobes de l’UKIP en s’associant avec le populiste hongrois Viktor Orban pour contrecarrer l’élection de Jean-Claude Juncker à la tête de la commission. À nouveau en vain, mais non sans déplacer les équilibres au sein du royaume, puisque N. Clegg en août affiche son ralliement aux propositions sur l’immigration de D. Cameron.
Décidé à faire du dossier de l’UE un sujet majeur et clivant de la campagne de 2015, il maintient ses positions de fermeté et d’intransigeance sur le budget communautaire, la contribution britannique, les compétences partagées et l’immigration, au point de susciter, face à ses desiderata, un front de résistance continentale, notamment franco-allemand. Il n’empêche : aux premiers jours de 2015, il promet qu’en cas de réélection, il avancera à 2016 ou 2017 la tenue du référendum sur l’appartenance du royaume à l’Union. Reconduit à Downing Street, et libéré de l’alliance avec les europhiles lib-dem, il devient dès lors l’otage du courant minoritaire, mais influent et croissant, des eurosceptiques de son parti, sur fond d’inquiétude générale, nourrie du renforcement de la pression migratoire sur le pays.
En février 2016, D. Cameron annonce que le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (« Brexit ») se tiendra le 23 juin. Le 24 juin, les résultats du vote donnent l’avantage au camp du « Brexit » (51,9 % des voix) ou « leave ». Le Premier ministre, qui avait fait campagne pour le maintien dans l’UE, démissionne en juillet et est remplacé par Theresa May.
Tandis que l’attachement à la souveraineté nationale, la préservation de l’identité culturelle (anglaise) et l’hostilité croissante à l’immigration semblent bien plus déterminantes que les questions d’ordre économique dans le résultat du référendum, celui-ci dévoile d’importantes divisions sociales et territoriales : le vote en faveur du maintien (remain) dans l’UE l’emporte notamment largement à Londres (59,9 %) en Écosse (62 %) et en Irlande du Nord (55,8 %). Majoritaire dans l’ensemble des autres régions, jusqu’à plus de 59 % dans les West Midlands, le « leave » l’est aussi surtout dans les campagnes (55 %), dans les plus petites villes et au sein de la classe moyenne en déclin tandis qu’il augmente avec l’âge. Le « remain » est largement majoritaire dans certaines grandes agglomérations comme Manchester (60,4 %) Liverpool (58,2 %) Bristol (61,7 %), le résultat étant plus serré dans d’autres comme Birmingham. Il l’emporte aussi parmi les électeurs âgés de moins de 50 ans.
5.4. Theresa May
Héritant ainsi du dossier européen, T. May s’attache, envers et contre tout, à tenter de négocier avec Bruxelles – Michel Barnier étant chargé des négociations depuis octobre 2016 – les conditions les plus avantageuses possibles d’une sortie du Royaume-Uni de l’UE. S’étant prononcée elle-même pour le maintien au sein de l’Union, mais timidement et sans faire campagne en sa faveur, elle s’engage résolument à respecter le choix des Britanniques, rejetant les critiques qui s’élèvent quant aux conditions dans lesquelles le référendum de juin 2016 a été organisé et qui s’amplifient jusqu’à envisager même la tenue d’une nouvelle consultation.
La première étape est franchie en février 2017 avec le vote de la Chambre des communes qui, bien que majoritairement hostile au « Brexit » huit mois plus tôt, autorise le gouvernement à en déclencher la procédure par le recours à l’article 50 du traité de l’Union européenne. Mais après les élections de juin 2017, la tâche de T. May s’avère beaucoup plus ardue et plus complexe. Fragilisée et contestée au sein de son parti, dépendante du soutien des unionistes nord-irlandais, elle parvient toutefois à surmonter les obstacles en négociant des compromis pour éviter un blocage.
Bien qu’écartant cette alternative, la Première ministre est tiraillée entre les partisans d’un « Brexit dur » et les plus modérés favorables à un « Brexit doux ». Le premier entraînerait une sortie du marché unique européen, voire de l’Union douanière, avec rétablissement des droits de douane et d’autres barrières protectrices tandis que serait mis fin à la libre circulation des personnes entre le continent et le Royaume-Uni. Le second permettrait à la Grande-Bretagne d’avoir toujours accès au marché européen pour certains secteurs stratégiques de son économie, tandis qu’une forme de libre circulation des personnes ainsi qu’une contribution britannique au budget européen seraient maintenus.
Les Conseil européens du 29 avril et du 22 mai 2017 fixent cependant le cadre strict et les priorités de la première phase des négociations, conformément au principe selon lequel il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, notamment : la sauvegarde des droits des citoyens de l’UE et du Royaume-Uni, ainsi que des membres de leur famille, qui seront affectés par le « Brexit » ; le financement par Londres de l’ensemble des obligations contractées pendant que le pays était membre de l’Union ; le respect des objectifs et des engagements de l’accord de paix pour l’Irlande du Nord de 1998, en évitant la mise en place d'une frontière physique sur l'île d'Irlande.
Des progrès substantiels ayant été obtenus, les parties s’engagent à partir du 15 décembre 2017 dans la deuxième phase des discussions portant sur les modalités transitoires ainsi que sur la conception d'ensemble quant au cadre des relations futures.
Le virage de T. May d’une position plutôt intransigeante à une stratégie plus prudente comportant d’importantes concessions – sur la libre circulation des ressortissants européens, le règlement des engagements financiers du Royaume-Uni et la période de transition en particulier – conduit à la démission du « ministre du Brexit » David Davis, suivie de celui des Affaires étrangères B. Johnson en juillet 2018. Rassemblant ces nouvelles propositions, le livre blanc (ou plan de Chequers) sur les relations futures entre le Royaume-Uni est l’UE est pourtant accueilli avec réserve par Bruxelles.
De son côté, le camp des « remainers » se mobilise également lors d’une manifestation massive à Londres, le 20 octobre, pour demander l’organisation d’un nouveau référendum sur l’accord final.
Tandis que la menace d’une sortie brutale de l’UE (no deal « Brexit ») se fait plus pressante, des discussions ardues débouchent finalement sur un projet d’accord le 14 novembre 2018 prévoyant notamment : la protection des droits des citoyens européens au Royaume-Uni et des Britanniques sur le continent ; une période de transition, de l’entrée en vigueur de l’accord jusqu'au 31 décembre 2020 (pouvant être prolongée une fois, pour une période limitée et conjointement), pendant laquelle le Royaume-Uni restera lié par les obligations européennes comme s’il était un État membre alors qu'il ne participera plus aux organes de l’UE ; des protocoles concernant l’Irlande du Nord, les bases militaires britanniques à Chypre et le territoire de Gibraltar.
Au cœur des mésententes, devant être activé à la fin de la période de transition à défaut d’un nouvel accord global sur les relations futures entre l’UE et le Royaume-Uni d’ici là, le protocole sur l’Irlande du nord (backstop, traduit par « filet de sécurité »), destiné à éviter l’établissement d’une frontière dure entre le nord et le sud de l’île d’Irlande (et entre cette dernière et la Grande-Bretagne), suscite une levée de boucliers chez les « Brexiters ». La solution, très complexe, consiste en effet à maintenir provisoirement, mais pour une période indéterminée si aucune autre solution n’est trouvée conjointement, le Royaume-Uni et l’UE au sein d’un « territoire douanier unique » tandis que l’Irlande du Nord, elle, restera liée aux règles du marché unique européen.
Ce projet provoque alors de nouvelles démissions au sein du gouvernement, au premier rang desquelles celle du nouveau ministre du « Brexit », Dominic Raab, auquel succède Steve Barclay. Attaquée de toutes parts, ayant décidé de reporter le débat sur le projet d’accord, T. May échappe le 12 décembre 2018 à une motion de défiance déposée par des parlementaires conservateurs, dont l’un de ses principaux rivaux, le très controversé Jacob Rees-Mogg, mais, si elle obtient la confiance de 200 tories, l’opposition de plus d’un tiers d’entre eux révèle l’ampleur de la cassure au sein de son parti.
Le 15 janvier 2019, critiqué par les « eurosceptiques » comme par les « europhiles », le projet est ainsi rejeté par 432 voix (dont 118 conservateurs et les 10 députés du DUP) contre 202 (dont 3 travaillistes) à la Chambre des communes. Si, dans la foulée de cet échec cuisant, la motion de censure déposée par J. Corbyn est écartée par 325 députés contre 306, le Royaume-Uni entre dans une grave crise politique.
Obligée de repousser la date du Brexit au 31 octobre et lâchée par son parti après avoir tenté de jouer ses ultimes cartes, Theresa May finit par annoncer sa démission le 24 mai, au lendemain des élections européennes. Mobilisant 37 % des électeurs (35,6 en 2014) ce scrutin est marqué par la sévère sanction des conservateurs qui n’obtiennent que 8,8 % des voix (contre 23,3 % en 2014) alors que le Brexit Party, nouvelle formation de N. Farage, arrive largement en tête avec 30,8 % des suffrages devant les libéraux-démocrates (qui font une percée avec 19,8 %), les travaillistes (affaiblis avec 13,7 % contre 24,7 % en 2014) et les Verts (11,7 %).
5.5. Boris Johnson et le « Brexit »
Fort de sa très large majorité à la Chambre des communes à la suite des élections anticipées du 12 décembre, le Premier ministre B. Johnson s’attelle à sa tâche : obtenir la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sur la base de l’accord de retrait révisé passé avec Bruxelles en octobre 2018 et fondé notamment sur un nouveau protocole concernant l’Irlande du Nord. Le 20 décembre, le projet de loi de retrait de l’Union Européenne (Withdrawal Agreement Bill, WAB) est ainsi adopté en seconde lecture par 358 voix contre 234.
6. La Grande-Bretagne et le monde
6.1. Tony Blair
La Grande-Bretagne ne délaisse pas sa « relation spéciale » avec les États-Unis, comme en témoigne la présence de ses troupes aux côtés de celles des Américains dans les bombardements aériens sur l'Iraq, qui débutent avec une série de frappes intensives fin décembre 1998. À l'unisson cette fois des pays européens, le royaume participe également à l'intervention militaire de l'OTAN en Yougoslavie (mars-juin 1999), contre la politique répressive menée par Slobodan Milošević au Kosovo, puis à la force multinationale de maintien de la paix dans cette province (KFOR). Il intervient en outre pour pacifier une Sierra Leone déchirée par la guerre civile en 2000. Pour Tony Blair, ces opérations attestent l'engagement du pays et, plus largement, de l'Europe dans la défense des principes humanitaires et démocratiques – même si le silence imposé à propos de la Tchétchénie et du Timor-Oriental relativisent cette ambition. Le pays s'associe au pilonnage américain de positions irakiennes en février 2001, premier geste militaire de la nouvelle administration Bush, et témoigne d'un soutien sans faille aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. Avec l'hôte de la Maison-Blanche, T. Blair est le seul dirigeant étranger à déclarer son pays en guerre contre le terrorisme. Il contribue activement à la formation de la coalition chargée de mettre fin au régime des talibans à Kaboul. De fait, le contingent britannique en Afghanistan à l'automne 2001 est le plus important des pays occidentaux après les effectifs américains.
En 2002, T. Blair suit George W. Bush dans sa politique de fermeté à propos de l'Iraq, espérant faire valoir les principes internationaux auprès de son partenaire. En mars 2003, malgré l'opposition de l'ONU et – en Europe notamment – de la France et de l'Allemagne, malgré aussi l'hostilité de la plus grande partie de la population britannique et les très fortes réticences manifestées par les parlementaires de son parti, il entraîne son pays dans la guerre contre l'Iraq préparée par Washington. La victoire de la coalition sur les forces de Saddam Husayn en avril 2003 semble lui donner raison, mais les difficultés rencontrées lors de la pacification de l'Iraq et les affaires qui entourent l'entrée dans le conflit du Royaume-Uni (affaire Kelly, révélations des sévices exercés par les troupes d'occupation, américaines et par la suite britanniques, à l'encontre de prisonniers et de civils) font douter à nouveau l'opinion publique et les partenaires européens du bien-fondé de l'intervention. Au total, en 2004, la lutte contre le terrorisme international coûte au royaume 6 milliards de £, dont 3 pour l'Iraq, où près de 10 000 hommes stationnent toujours en 2005.
Tony Blair, qui veut donner à son pays la place et le rôle de médiateur entre les deux rives de l'Atlantique, ambitionne de faire de l'Europe le principal partenaire des États-Unis. Quitte à irriter, voire s'aliéner, pendant un temps ses homologues ou interlocuteurs continentaux, comme Gerhard Schröder ou Jacques Chirac ; quitte aussi à devoir composer avec la défection de certains de ses alliés européens, tels que l'Espagne ou l'Italie. Malgré cet isolement accru en Europe et la reconnaissance publique du fiasco militaire à la fin de 2006, le Premier ministre maintient fermement l'engagement de son pays. Mais il ne relaie pas l'initiative du président Bush (janvier 2007) qui consiste à vouloir envoyer davantage d'hommes en Iraq.
En juillet 2005, le sommet du G 8 est accueilli et présidé par T. Blair, à Gleneagles, en Écosse. Bien qu'endeuillé par les attentats de Londres, c'est un succès pour la diplomatie britannique, qui parvient à faire accepter son programme d'aide à l'Afrique (annulation de dettes, augmentation de l'effort international contre le sida et la malaria, doublement de l'enveloppe destinée aux pays les plus pauvres du continent à partir de 2010). Cette aura internationale ne sera cependant que de courte durée : à l'été 2006, le Premier ministre, qui, pas plus que le chef de l'État américain, n'a appelé à un cessez-le-feu lors du conflit israélo-libanais, se voit davantage encore reprocher son alignement sur Washington. Quant aux relations avec la Russie, elles tournent à l'aigre en novembre 2006 lors de l'affaire Litvinenko (ex-agent russe réfugié à Londres, mort d’empoisonnement au plutonium 210), qui envenime les relations entre les deux pays jusque dans l'été 2007.
Au début du printemps, c'est avec Téhéran que la tension monte, après la capture de 15 marins par les Iraniens le 23 mars au large du Chatt al-Arab – qui sont relâchés le 4 avril.
6.2. Gordon Brown
Dès son entrée en fonction, au début de l'été 2007, le nouveau Premier ministre Gordon Brown fait du renforcement de la situation en Afghanistan sa priorité, tandis qu'il amorce dès septembre un retrait d'Iraq, se démarquant nettement des choix stratégiques les plus contestés de son prédécesseur : la province de Bassora, QG britannique, est ainsi progressivement évacuée et son administration est remise aux autorités iraquiennes en décembre. Toutefois, au début de 2009, les troupes ainsi dégagées ne sont envoyées qu'au compte-gouttes sur le théâtre afghan.
Quant aux relations avec la Russie, elles se tendent à nouveau à l'été 2007, puis au début 2008. Il en va de même avec la Chine en avril, après le passage mouvementé de la flamme olympique à Londres. G. Brown, par ailleurs, fait savoir qu'il boycottera la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de Pékin en août.
Un temps attiré par l'Europe, le Royaume-Uni de G. Brown retrouve bien vite le chemin privilégié de Washington. Signe du rétablissement d'une relation spéciale quelque peu distendue dans les derniers mois du mandat de George Bush, le Premier ministre est le premier chef de gouvernement reçu par le président Barack Obama (4 mars 2009) avec qui les convergences de vues se révèlent être légion. G. Brown accepte de suivre le plan de ce dernier qui consiste à renforcer les troupes sur place (envoi prévu de 500 hommes supplémentaires), même si, en raison de l’accroissement des pertes, il annonce envisager de concert une amorce de rapatriement à l’horizon 2010. Par ailleurs, les relations entre Londres et Téhéran se tendent à nouveau, après la réélection contestée de Mahmud Ahmadinejad en juin 2009 : accusés d’ingérence dans les affaires internes iraniennes, une dizaine d’employés de l’ambassade britannique sont arrêtés, pour être ensuite relâchés. Un peu plus tard, en novembre, ce sont 5 autres ressortissants qui sont interceptés par les autorités de Téhéran au large de Dubaï, avant d’être également rapidement libérés.
6.3. David Cameron
Pro-atlantiste comme la plupart de ses collègues de parti, David Cameron, nouveau Premier ministre britannique à partir de mai 2010, doit néanmoins composer avec les réticences de ses partenaires libéraux-démocrates et leur penchant europhile. Si le ministre des Affaires étrangères, William Hague, effectue symboliquement sa première visite officielle outre-Atlantique, le chef du cabinet britannique remise bien vite son intention de demander à Bruxelles le rapatriement des pouvoirs communautaires délégués à Londres et doit par ailleurs faire très rapidement face à de multiples objets de tension avec les États-Unis. Le vœu émis par D. Cameron de voir les troupes britanniques cantonnées en Afghanistan de retour au pays d’ici 2015 lors du G 20 de juin, puis à nouveau lors d’une visite surprise sur place en décembre (assorti de l’évocation d’une amorce de retrait dès 2011), la dénonciation par des sénateurs de Washington de la complaisance dont aurait bénéficié Abdelbaset al-Megrahi, auteur de l’attentat de Lockerbie libéré par les autorités écossaises et avec l’aval de Londres pour raisons de santé en août 2009, ou le limogeage du patron de BP (conséquence de l’explosion en avril 2010 au large de la Louisiane de la plateforme Deepwater) et son remplacement par un Américain fin juillet, tendent quelque peu, mais de façon conjoncturelle, les relations entre les deux vieux partenaires : la réception à Londres de B. Obama en mai 2011 vient en effet démentir toute idée de relâchement du lien transatlantique.
Par ailleurs, David Cameron présente le 15 juin 2010, au nom de la Grande-Bretagne, des excuses symboliques aux familles des 14 victimes de la fusillade du Bloody Sunday de 1972 à Londonderry en Irlande du Nord. Deux ans plus tard, le 27 juin 2012, la venue de la reine à Belfast et sa poignée de main symbolique avec Martin McGuinness, numéro deux du Sinn Féin, ancien dirigeant de l’IRA et vice-président de la province, prolongent ce processus de normalisation des relations (un peu plus acté encore lors de la visite officielle à Londres et à Windsor d’une délégation comprenant ce dernier en avril 2014). Mais les tensions qui se font jour dans la province à l’été 2015 puis la démission consécutive du Premier ministre Robinson en septembre soulignent combien ce dernier reste fragile et laissent planer l’incertitude sur son devenir.
De concert avec Nicolas Sarkozy, le Premier ministre britannique s’emploie à forcer la main à B. Obama et à l’obliger à accepter une intervention de l’OTAN aux côtés des rebelles libyens au colonel Kadhafi à partir de mars et surtout d’avril 2011, contribuant à faire tomber le régime du dictateur en août et prolongeant de la sorte le mouvement dit du « printemps arabe ».
Après avoir haussé le ton contre le Pakistan qu’il accuse d’« exporter la terreur » lors de son déplacement de la fin juillet 2010 en Inde, D. Cameron s’emploie à ressouder les rapports entre Londres et Islamabad, notamment en visitant le pays en avril 2011 et en nouant toutes sortes d’accords bilatéraux. En revanche, le vote d’un nouveau durcissement des sanctions contre l’Iran à l’ONU en novembre 2011 ajoute un épisode supplémentaire de tension à l’histoire du différend entre Londres et Téhéran. La tenue en mars 2013 dans les Îles malouines d’un référendum sur le maintien de l’archipel au sein du royaume et la quasi-unanimité qui s’exprime en ce sens n’est pas davantage de nature à apaiser les relations entre la Grande-Bretagne et l’Argentine. De même, les suites de l’affaire Magnitski contribuent à entretenir, au début 2012, suspicion et rancœur entre Russie et Royaume-Uni, et plus généralement même entre Est et Ouest. Le dossier syrien ne contribue pas, loin de là, à détendre l’atmosphère, puisque V. Poutine, farouche défenseur du régime Assad, s’oppose à toute idée d’intervention occidentale en faveur des rebelles, et ne manque pas de le rappeler au Premier ministre quand celui-ci le reçoit en juin 2013 pour le sommet du G8 en Irlande du Nord. Les relations s’enveniment un peu plus encore au début 2014 lors des événements en Ukraine. Londres interrompt sa collaboration militaire avec la Russie après son occupation de la Crimée et, sans pour autant cibler les intérêts des oligarques de Moscou à la City, se mobilise pour que la communauté internationale renforce ses sanctions, y compris économiques et financières, à l’égard du Kremlin. Et à nouveau de plaider, après les manœuvres militaires dans le Donbass, pour un surcroît de fermeté et des rétorsions supplémentaires au sommet de l’OTAN de septembre à Newport au Pays de Galles puis lors du G20 à Brisbane en Australie en novembre.
La « relation spéciale » dont peut se targuer le royaume souffre également pendant l’été 2013 des remous suscités par les révélations effectuées par l’ex-agent de la NSA américaine Edward Snowden sur les activités de surveillance menées par les États-Unis et ses principaux alliés, dont la Grande-Bretagne. Elle est plus encore affectée par le refus des Communes d’autoriser le Premier ministre à utiliser la force pour soutenir les rebelles syriens aux côtés des Français et des Américains à la fin août. En la matière, l’indéfectible second fait faux bond et porte une grande responsabilité dans les progrès sur place de l’État islamique au Levant. À l’été 2014, la proclamation par les djihadistes d’un califat, leurs attaques contre Bagdad ou le Kurdistan, et leurs décapitations d’otages occidentaux, américains puis britanniques, contraignent tour à tour Washington, Londres et des dizaines de capitales à revoir leur politique et à s’engager militairement dans le cadre d’une coalition internationale contre le nouveau pouvoir des terroristes. En septembre 2014, D. Cameron obtient cette fois l’accord des principaux partis représentés aux Communes et une majorité au Parlement vote en faveur de la participation de la Royal Air Force aux frappes aériennes contre ce nouvel ennemi du Moyen-Orient. Mais tout au long de l’année suivante, Londres comme Paris campe sur sa ligne anti-Assad et refuse toute idée avancée par Washington et défendue par Moscou d’une ouverture envers Damas dans le cadre d’un possible règlement politique du conflit syrien. D’où le relèvement des menaces : après avoir endeuillé la capitale française en janvier 2015, les djihadistes ciblent des touristes britanniques à Sousse en Tunisie et font parmi eux 30 victimes à la fin juin.
6.4. Theresa May
Dédiée aux négociations avec l’Union européenne sur les modalités de sortie du Royaume-Uni, la politique étrangère de T. May souffre des aléas que traversent ces discussions au cours des deux premières années de son mandat. La plus grande partie de ses visites à l’étranger après sa prise de fonctions est ainsi réservée aux capitales européennes dans le but d’y présenter sa politique. Certains voient même dans la nomination de B. Johnson au Foreign Office le signe d’un désintérêt pour les Affaires étrangères, hormis cet enjeu européen. La création d’un secrétariat d'État au Commerce international, outre celui chargé du « Brexit », témoigne aussi des nouvelles priorités du gouvernement. Le projet, encore vague et incantatoire, de « Global Britain » dans la perspective du « Brexit » est en effet tourné vers la promotion d’éventuels accords de libre-échange en dehors de l’Europe, notamment avec les États-Unis.
Après celle de la Première ministre à Washington dès l’investiture de D. Trump en janvier 2017, la visite de D. Trump en juillet 2018 semble ouvrir cette voie, qui reste cependant aléatoire, tandis que les relations entre les deux dirigeants sont compromises en raison des concessions faites par la Première ministre à Bruxelles, le président américain n’hésitant pas à encourager un « Brexit dur ».
Resserrer les liens avec les États du Commonwealth fait également partie de ce dessein. T. May se rend ainsi en Inde en novembre 2016 et sa tournée, avec une importante délégation économique, en Afrique du Sud, au Kenya et au Nigeria (la première d’un Premier ministre britannique depuis 2013 – et depuis trente ans au Kenya –), s’inscrit aussi dans ce contexte. Les relations économiques futures sont également au programme de ses voyages au Japon (août-septembre 2017) et en Chine (janvier-février 2018).
Quant aux relations avec la Russie, elles ne font que se détériorer à la suite de l’affaire Skripal, du nom d’un ancien officier russe du renseignement militaire et ex-agent double pour les services de renseignement britanniques, victime avec sa fille d’une tentative d’empoisonnement au moyen d’un agent neurotoxique à Salisbury en mars 2018. Mis ouvertement en cause par Londres, le Kremlin rejette les accusations, dénonçant de son côté une campagne anti-russe, mais les tensions entre Londres et Moscou entraînent un gel des relations bilatérales de haut niveau.
Pour en savoir plus, voir l'article Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.