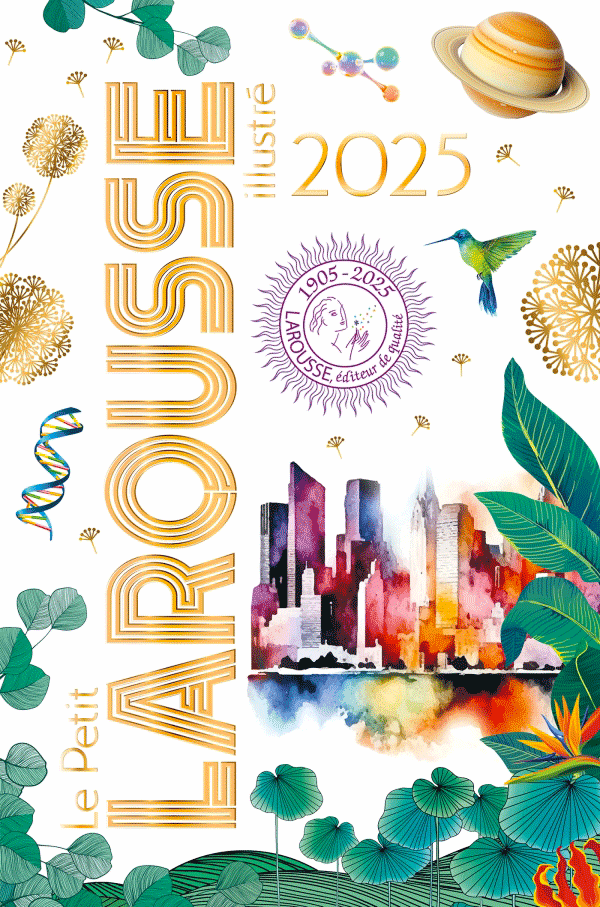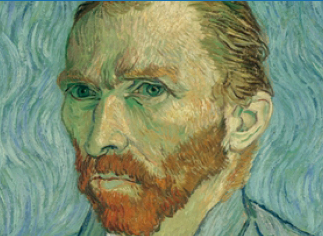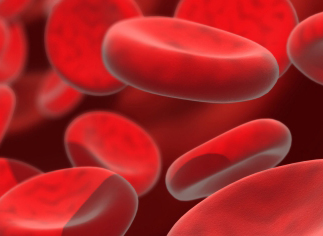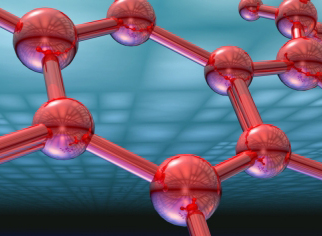Jean de La Fontaine

Poète français (Château-Thierry 1621-Paris 1695).

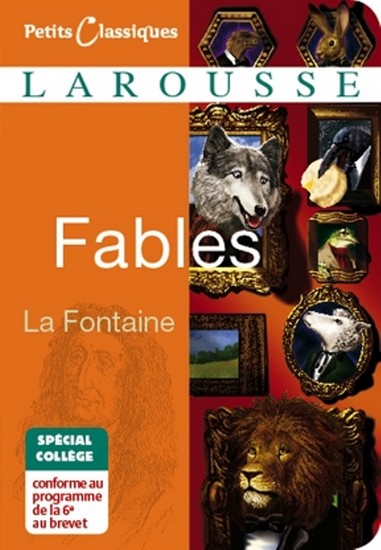
La Fontaine est aujourd’hui le plus connu des poètes français du xviie siècle, et il fut en son temps, sinon le plus admiré, du moins le plus lu, notamment grâce à ses Contes et à ses Fables. Styliste éblouissant, il a porté la fable, un genre avant lui mineur, à un degré d’accomplissement qui reste indépassable. Moraliste, et non pas moralisateur, il pose un regard lucide sur les rapports de pouvoir et la nature humaine, sans oublier de plaire pour instruire.
Famille
Il est né le 7 ou 8 juillet 1621 dans un milieu bourgeois de province ; son père est conseiller du roi et maître des Eaux et Forêts ; sa mère est veuve d'un premier mari, négociant à Coulommiers.
Formation
Il fait des études de rhétorique latine, puis entame des études de droit, interrompues pour entrer à l'Oratoire, en vue d'une carrière ecclésiastique. Après un an et demi, il retourne au droit.
Début de carrière
Il se marie à vingt-six ans avec Marie Héricart. Il fréquente les milieux lettrés. En 1652, il achète une charge de maître des Eaux et Forêts. Il publie, anonymement et sans grand succès, une pièce, l'Eunuque (1654), inspirée de Térence.
Premiers succès
Il écrit deux longs poèmes, Adonis (1658) et le Songe de Vaux (1659), pour son protecteur le surintendant Fouquet, puis un recueil de Contes et Nouvelles (1665).
Gloire et difficultés
Il publie un nouveau recueil de Contes, puis fait paraître, en 1668, les six premiers livres des Fables, ainsi qu'un roman en prose et en vers, les Amours de Psyché et de Cupidon. Après la disgrâce de Fouquet et la mort d'une autre protectrice, il perd son titre de « gentilhomme servant ». Il est accueilli par Mme de La Sablière (1672) et renonce à sa charge de maître des Eaux et Forêts. Il rencontre les grands auteurs du moment : Molière, Racine, Boileau.
La consécration
Il rédige un livret d'opéra pour Lully (Daphné), fait paraître de nouveaux Contes puis, en 1678, une nouvelle édition des Fables largement augmentée. À l'Académie française où il est élu en 1684 malgré l'hostilité de Louis XIV, il lit son Discours à Mme de La Sablière, forme de confession personnelle. Dans la querelle des Anciens et des Modernes, polémique sur les mérites comparés des écrivains et artistes de l'Antiquité et de ceux de l'époque de Louis XIV, il prend parti pour les Anciens. Il écrit un nouvel opéra, l'Astrée.
Dernières années
À la mort de Mme de La Sablière en 1693, il se réfugie chez des amis parisiens. Il rédige ses dernières fables (il en aura écrit 240 au total). Il accepte de renier ses contes et décide de faire pénitence. Il meurt le 13 avril 1695. En 1817, son corps sera transporté au cimetière du Père-Lachaise.
1. La vie de La Fontaine
Si l’on connaît assez peu de détails sur la biographie du personnage, on peut cependant discerner les principales étapes de son parcours et considérer La Fontaine comme un homme mal intégré aux milieux qui font les modes et tiennent les pouvoirs.
1.1. Jeunesse et premières publications (1621-1658)
1.1.1. Le maître des Eaux et Forêts

Jean de La Fontaine est né (baptême le 8 juillet 1621) dans une famille de cette bonne bourgeoisie provinciale d’« officiers » – c'est-à-dire, à l'époque, de fonctionnaires – qui a fourni au xviie s. nombre de ses écrivains. Son père, Charles (1594-1658), était maître des Eaux et Forêts ; sa mère, née Françoise Pidoux (1582-1644), était fille de marchand et veuve d'un premier mari, négociant à Coulommiers. De la jeunesse du futur poète, on sait peu de chose : des études secondaires certainement, et déjà un appétit de lectures qui durera toute sa vie. Vient le temps de choisir un état, une carrière : quelle que soit sa date, la fable du Meunier, son fils et l’âne garde le souvenir de ses hésitations de jeune homme pour trouver sa voie.
Après des études discrètes (achevées sans doute à Paris, où il est condisciple de Furetière), il fait un début de noviciat à l’Oratoire (1641), abandonné faute de vocation, puis une formation en droit (1645), prélude aussi bien au barreau qu’à l’achat d’un office, avant un mariage (1648), sans amour, avec une toute jeune fille de magistrat, Marie Héricart.
En 1652, La Fontaine acquiert une modeste charge de maître des Eaux et Forêts à Château-Thierry ; les charges de son père s’y ajouteront à la mort de celui-ci en 1658. Bourgeois de petite ville, propriétaire terrien, La Fontaine était déjà en contact avec la vie rurale ; par obligation professionnelle, il va acquérir, au contact des gens, de la campagne et de la forêt, l’incomparable expérience qui fera la force et la saveur des Fables.
1.1.2. L'entrée en littérature

La Fontaine exerce sa charge pendant vingt ans avant de s’en dessaisir. Il sera amené aussi à vendre son patrimoine, accablé de dettes en partie par sa gestion insouciante, et plus encore peut-être par le désordre trouvé dans l’héritage paternel et une révision des structures administratives qui, en 1670, rend son emploi incertain.
Il se réoriente alors vers la littérature. Une séparation de biens et de corps intervient entre lui et sa femme. Il devra vivre de sa plume ; revenus bien irréguliers qui l’obligent, comme tout homme de lettres sans fortune personnelle, à entrer dans l’entourage d’un grand : ce sera d'abord le surintendant général des Finances Nicolas Fouquet ; puis la vieille duchesse d’Orléans, dont La Fontaine est « gentilhomme » (la position rapporte peu, ne confère pas la noblesse, mais permet des séjours à Paris) ; puis Mme de La Sablière ; la jeune et turbulente duchesse de Bouillon ; les Vendôme et les Conti ; le financier d’Hervart enfin, chez qui il mourra. Existence qui vaut ce que vaut le protecteur et qui peut amener à d’assez humiliantes compromissions : La Fontaine aura ainsi une vieillesse quémandeuse et sans beaucoup de dignité.

Vers la trentaine, rien ne paraissait le disposer aux grandes aventures intellectuelles ou poétiques, pas même sa liaison avec les « chevaliers de la Table ronde », des jeunes gens amateurs de belles-lettres et qui se feront une notoriété d’écrivains : Pellisson, François de Maucroix, François Charpentier, Tallemant des Réaux ; aucun pourtant qui ait doté la littérature d’un frisson nouveau.
En 1654, une première publication, une adaptation de l’Eunuque de Térence, qui n’est pas sans mérite, tombe à plat.
1.2. La cour de Fouquet (1658-1661)
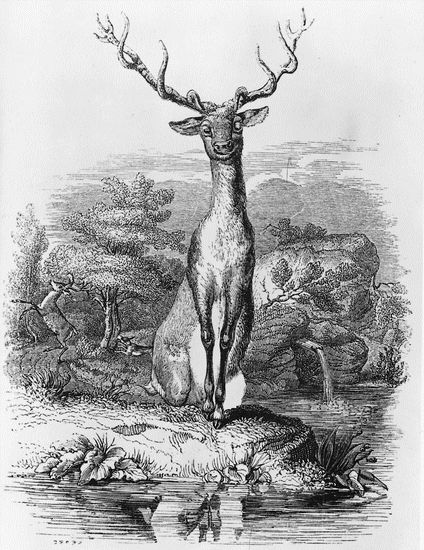
En 1658, le surintendant des Finances Nicolas Fouquet, alors au faîte de sa puissance, se sent en passe d’atteindre à la succession de Mazarin et à la fonction de Premier ministre. Il s’organise, non sans intention de propagande, une cour d’écrivains. Par Pellisson peut-être, ou par un oncle de sa femme, Jannart, substitut de Fouquet, La Fontaine est mis en rapport avec le nouveau mécène, qui le prend sous sa protection et lui fait une pension. À son service, La Fontaine lui dédie un roman mythologique, Adonis (1658), écrit pour lui des vers de circonstance, entreprend une description du château de Vaux-le-Vicomte alors en construction, le Songe de Vaux. Cet ouvrage restera inachevé, mais témoigne de la souplesse de La Fontaine à parler de tous les arts : il y a en lui plus qu’un amateur éclairé, un critique d’art possible. Il est possible qu’il ait déjà composé des contes dès cette époque. Il se lie avec Pellisson, Scudéry, Saint-Évremond, comme lui « clients » de Fouquet.
Mais, en 1661, c’est la disgrâce du tout-puissant ministre, arrêté pour malversations sur ordre de Louis XIV. L’arrestation de Fouquet disperse cette cour de « protégés » intéressée. Parmi les rares fidèles restent La Fontaine et Jannart. Ce dernier organise la défense du surintendant par toute une campagne de publications. La Fontaine écrit alors, en hommage à Fouquet, une Élégie aux nymphes de Vaux (1661) et une Ode au roi pour M. Fouquet (1663). Il est contraint à un temps d’exil à Limoges, période qu’il évoquera en écrivant pour sa femme Voyage en Limousin, chef-d’œuvre d’allégresse, d’humour et de justesse d’observation.

Si la fréquentation de la cour de Fouquet n’a sans doute pas beaucoup infléchi l’art de La Fontaine, elle fut toutefois lourde de conséquences. D’abord, La Fontaine fait figure d’opposant, modestement, au roi et à son principal ministre Colbert, qui, des années durant, lui garderont rigueur de ce courage, le tenant à l’écart des honneurs et des récompenses. Les tentatives de La Fontaine pour atteindre le roi, les dédicaces de fables aux enfants royaux, à la toute-puissante maîtresse Montespan n’y feront rien. Son œuvre se développe en marge de l’organisation officielle du monde littéraire.
Surtout, il a vu, des coulisses, le théâtre politique ; il a été pris dans une débâcle ; il a constaté les reniements qui accompagnent une soudaine disgrâce. Cette expérience amère, mais enrichissante, lui communique un pessimisme souriant et méprisant, auquel les Fables doivent une amertume lucide et somme toute tonique. « Mélancolique et de bon sens », a-t-on dit de La Fontaine au xviie s. L’affaire Fouquet ne pouvait que renforcer ces deux traits.
1.3. Le salon de Mme de La Sablière (1673-1693)

La Fontaine se place alors auprès de grands seigneurs un peu en marge de la Cour (Conti, Bouillon) et de financiers. Il obtient un emploi de gentilhomme au palais du Luxembourg, au service de la vieille duchesse d’Orléans. Après la mort de celle-ci, il devient en 1673 l’hôte, à la fois secrétaire et ami personnel, de Mme de La Sablière. Celle-ci tient un salon que fréquentent des médecins, des hommes de science et aussi un philosophe voyageur, François Bernier, qui a été secrétaire de Gassendi, traducteur de son monumental Syntagma, et qui a fait un très long séjour en Inde comme médecin du Grand Moghol.
Ce salon est sans aucun doute l’endroit où se brassent le plus d’idées nouvelles. La crise de conscience, ou au moins la prise de conscience qui annonce le siècle des Lumières y est plus sensible qu'ailleurs. Avec l’affaire Fouquet, La Fontaine avait connu une grande expérience humaine ; la fréquentation du salon de Mme de La Sablière, jusqu’à la mort de celle-ci en 1693, lui apporte un grand enrichissement intellectuel.
1.4. Les succès littéraires (1664-1687)

Si ses Contes (1664-1665) l’ont rendu célèbre – il en publiera plusieurs suites (1666, 1671, 1674, 1685) –, la gloire vient véritablement avec le premier recueil de ses Fables (1668). D’autres paraîtront en 1678 (les livres VII et VIII) et 1679 (les livres IX, X, XI). La chronologie de la rédaction reste assez complexe. Les Fables semblent être restées longtemps en chantier : La Fontaine en écrit dès avant 1663. Peu d’entre elles pourtant ont été connues avant 1668. Les écrivains du xviie s. ne laissaient pas d’ordinaire leurs œuvres sous le boisseau : ils en faisaient des lectures, permettaient des copies, des publications dans les recueils poétiques ; mais La Fontaine était secret. Il semble aussi que, malgré le succès considérable et immédiat des Fables, La Fontaine se détourne assez vite du genre.
En 1669 paraissent les Amours de Psyché et de Cupidon, œuvres mêlées de prose et de vers, qui rappellent l’inspiration d’Adonis. Une description de Versailles alors naissant fait penser au Songe de Vaux.
En 1671, les Fables nouvelles et autres poésies, outre quelques fables, contiennent quatre Élégies, confidences amoureuses et surtout aveu d’inquiétude amoureuse.

La Fontaine fréquente alors Boileau et Racine. Il donne des gages de son orthodoxie en publiant des Poésies chrétiennes (1671) puis un Poème de la captivité de saint Malc (1673). Entre contes libertins et récits de la vie des saints, La Fontaine révèle dans cette alternance du très profane et du sacré la complexité des attirances entre lesquelles il était partagé.
En 1674, les Nouveaux Contes sont interdits par la censure, mais le succès revient avec le deuxième recueil des Fables (1678-1679). La Fontaine semble ensuite renoncer aux grands ouvrages et égrène les pièces de circonstances, certaines fugitives, célébrant les grands événements politiques ou adressées à ses protecteurs, non sans intentions intéressées ; d’autres, plus mûries. Le poème didactique du Quinquina (1682) reste laborieux.
La Fontaine réussit enfin – malgré l’hostilité du roi (qui suspend d'abord une première élection, en 1683) – à se faire élire définitivement à l’Académie française (1684), à la succession de son ennemi Colbert. Il lit lors de sa réception un Discours à Mme de La Sablière (à ne pas confondre avec celui des Fables), hommage à l’amie qui vit alors recluse, tentative aussi pour se connaître lui-même et définir cette inquiétude qui est l’élément le plus profond de sa personnalité et sans doute la source même de son génie.
Dans la querelle des Anciens et des Modernes, il prend parti pour les Anciens par l’Épître à Huet (1687).
1.5. Les dernières années (1687-1695)

La Fontaine tente ensuite, sans grande réussite, de revenir au théâtre avec une comédie, le Rendez-vous (perdue), des tragédies et des opéras : Astrée (1691), Achille (inachevée et restée manuscrite), Daphné, Galatée (inachevée). Ces tentatives sont autant d’échecs. Le résultat le plus clair en est une brouille retentissante avec Lully.
Il publie le Livre XII des Fables en 1693, terminé par cet admirable testament spirituel qu’est « le Juge-arbitre, l’hospitalier et le solitaire ».
Hébergé par le banquier d’Hervart depuis la mort de Mme de La Sablière, malade, sollicité aussi par ses amis, La Fontaine songe à son salut. Devant une délégation de l’Académie française, il renie ses Contes, prend l’engagement de n’écrire plus que des œuvres de piété. Il écrira en effet des hymnes, perdues ; une traduction du Dies irae a été conservée. Il vivra encore deux ans, portant cilice.
Un grand vide poétique commençait qui contribua à donner sa place à un écrivain dont ses admirateurs même avaient mal compris qu’il était peut-être le plus grand poète du xviie s.
2. L'œuvre de La Fontaine

De l’œuvre de La Fontaine, on ne retient d’ordinaire que les Fables et, secondairement, les Contes, les deux chefs-d’œuvre de la maturité. On en restreint ainsi gravement l’ampleur, la diversité et la portée. En fait, elle est remarquable par sa variété. Il était banal à l’époque d’être polygraphe, d'écrire ainsi beaucoup et sur des sujets si variés, mais il est rare que l’on ait exploré autant de voies que La Fontaine.
2.1. Dramaturge, poète et narrateur
Il a pratiqué tous les genres. Le théâtre d’abord : à ses débuts, mais aussi une fois la célébrité atteinte. L’écriture dramatique était la source des plus vifs succès et des meilleures recettes : si La Fontaine ne trouva pas le succès avec elle, du moins en expérimenta-t-il, de façon approfondie, les ressources.
Il a eu aussi la tentation du récit en prose : récit de voyage sous forme épistolaire (Voyage en Limousin), mais aussi narration romanesque (Psyché).
Il a surtout pratiqué la poésie, tant dans le registre héroïque (Adonis) qu’élégiaque ou galant, tant dans les petits poèmes mondains de circonstance que dans les Contes gais et licencieux, ou encore dans le discours en vers (Discours à Mme de La Sablière).
Les Fables, enfin, représentent un alliage original de la narration, du discours et de l’écriture poétique.
La Fontaine a abordé toutes les thématiques. Le merveilleux païen l’attire : il reprend les mythes d’Adonis et de Psyché, dans la tradition des métamorphoses d’Ovide et d’Apulée. Il donne libre cours à sa verve libertine dans les Contes, où, de maris cocus en moines paillards et en nonnes dévergondées, il prolonge la lignée de l’Arioste, de Boccace et de Rabelais. Mais on lui doit aussi d’importants poèmes religieux et un essai de poésie scientifique (Poème du Quinquina, 1682).
2.2. L’esthétique de la variété

Alors que son époque insiste sur la distinction des genres littéraires, La Fontaine pratique le croisement des styles, des registres et des formes, recherchant des structures neuves, rénovées ou hybrides.
Ainsi, son Adonis, poème héroïque dans le principe, fait une place au lyrisme et s’inscrit dans la lignée des « idylles héroïques », que Saint-Amant a inaugurées quelques années plus tôt.
En reprenant les contes et les fables, formes traditionnelles, il les rénove en apportant à ces modèles narratifs, d’ordinaire traités en prose, le rythme poétique.
Enfin, en entremêlant plusieurs genres, il produit des ouvrages qui peuvent faire figure d’étranges « monstres ». Ainsi, le Songe de Vaux combine les vers et la prose, « l’héroïque et le galant », pour décrire le château de Fouquet (alors en construction) et ses fêtes, à travers la fiction d’un songe. Dans Psyché, qui tient du conte, du roman pastoral et de la rêverie poétique, la légende amoureuse (les amours de Cupidon avec la jeune mortelle Psyché) et le mythe philosophique (Psyché comme symbole de l’âme) forment un alliage sans équivalent.

La poétique de La Fontaine est riche d’éléments baroques, et on a pu parler à juste titre de son « maniérisme » et de l’influence de la tradition de Marot. Mais elle ne renie pas pour autant les principes clefs du classicisme : admiration des Anciens (il prend position en leur faveur dans la Querelle, mais avec modération), souci de régularité et de bienséance. Même dans les Contes, les sujets scabreux sont traités avec humour : La Fontaine y peint moins les troubles du plaisir que l’ingéniosité des amants pour berner la morale confite et ses représentants.
Enfin, l’originalité du ton, de la « manière » fait l’unité profonde de son œuvre. La Fontaine se livre à une série de variations entre le style « soutenu » et le style « médiocre », dans la lignée de l’écriture galante, telle que l’avaient illustrée Voiture et Sarasin, et dont Pellisson s’était fait le théoricien. Mais, alors que celle-ci était essentiellement un moyen de divertissement mondain, il lui fait subir une métamorphose et en tire une langue en apparence naïve, familière et transparente, en fait très calculée et savante. C’est l’art du « naturel » qui s’incarne dans une écriture toute de retenue et de suggestion. Par là, dans une génération où la poésie, après le purisme de Malherbe (qu’il admire) et l’élégance de Voiture (qu’il imite), était menacée de s’enfermer dans trop de convention, de mièvrerie ou d’abstraction, La Fontaine lui apporte une subtilité qui la revivifie.
2.3. Les Contes

Les Contes (1665, 1666, 1671, 1674, 1685) de La Fontaine, chefs-d’œuvre mineurs, ou dans un genre mineur, s’inscrivent dans la tradition des conteurs français et italiens (Boccace, Marguerite de Navarre, Rabelais) et, pour la langue et la versification, dans le sillage de Voiture et de Marot. Ils sont gaillards ; ils prennent à l’occasion pour cible les gens d’Église et vaudront à l’auteur des lecteurs fidèles, des ennemis actifs aussi, dans l’hostilité de qui l'hypocrisie autant que le scrupule ont bien quelque part.
Les Nouveaux Contes (1674) seront interdits par le lieutenant de police. On les a diversement jugés, le plus souvent de façon sévère. Ils sont de tons variés, avec de l’esprit toujours (qui s’applique à dissimuler – mais point trop – des scènes considérées alors comme très osées), et avec de l'émotion parfois. Ils représentent au moins une étape dans l’histoire de la sensualité et de la sensibilité ; ils acheminent la gauloiserie, héritée du Moyen Âge et du xvie s., vers le libertinage élégant du xviiie s.
2.4. Les Fables
Les Fables, sous les apparences d’un genre mineur, composent une véritable somme poétique.
2.4.1. La volonté d'instruire

La démarche de La Fontaine est conforme, pour les principes fondamentaux, aux préceptes de l’esthétique classique. Il se présente comme un simple adaptateur des Anciens : le fabuliste grec Ésope et le fabuliste latin Phèdre. Ésope, dont La Fontaine place une biographie en tête du recueil de 1668, était alors connu de tous. Ses apologues, ces courts récits dont on tire une instruction morale, servaient de thème aux écoliers, de support à leur imagination ; ils avaient à les enrichir et à les développer. Les apologues fournissaient aussi aux orateurs des exempla, des illustrations.
Le modèle antique affirme la vocation des Fables, qui est d’instruire. Pour La Fontaine, la littérature doit être utile autant qu’agréable (« Le conte fait passer le précepte avec lui », le Pâtre et le Lion). Il sait d’ailleurs que plaire est le meilleur moyen pour instruire. Et il ne vise pas seulement l’instruction des enfants. Certes, son premier recueil est dédié à l’enfant qui, parmi tous, est l’élève de choix pour le poète : le Dauphin – mais là encore, comme plus tard dans le fait qu’il s’adresse au jeune duc de Bourgogne, il faut voir la part de la tradition (« Le monde est vieux dit-on, je le crois ; cependant/Il le faut amuser encor comme un enfant », le Pouvoir des Fables).
2.4.2. Un genre renouvelé par un style éblouissant

Pour instruire et plaire, La Fontaine innove beaucoup. Première innovation, souvent négligée, mais non la moindre : le choix du genre. Avant lui, la fable, rédigée en prose, est considérée comme une simple ressource de la rhétorique ; c’est à ce titre que l’art de l’apologue figure dans les exercices de collège. Il avait certes existé une fable en vers au Moyen Âge et au xvie s. Mais ces fabulistes étaient oubliés, et d’ailleurs « en vers » ne veut pas dire nécessairement poétique. La fable était également héritière de l’art de l’emblème, où un précepte moral était illustré à la fois par une gravure et par quelques vers. Le genre était encore très florissant à une époque férue d’allégorie sous toutes ses formes, mais restait marqué par un pédantisme plutôt antipoétique.
La Fontaine confère à la fable, à l’origine humble auxiliaire de la pédagogie ou de l’éloquence, un véritable statut poétique et une dignité inexistante jusqu’alors : « L’apologue est un don qui vient des immortels/Ou si c’est un présent des hommes/Quiconque nous l’a fait mérite des autels » (Dédicace à Mme de Montespan du deuxième recueil).

Cette dimension nouvelle tient à plusieurs aspects. La Fontaine construit des narrations souples, animées par des dialogues au style direct, des notations précises de mouvements ou de détails du décor, si bien qu’ils offrent les éléments d’une mise en scène. Surtout, il introduit dans ces récits d’ordinaire impersonnels le ton singulier que crée l’intervention d’un narrateur dont le « je », à la fois omniprésent et sans cesse se dérobant, commente, juge l’action et interpelle le lecteur. Enfin, à l’enchaînement mécanique entre un récit exemplaire et un précepte moral, il substitue un jeu varié : ses Fables ont parfois une morale explicite, parfois non ; il leur arrive d’en avoir deux différentes ; d’autres fois encore, à l’inverse, une même réflexion suscite deux récits distincts.
La forme utilisée est celle du vers libre : un vers, de longueur inégale et de rimes variées, dégagé de toute règle de la prosodie. La Fontaine a fait longtemps ses gammes, et les Fables bénéficient d’une expérience éprouvée de la prosodie. Sa versification est sans cesse modulée, ses vers irréguliers permettent des variations virtuoses de rythme et de ton. Dans les vers de La Fontaine, pas un mot qui n’ait son poids. Le vocabulaire lui-même est étendu, volontiers technique, parfois délibérément archaïsant, toujours très précisément étudié pour offrir des jeux multiples de connotations, de nuances, d’insinuations et d’audaces voilées.
Enfin, la vertu la plus certaine des Fables est un réalisme poétique qui fait voir, toucher, sentir. Elles sont marquées par les réminiscences multiples, fondues et assimilées avec art, d’un esprit brillant et très cultivé.
2.4.3. La liberté d'inspiration


Le deuxième recueil – celui qui correspond aux actuels livres VII à XI, qui paraissent en 1678 et 1679 – marque le sommet des Fables. L’auteur signale dans un Avertissement deux de ses nouveautés : le recours à une source nouvelle, les récits du sage indien Bidpai (que le savant Bernier, rencontré chez Mme de La Sablière, lui avait fait apprécier) ; l’appel à une méthode nouvelle d’« enrichissement » par les « circonstances », c’est-à-dire la multiplication des précisions dans le récit et la description. Le premier recueil, à côté d’apologues rapides qui se ressentaient encore de la brièveté propre à Ésope, comportait déjà des fables plus amples. Les fables amples deviennent la norme dans le second recueil : l’idée que la brièveté est en soi une vertu ne retient plus le fabuliste.
La fable annexe ainsi tous les genres poétiques : contes de tonalités variées, légers, sérieux ou satiriques (la Fille, le Berger et le roi, Un animal dans la lune) ; pastorale (Tircis et Amarante) ; méditation élégiaque sur le sens de la vie et de l’amour (les Songes d’un habitant du Mogol, les Deux Pigeons) ; réflexion politique à la fois historique et actuelle (le Paysan du Danube) ; discussion philosophique (Discours à Mme de La Sablière).
Tous les thèmes que lui proposent les livres, l’actualité, sa propre expérience – La Fontaine atteint la soixantaine – sont librement traités. L’audace intellectuelle s’affirme ; la peinture de la société, et singulièrement de la vie de cour, devient plus mordante ; une opposition discrète mais ferme à la politique de conquêtes et de gloire militaire s’affirme.
2.4.4. Une œuvre de moraliste
Des leçons inépuisables

Si les Fables peuvent être lues comme un commentaire continu de l’affaire Fouquet, elles s’ouvrent, par-delà l’actualité de leur temps, à la vérité éternelle de l’homme et du monde et proposent un art de vivre. L’homme, vu par La Fontaine, quel que soit son déguisement animal, est doté d’une nature contre laquelle il ne peut rien. La sagesse consiste à s’en accommoder. S’il était venu au monde plus tard, muni donc d’un langage et d’une typologie autres, La Fontaine aurait dit que la société est une jungle. Cela ne l’empêche pas de revendiquer les droits de l’humanité et de la compassion dans une large compréhension pour tout ce qui vit, lutte et souffre.
Mais le sens des Fables, loin de se réduire à une leçon, est inépuisable. Replacées dans l’ensemble de l’œuvre, elles révèlent les contradictions de toute une époque : comme beaucoup de ses contemporains, La Fontaine, grand lecteur de l’Astrée (1607-1628) d’Honoré d’Urfé, rêve d’un paradis pastoral mais, comme les plus lucides, il constate, en même temps que le déclin des rêves nobiliaires d’héroïsme et de générosité, la montée irrésistible des pouvoirs de l’État et de l’argent. Face à une telle situation, il a choisi de préserver les puissances du langage.
Un exercice de lucidité


La Fontaine est un poète moraliste, et non pas moralisateur. Son œuvre n’exprime pas une pensée systématique, mais une attitude de pensée, avec ses évolutions, variations, contradictions même. Aussi réduire l’explication à une seule rubrique est-il vain. Il est de toute évidence ridicule de voir dans l’œuvre une simple description de la nature (et d’y noter du même coup des erreurs de zoologie : les cigales ne survivent pas en hiver, sauf dans les Fables où l’imagination est reine...). D’une autre façon, s’il est vrai que La Fontaine prend certains de ses sujets dans l’actualité (en particulier, la façon dont Colbert a manigancé la chute de Fouquet trouve des échos dans son livre), il ne faut pas faire non plus de la Cigale et la Fourmi une allégorie du conflit entre les deux ministres.
Il convient au contraire de saisir cette œuvre comme un regard qui se veut lucide, et constater que la pensée s’y interroge autant ou plus qu’elle ne répond. Il est certain que La Fontaine est nourri de philosophie épicurienne (épicurisme), de libertinage, qu’il déteste les superstitions (l’Astrologue, l’Horoscope). Mais il est certain aussi qu’il a éprouvé des sympathies pour les jansénistes (jansénisme). De même, en matière de politique, il a critiqué les monarques absolus, victimes de leurs ambitions, de leurs conseillers flatteurs, de la facilité de la violence (les Animaux malades de la peste). S’il témoigne de l’intérêt et de la pitié à l’égard du peuple, il le perçoit aussi comme un « enfant », incapable de se conduire seul, et qui a donc besoin d’être dirigé et protégé, par un pouvoir donc nécessairement fort (et si possible juste).
Une dénonciation des rapports de pouvoir

La rédaction et la publication des Fables s’étendent sur trente années, et la situation du poète a changé, aussi bien que le contexte sociopolitique, au fil des décennies. Aussi voit-on parfois La Fontaine soutenir la politique royale au moment d’une guerre (la Ligue des rats), et d’autres fois, en des temps où la politique de puissance risque de ruiner l’économie, et singulièrement l’agriculture, rappeler les mérites du travail, contre les spéculations et les visées de prestige (le Marchand, le Gentilhomme, le Pâtre et le Fils de roi).
Il y a cependant, dans son attitude, quelques constantes. Tel qu’il le voit, le monde est impitoyable : y règnent seuls les rapports de force. Contre la « raison du plus fort » (le Loup et l’Agneau), les faibles ne peuvent rien, à moins d’être capables de contrebalancer la force par la ruse. Souvent, d’ailleurs, La Fontaine conçoit des situations redoublées, où un fort s’incline devant un plus faible mais plus adroit, et où ce dernier trouve à son tour son maître : cette structure complexe peut aussi bien montrer les apparences vaines des rapports de pouvoir (le Lion et le Moucheron) que des jeux où un trompeur est pris par un trompeur et demi (le Renard et la Cigogne). La vision n’est pas alors moins noire, mais elle a l’avantage de prêter à des effets comiques.
Sans cesse attaché à dénoncer les illusions de tous ordres, La Fontaine est proche de La Rochefoucauld, qu’il cite élogieusement (l’Homme et son image). Pourtant, on n’entend ni cri de révolte, ni plaintes de ressentiment. Parfois, le « je » omniprésent se laisse aller à la mélancolie (« Ai-je passé le temps d’aimer ? », les Deux Pigeons). Plus profondément, il laisse deviner le désir latent du « repos », d’une retraite en marge de ce monde violent, et parfois il l’avoue plus ouvertement (le Songe d’un habitant du Mogol, les Deux Amis). À défaut, il suggère de s’accommoder de son sort et de son état, en renonçant aux ambitions et aux chimères (le Berger et la Mer, la Laitière et le Pot au lait, le Savetier et le Financier).