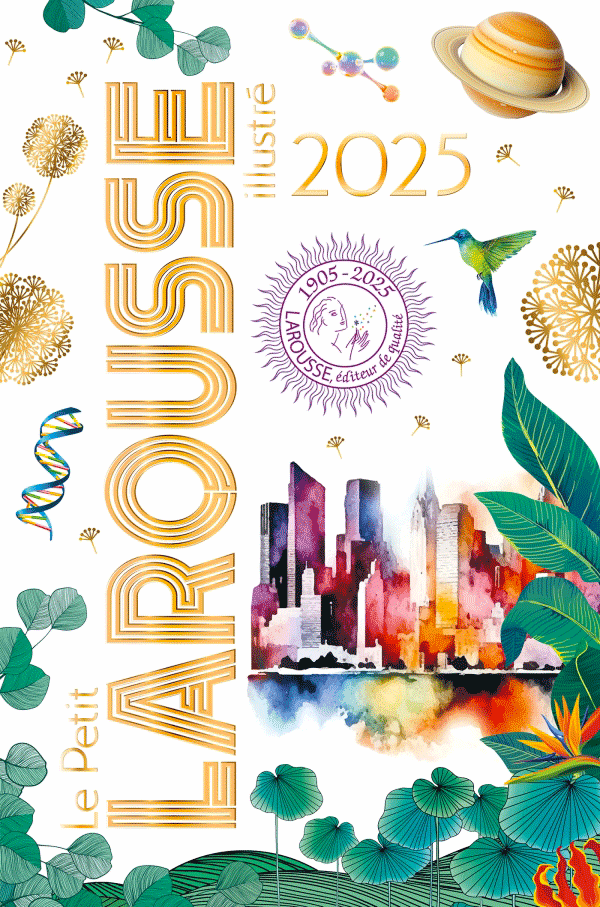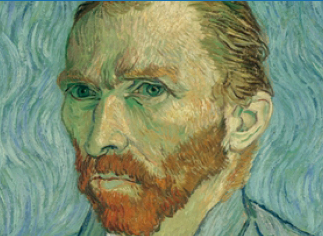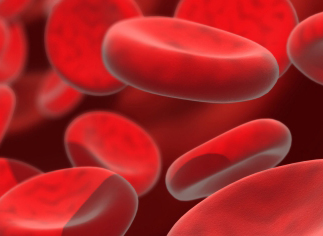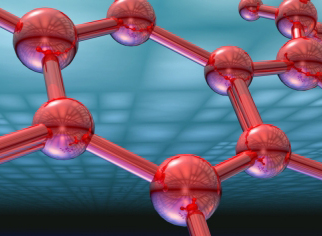Maroc : vie politique depuis 1961
1. Le règne de Hasan II (1961-1999)
Devenu roi en mars 1961, après la mort de son père Muhammad V, Hasan II avait déjà été associé, en tant que prince héritier, aux affaires du royaume. Il a pour premier souci d'asseoir son pouvoir sur des bases fermes, notamment en nivelant les partis dits du Mouvement national (l'Istiqlal et l'UNFP), dont l'importance est encore en mesure de lui disputer une partie des prérogatives qu'il estime vitales. Il inscrit celles-ci dans une première Constitution, adoptée par référendum le 7 décembre 1962, et qui fonde une culture politique axée sur la prééminence royale – tous les pouvoirs, constitutionnels, politiques, militaires, judiciaires, diplomatiques, sont concentrés et hiérarchisés autour du roi –, un rapport de force inégal et une négociation permanente, dans un système où les règles du jeu sont très sévèrement et très étroitement contrôlées. Dès lors, le partage du pouvoir entre le roi et les partis et entre l'exécutif et le législatif domine la vie politique marocaine. Il faudra, en 35 ans, pas moins de 5 moutures de la Constitution et autant de trains d'élections pour modifier, sans le changer fondamentalement, le rapport des forces et apaiser les contentieux.
En septembre 1996, la cinquième Constitution, élargissant enfin les pouvoirs du gouvernement et du Premier ministre, est adoptée à l'unanimité de toutes les forces politiques, y compris celles de l'opposition. Le processus donne naissance, en mars 1998, à un gouvernement d'alternance, dirigé par Abd al-Rahman Yusufi, secrétaire général de l'Union socialiste des forces populaires (USFP).
Entre-temps, et dès 1961, le roi gouverne avec des partis issus de sa propre mouvance et souvent dirigés par ses proches : successivement, le Front de défense des institutions constitutionnelles (FDIC, 1963), le Rassemblement national des indépendants (RNI, 1977), l'Union constitutionnelle (UC, 1983). Ce sont ces formations qui gagneront les élections communales et les élections législatives de 1963, celles de 1976-1977, et celles de 1983-1984, tandis que les voix en faveur de l'opposition passeront de 75 % (communales de mai 1960) à 25 %. La légère remontée de celle-ci en 1993 suscite une offre d'alternance de la part du pouvoir royal, refusée par l'opposition, groupée dans un front, le Bloc démocratique, dont l'avancée au premier tour du scrutin n'est pas confirmée au second tour. Le schéma de mai (communales) et celui de novembre (législatives) 1997 ne sont pourtant pas fondamentalement différents, dans un bicaméralisme reconstitué, mais, vu la situation politique (usure du pouvoir, éparpillement des partis après de nombreuses scissions), l'alternance a néanmoins lieu.
Cette longue lutte politique s'est déroulée en plusieurs périodes et dans un environnement régional très tendu : les différends entre l'Algérie et le Maroc ont constamment jalonné la vie politique de la région depuis les indépendances respectives des deux pays.
1.1. Le régime autoritaire et la crise du Sahara occidental
La première période, de 1961 à 1973, est dramatique : arrestations, en juillet 1963, des dirigeants et des militants de l'UNFP, suivies de grands procès (octobre-novembre 1963), guerre dite « des sables » avec l'Algérie sur une question de délimitation de frontière (octobre 1963), condamnation à mort par contumace de certains dirigeants de l'opposition de gauche, dont Mehdi Ben Barka, en exil, émeutes de Casablanca (mars 1965), état d'exception, en juin de la même année, pour 5 ans, enlèvement et disparition de Ben Barka à Paris (octobre 1965), autres procès en 1970-1971, deux coups d'État militaires, le 10 juillet 1971 (cadets de l'École militaire au palais de Skirat) et le 16 août 1972 (attaque du Boeing royal par l'armée de l'air), mort du ministre de l'Intérieur, le général Oufkir, compromis dans l'attentat contre le roi. La relative ouverture politique offerte par le roi en 1971 (deuxième Constitution) et en 1972 (troisième Constitution) se referme dans une atmosphère de complots (1973) et de nouveaux procès politiques.
À partir de 1974, l'émergence du problème du Sahara occidental (dont la Cour internationale de justice de La Haye est saisie en septembre), que l'Espagne décide de décoloniser, provoque un large consensus autour du trône, hormis une fraction de l'extrême gauche (Ila Atnane), dont l'UNFP (devenu l'USFP en 1976), qui, malgré l'assassinat d'un de ses dirigeants à Casablanca en décembre 1975, amorce un virage politique en abandonnant toute velléité de renverser le régime par la force. Un nouveau souffle est donc donné à Hasan II. La mobilisation patriotique populaire autour de la question du Sahara occidental (la Massirah, « Marche verte », novembre 1975), la montée de la tension avec l'Algérie (bataille d'Amgala en janvier et rupture des relations en mars 1976) font que tous les partis, y compris ceux de l'opposition, sont progressivement associés au pouvoir dans un Conseil national de sécurité (1979).
En août 1979, après le retrait de la Mauritanie du Tiris el-Gharbia, dans le Sahara occidental, le Maroc, qui en occupait concomitamment les trois cinquièmes (la Saguía El Hamra), en prend immédiatement possession. Un nouvel homme fort, le général Dlimi, lance, à partir de 1981, la politique des « murs de défense » contre les attaques du Front Polisario, mouvement de libération nationale du peuple sahraoui, créé en 1973. Au sommet de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à Nairobi, en 1981, Hasan II accepte le principe d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Ce sommet, qui avait été précédé de sanglantes émeutes à Casablanca (juin), suscite les protestations de l'USFP, ce qui entraîne l'arrestation de trois de ses principaux dirigeants pendant huit mois.
La République arabe sahraouie démocratique (RASD) proclamée par le Front Polisario en février 1976, soutenu par l'Algérie et la Libye, devient membre de l'OUA en février 1982. Rendue officielle au sommet d'Addis-Abeba en novembre 1984, son admission provoque le retrait du Maroc de cette instance africaine. Les relations maghrébines sont restées très tendues, en dépit de la rencontre d'Oujda entre Hasan II et Chadli Ben Djedid en février 1983.
Après le sommet arabe de Fès (septembre 1982), le roi s'implique de plus en plus dans la politique du Proche-Orient et favorise des négociations entre l'Égypte et Israël. Pour contrebalancer le front maghrébin qui lui est opposé, le Maroc signe un traité d'union avec la Libye, approuvé par référendum en août 1984, mais l'alliance est rompue en août 1986 à la suite de la visite de Shimon Peres au palais d'Ifrane. De nouvelles émeutes populaires éclatent en 1983 et en 1984 dans le sud (Marrakech) et dans le nord (Tétouan) du pays. En novembre 1985, le général Dlimi disparaît à Marrakech dans des conditions restées mystérieuses.
1.2. Les difficultés de la transition
Une nouvelle période s'ouvre en mai 1987 : le rapprochement avec l'Algérie, suivi de la reprise des relations diplomatiques (mai 1988), va permettre la création de l'Union du Maghreb arabe (UMA) en février 1989, également facilitée par l'acceptation du plan de paix proposé par l'ONU.pour le Sahara occidental (notamment un référendum d'autodétermination), adopté en août 1988, et la réception par Hasan II des représentants du Front Polisario à Marrakech en janvier 1989. En revanche, la prolongation de la législature, motivée par le conflit du Sahara, provoque une vive tension avec l'opposition, attisée par les problèmes économiques et sociaux nés d'une politique d'ajustement structurel qui va durer plus de dix ans. Celle-ci entraîne une suite de grèves et de troubles sociaux et estudiantins (liés aussi à la montée du mouvement islamiste dans les universités depuis les années 1970) et génère des déficits structurels et sectoriels. Le Maroc reçoit l'aide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). Ses alliés européens, en particulier la France, lui accordent une aide financière importante. En application de la politique décidée par les organismes internationaux, une privatisation de 118 sociétés d'État est lancée.
À partir de 1990, le régime se trouve dans une difficile phase de transition : la modernisation économique est amorcée et prend effet dans certains secteurs, mais elle n'est pas accompagnée d'une modernisation politique, et les partenaires internationaux du Maroc, réclamant davantage d'ouverture et de transparence, posent de plus en plus ouvertement la question du respect des droits de l'homme.
Une grave crise politique s'ouvre notamment avec la France, suite à la publication d'un livre de G. Perrault, Notre ami le roi, et à la dénonciation par la presse du trafic de drogue dans le Rif, à la construction, par souscription, de la grande mosquée Hasan II à Casablanca, à la censure et à des falsifications électorales. De plus, lors de la guerre du Golfe (janvier-février 1991), le Maroc envoie des militaires appuyer la coalition américano-saoudienne, tandis que l'opinion publique est très favorable à Saddam Husayn.
Le pays connaît un relatif et progressif déverrouillage politique et un début de renouvellement des élites sur la base de la timide émergence d'une société civile (associations, y compris de femmes et de droits de l'homme), tandis qu'un cessez-le-feu apaise l'affaire du Sahara occidental (septembre 1991). Les prisonniers politiques sont progressivement libérés entre 1989 et 1994, une amnistie permet le retour des exilés politiques, un centre consultatif des droits de l'homme est créé (mai 1990), le chômage des jeunes est pris en compte, les lois sur les femmes et celles sur la famille, légèrement modifiées (août 1993). L'opposition, sollicitée face à la gravité de la crise économique, demande et obtient une nouvelle réforme de la Constitution (1992), qu'elle estime cependant insuffisante. De plus, en dépit des promesses, les élections de 1992-1993 n'offrent pas la possibilité d'un virage politique, que le roi déclare souhaiter. La situation est donc une nouvelle fois bloquée, même si la tension est beaucoup moins vive entre le pouvoir et l'opposition.
1.3. Persistance des problèmes et assouplissement du régime
Les relations internationales restent difficiles : le Sahara, où le plan de l'ONU est sans cesse retardé, provoque le gel de l'UMA et une nouvelle tension avec l'Algérie. Cette tension est également liée à un attentat perpétré à Marrakech en août 1994, dans lequel Rabat soupçonne Alger d'avoir une part de responsabilité, ainsi qu'aux conséquences de la guerre civile algérienne.
Le Maroc apporte son soutien au processus de paix au Proche-Orient, qui aboutit en septembre 1993 aux accords d'Oslo. Il accueille une conférence sur le Maghreb et le Proche-Orient destinée à instaurer une coopération économique dans cette région et ouvre un bureau des intérêts israéliens. Mais cette politique d'ouverture est gênée par les obstacles que rencontre le processus de paix israélo-palestinien.
En dépit de l'aide constante des bailleurs de fonds du Maroc et de ses principaux partenaires – essentiellement la France (plus d'un milliard de francs par an depuis 1995) –, la crise économique reste prégnante : la Banque mondiale juge très sévèrement l'Administration et les politiques économiques et d'éducation, critiques que le roi déclare reprendre à son compte. Néanmoins, dans un contexte de troubles sociaux graves (grèves générales, arrestation du secrétaire général de la Confédération démocratique du travail en 1992-1993, émeutes à Fès en 1990 et à Tanger en 1996) et d'interrogations sur la succession de Hasan II lors de sa maladie (1995), les initiatives visant à renouveler la classe dirigeante et à désamorcer la contestation sont poursuivies.
Elles aboutissent, après la crise de 1990-1995, à une phase d'intenses négociations pour modifier les lois – listes et codes électoraux – et à la promulgation consensuelle de la cinquième Constitution (septembre 1996), précédée par la mise en place d'une politique de dialogue social (août 1996) et par une tentative avortée d'assainissement des entreprises (début 1996).
Finalement, Abd al-Rahman Yusufi est nommé Premier ministre en février 1998. Le responsable de l'opposition de gauche constitue, le 14 mars, un gouvernement de 41 membres formant une coalition de 6 partis : l'USFP (14 ministres), l'Istiqlal (6 ministres), plusieurs petits partis de gauche et 2 partis de l'ancienne majorité, le RNI et le Mouvement national populaire (MNP). Les responsables de quatre ministères, dits de souveraineté, sont désignés par le roi : Intérieur, Affaires étrangères, Justice, Biens religieux.
Ce rapprochement progressif entre le régime et son opposition bénéficie d'un large consensus populaire et d'un bon accueil à l'extérieur, en comparaison de la situation des autres pays du Maghreb. Mais il suscite des attentes énormes au niveau social, et sa marge de manœuvre est réduite tant au plan politique qu'au plan économique, par l'absence de réelles ressources et l'ampleur des déficits dus, notamment, à la charge de la fonction publique et à l'ampleur de la dette de l'État.
La nouvelle équipe promet le changement dans la continuité et une transformation sociale par l'accumulation de réformes qui ont longtemps été retardées : mise à niveau de l'économie, relance de l'investissement, modernisation des structures économiques, profondes réformes de l'enseignement, de l'administration et de la justice, totalement obsolètes, résolution des problèmes sociaux les plus urgents (niveau de vie, chômage, analphabétisme, marginalisation du monde rural).
Mais la mise en œuvre des promesses tarde, comme le montre la loi de finances pour 1998-1999, peu novatrice par rapport aux lois précédentes. La présence au ministère de l'Intérieur d'un fidèle du roi, Driss Basri, montre toute l'ambiguïté de ce gouvernement.
Depuis l'automne 1998, la libération de plusieurs dizaines de prisonniers politiques, la reconnaissance par l'État de la mort en détention de plus d'une centaine d'opposants politiques portés disparus entre les années 1960 et 1980, et la promesse d'indemnisations à une grande partie des familles constituent les premières manifestations de l'évolution du régime marocain. Hasan II meurt brutalement en juillet 1999.
2. Le règne de Muhammad VI
2.1. Un début de règne entaché d'ambiguïtés
Dans les premiers mois de son règne, Muhammad VI, fils aîné de Hasan II, montre, par une série de gestes, sa volonté de rompre avec le passé et de renouer avec la population : retour d'exil d'Abraham Serfaty et de la famille de Mehdi Ben Barka, limogeage du ministre de l'Intérieur Driss Basri, figure emblématique du règne autoritaire de son père, et visite officielle dans les provinces pauvres du Nord, ignorées de Hasan II qui n'avait pas oublié leur révolte à la fin des années 1950. Son ambition est de moderniser et de libéraliser le royaume. Toutefois, et c'est là l'ambiguïté du processus, il ne s'agit pas vraiment de démocratiser le régime.
De fait, dès 2000, le roi accumule les maladresses dans plusieurs affaires, ce qui amène les Marocains à s'interroger sur les intentions réelles de leur souverain. Ainsi assistent-ils à la saisie des journaux en réaction à la lettre ouverte de l'opposant islamiste Cheikh Abdessalam Yassine, au déroulement peu transparent du procès du capitaine Mustafa Adib, qui a osé dénoncer la corruption des Forces armées royales (FAR), ou encore, en 2001, à la condamnation de l'ex-agent secret Ahmed Boukhari pour une affaire ancienne de chèques sans provision à la suite de ses révélations sur l'affaire Ben Barka, etc.
De surcroît, le retard pris dans la mise en chantier de l'ambitieux programme de modernisation du pays (en particulier l'ouverture aux investisseurs étrangers) et l'impact, décalé dans le temps, de ses effets expliquent également le désabusement d'une population qui reste la première victime de la grave crise économique et sociale qui touche le pays depuis plusieurs années. En outre, le peuple marocain s'inquiète de la distance que le roi cultive, peu présent physiquement sur la scène politique nationale
2.2. Les premières réformes
Si, en septembre 2002, l'USFP du Premier ministre sortant A. Yusufi remporte les élections législatives (avec 50 sièges sur 325 à la Chambre des représentants), juste devant l'Istiqlal – son principal partenaire au sein du gouvernement sortant (48 sièges) –, le parti de la Justice et du Développement (PJD), seule formation islamiste autorisée, triple le nombre de ses députés (42, juste devant le RNI). Nommé à la tête du gouvernement, et désireux de donner des gages aux partisans des réformes, l'ex-ministre de l'Intérieur D. Jettou fait adopter en 2004 l'importante réforme du Code de la famille, voulue par le roi et qui consacre l'égalité juridique entre l'homme et la femme au sein du couple. Il crée en outre une instance nommée « Équité et réconciliation », chargée de faire la lumière sur les atteintes aux droits de l'homme commises lors du règne de Hasan II. Son rapport, rendu en 2006, est symbolique du changement d'ère à Rabat. Par ailleurs, en mai 2005 le roi s'implique directement dans le traitement des questions de société en lançant un ambitieux programme de résorption de la pauvreté dans les campagnes et dans les villes, tandis qu'il charge le gouvernement de s'attaquer au chômage, endémique, en privilégiant la formation, et qu'un système de couverture médicale pour tous voit peu à peu le jour.
2.3. Désenchantement de la population et raidissement du pouvoir
La croissance économique, qui repart en 2001 et s'envole même en 2003 et 2006, ne peut combler des écarts sociaux, lesquels, à l'inverse, tendent à s'accentuer.
Aussi la contestation demeure-t-elle latente. Elle s'exprime, ponctuellement, à travers le succès des islamistes, qui capitalisent également sur les résistances suscitées par la modernisation. Malgré la condamnation par le Maroc de l'intervention américano-britannique en Iraq, une série d'attentats ciblant des lieux fréquentés par la communauté juive et les étrangers à Casablanca fait 45 morts et une centaine de blessés le 16 mai 2003. Ils attestent que la pauvreté et le désœuvrement de la jeunesse sont susceptibles de nourrir sur place un islamisme radical.
En outre, aux élections municipales de septembre 2003, et bien qu'il soit arrivé en onzième position derrière l'Istiqlal, l'USFP et le RNI dans les grandes agglomérations et dans les villes de taille moyenne, le parti islamiste PJD fait figure de deuxième force politique du royaume.
Dès lors, le régime se raidit sur le sujet de la sécurité et multiplie les mesures anti-terroristes. La répression s'exerce non seulement à l'encontre des membres présumés des commandos de Salafia Djihadia, groupe intégriste accusé d'être à l'origine des attentats et d'en préparer d'autres (condamnations à mort à l'été 2003, puis fin 2006), mais aussi contre la presse (un journaliste est ainsi inculpé pour « outrage au roi » en 2005).
Casablanca est à nouveau le théâtre de trois vagues d'explosions suicides les 11 mars, 10 avril puis 14 avril 2007 (un policier tué en sus des 7 jeunes kamikazes, dont les motivations demeurent inconnues), tandis que le 13 août 2007, un attentat contre des touristes échoue à Meknès.
Victime collatérale du renouveau de la menace terroriste, la presse – la plus libre du Maghreb –, fait à nouveau l'objet d'intimidations de la part du pouvoir tout au long de l'été (saisie de deux hebdomadaires et inculpation de leur directeur, pour « manquement au respect dû à la personne du roi », puis condamnation et incarcération d'un journaliste, pour publication de documents confidentiels concernant la lutte antiterroriste).
Dans ce contexte de reprise en main, les élections législatives qui se tiennent le 7 septembre 2007 déjouent les pronostics qui donnaient le PJD gagnant. Certes, en nombre de voix, elles voient le parti islamiste arriver en tête avec 10,9 % des suffrages, mais elles ne lui permettent d’arriver en seconde position avec 46 sièges derrière l’Istiqlal, en tête du scrutin avec 52 députés. La consultation confirme l'usure de l'USFP, qui, ne conservant que 38 sièges, en perd 12 et rétrograde à la cinquième place des formations politiques nationales, derrière le Mouvement populaire (MP), berbériste, et le RNI. Mais, surtout, l'abstention atteint un niveau record : 63 % sans compter 20 % de bulletins blancs ou nuls.
Aussi le scrutin révèle-t-il avant tout encore une fois le désenchantement politique d'une majorité de la population qui s'avère davantage préoccupée par les difficultés du quotidien (manifestations contre la cherté de la vie fin septembre) et qui ne perçoit pas les bénéfices des investissements étrangers et de la réalisation de grands travaux comme, entre autres, l'aménagement du port de Tanger et de sa zone franche, le remodelage de l'agglomération de Rabat, ou la modernisation du système des transports.
Abbas El Fassi, leader de l'Istiqlal, nommé Premier ministre, parvient tant bien que mal à reconduire la coalition précédemment au pouvoir et à composer un gouvernement ramassé, renouvelé et féminisé (7 femmes, sur 34 portefeuilles), mêlant ses propres amis aux sociaux-démocrates de l'USFP, aux anciens communistes du parti du Progrès et du Socialisme (PPS, aux centristes du RNI et aux berbéristes transfuges du MP, qui, contre toute attente, fait défection, le PJD formant par ailleurs la principale force d'opposition parlementaire.
En décembre 2007, la décision du bureau politique d'une USFP en mal d'identité de quitter la coalition et d'exclure de ses rangs ses représentants au sein du gouvernement fragilise ce dernier et augure mal de son avenir. Au reste, à la fin de juillet 2008, un proche du roi, Fouad Ali el-Himma, crée de toutes pièces une formation libérale centriste, le parti de l'Authenticité et de la Modernité (PAM), qui, officiellement, soutient l'action du cabinet al-Fasi, mais qui a pour objectif affiché de concurrencer le PJD aux prochaines élections municipales et législatives, quitte à tailler des croupières aux différentes composantes de la coalition au pouvoir. À la fin mai 2009, ce nouveau venu sur l'échiquier politique marocain annonce qu'il retire son appui à un Premier ministre contraint de trouver de nouveaux alliés pour conserver son poste. Et aux élections municipales du 12 juin, le PAM arrive en tête, avec 21,7 % des voix, devant l'Istiqlal (19 %), le RNI (14,8 %), l'USFP (11,6 %), sur fond de participation établie à 52 %. Dans ce scrutin, le PJD n'obtient que 5,4 % des suffrages, score modeste dû au fait qu'il n'a présenté que 8 000 candidats aux 27 000 sièges à pourvoir.
2.4. L’ouverture politique et la réforme constitutionnelle
Encouragé par la chute du président Ben Ali en Tunisie et le départ sous la pression de la rue du raïs Hosni Moubarak en Égypte, un ensemble hétéroclite de manifestants – jeunes, laïcs, militants de la gauche radicale et islamistes – réclame, à partir du 20 février 2011, la poursuite des réformes et l'avènement d'une monarchie constitutionnelle.
Le 9 mars, soucieux de désamorcer la crise, le roi annonce la création d’une commission ad hoc chargée de préparer une réforme constitutionnelle globale et, malgré la reprise du terrorisme avec un attentat meurtrier sur la place centrale de Marrakech (28 avril) qui pouvait faire craindre un raidissement sécuritaire, confirme cette ouverture politique.
Dans un discours à la nation prononcé le 17 juin, Muhammad VI précise les grands principes de la nouvelle Constitution, axée sur l’équilibre et la séparation des pouvoirs et visant à instaurer une « Monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale ».
– Si le roi, commandeur des croyants, chef de l’État et des forces armées, conserve ses fonctions régaliennes et religieuses, sont notamment prévus la constitutionnalisation de tous les droits de l’homme, de l’égalité entre hommes et femmes, la reconnaissance de l’amazigh (berbère) comme seconde langue officielle au côté de l’arabe, une décentralisation accrue, un renforcement des mécanismes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et la limitation des prérogatives du souverain au profit du chef de gouvernement issu du parti vainqueur des élections.
– À la tête d’un « Conseil de gouvernement » – dont les responsabilités seront définies « en cohérence et en complémentarité » avec celles du Conseil des ministres qui conserve ses compétences et reste présidé par le roi – le Premier ministre verra son pouvoir de nomination étendu et pourra dissoudre la Chambre des représentants, détentrice exclusive du pouvoir législatif.
– Le contrôle parlementaire – censure, statut de l’opposition, extension des domaines relevant de la loi – est renforcé, de même que l’indépendance du pouvoir judiciaire avec la création d’un « Conseil supérieur du pouvoir judiciaire », dont la présidence – déléguée par le roi – ne sera plus confiée au ministre de la Justice mais au président de la Cour de cassation.
Massivement approuvé par référendum le 1er juillet 2011 – 98 % de « oui » pour une participation de plus de 70 % —, le projet constitutionnel suscite toutefois la déception et la méfiance du « mouvement du 20 février » qui avait appelé au boycott et conteste ce résultat en réunissant ses partisans pour exiger des réformes plus profondes.
2.5. Les élections et la transition démocratique
La convocation des élections législatives anticipées le 25 novembre 2011 prend les partis de court. Ceux-ci tentent de se réorganiser afin de présenter des plateformes communes.
Tandis qu’une coalition hétéroclite baptisée « Alliance pour la démocratie » est formée par huit partis, dont le Rassemblement national des indépendants (RNI), le parti Authenticité et Modernité (PAM), l’Union constitutionnelle (UC) et le Mouvement populaire (MP), le Bloc démocratique (ou « Koutla démocratique du Maroc ») est reconstitué à cette occasion par l’Istiqlal, l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS).
Bien qu’en hausse par rapport à 2007, le taux participation – autour de 45 % –, reste inférieur à celui des scrutins précédents, malgré l’importance de l’enjeu et l’appel lancé par les partis en faveur d’une mobilisation massive. Forts de leur virginité politique, de leur campagne axée notamment sur la lutte contre la corruption ainsi que de leur implantation sociale, les islamistes du PJD viennent largement en tête de ces élections historiques avec 107 sièges sur 395 devant l’Istiqlal (60 sièges), le RNI (52 sièges), le PAM (47), l’USFP (39), le MP (32), l'UC (23) et le PPS (18). Dix autres formations se répartissent les 17 sièges restants.
Conformément à la nouvelle Constitution, le secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, est nommé Premier ministre par le roi et forme un gouvernement de coalition avec l’Istiqlal, le MP et le PPS – dans lequel le PJD détient 12 ministères sur 30, dont ceux des Affaires étrangères et de la Justice. Ce gouvernement de coalition reçoit l’aval du souverain le 3 janvier 2012. Mais les dissensions et les rivalités entre le Premier ministre et le chef de l’Istiqlal, le maire de Fès Hamid Chabat, conduisent à la rupture entre les deux principaux alliés de la coalition. À la suite d’une longue crise politique et afin d’éviter des élections anticipées, un nouveau gouvernement de coalition est formé avec le soutien et la participation du RNI en octobre 2013.
Comme les scrutins précédents, les élections d’octobre 2016 ne donnent aucune majorité : si le PJD vient en tête avec 125 sièges, le PAM progresse fortement avec 102 sièges, devant l’Istiqlal (46), le RNI (37), le MP (27), l’USFP (20), l’UC (19) et le PPS (12), les sept sièges restants se répartissant entre quatre autres partis. Mais la création d’une coalition s’avère très ardue. Après cinq mois de crise politique marquée par des négociations sans issue, le roi limoge le Premier ministre sortant, auquel succède Saadeddine El Othmani, n°2 du PJD, qui parvient à forger une coalition et former un gouvernement en avril 2017.
2.6. Le Maroc et le monde sous Muhammad VI
En matière extérieure, le Maroc de Muhammad VI entend poursuivre son arrimage à l'Europe, tout en développant la coopération avec les États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001, les Américains plaçant le royaume alaouite sur le liste des pays menacés par al-Qaida. Malgré la condamnation par le Maroc de l'intervention américano-britannique en Iraq, en mars 2004, Rabat et Washington concluent ainsi un accord de libre-échange bilatéral qui entre en vigueur le 1er janvier 2006 et dope les échanges.
Les relations avec l'Espagne
Le refroidissement des relations avec Madrid, perceptible dès 2001 à la suite d'un différend sur la prospection pétrolière espagnole au large des Canaries, culmine en juillet 2002 dans l'accrochage au sujet de l'îlot Leila (ou Persil), à l'ouest de Ceuta, subitement occupé par des soldats marocains. L'Espagne récupère l'îlot, ce qui met un terme à l'incident, mais non à la tension qui règne entre les deux pays. Sous l'égide des États-Unis est peu après signé un accord prévoyant le retour au statu quo et le rétablissement des relations diplomatiques, de sorte que les Premiers ministres D. Jettou et José María Aznar se rencontrent à nouveau en juin 2003. Après les attentats de Madrid du 11 mars 2004, qui font 191 victimes et impliquent des terroristes marocains, les deux pays multiplient les signes d'apaisement et de coopération. En avril 2004, le Maroc reçoit la première visite à l'étranger du nouveau président du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero, suivi en janvier 2005 par Juan Carlos. Mais les objets de contentieux entre Madrid et Rabat demeurent, à propos de la pêche, du Sahara occidental, ou de l'immigration clandestine, comme en témoignent à ce sujet la mort, en octobre 2005, de dizaines de candidats à l'entrée des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, le refoulement et l'abandon en plein désert du Sud marocain de centaines d'autres. En outre, en novembre 2007, le déplacement à Melilla et Ceuta de Juan Carlos réanime le contentieux frontalier entre les deux pays.
Le Sahara occidental
Par ailleurs, la question du Sahara occidental reste en suspens. En 2001, un nouvel accord-cadre est proposé par l'ONU, mais il est rejeté par le Front Polisario qui le juge trop favorable au Maroc. Le problème entretient également la brouille avec le voisin algérien, jusqu'à susciter en 2005 une fermeture frontalière. Les tractations reprennent en 2007, quand le Maroc présente aux Nations unies un plan en vue d'octroyer l'autonomie interne au Sahara occidental. Mais Alger continue à demander un référendum d'autodétermination afin que les Sahraouis puissent choisir entre l'indépendance ou le rattachement au royaume chérifien. Malgré les blocages, le processus de négociation se poursuit avec la reprise des pourparlers entre les différentes parties en 2009 sous l'égide de l'ONU. Mais elles sont interrompues en 2012.
En janvier 2017, la réintégration du Maroc au sein de l’Union africaine, qu’il avait quittée en 1984 à la suite de l’admission de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), est approuvée par 39 États sur 54. Malgré l’opposition des pays soutenant le front Polisario, au premier rang desquels l’Algérie, cette réadmission, bien accueillie aussi bien par le Maroc que par la RASD, pourrait ainsi faire évoluer la question sahraouie, alors qu’une résolution en faveur de la reprise des négociations est adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU le 28 avril.
Le Maroc, la France et l'Europe
Enfin, le Maroc de Muhammad VI renforce ses liens privilégiés avec la France et l'Union européenne. Certes, des tensions se font parfois jour entre Rabat et Paris, notamment au regard du resserrement des relations entre Paris et Alger qui semble vouloir se dessiner à partir de 2003, à l'occasion, historique, de la venue en Algérie de Jacques Chirac, première visite d'État d'un président français depuis l'indépendance de l'ancienne colonie. Celle-ci est dès lors suivie sept mois plus tard, en octobre 2003, d'un déplacement officiel dans le royaume alaouite du président français, qui réaffirme son soutien au nouveau régime, fragilisé par les attentats de Casablanca, et se prononce pour une intensification des liens entre les deux pays. De même, quatre ans plus tard, Rabat semble prendre ombrage de la tournée-marathon des capitales du Maghreb que Nicolas Sarkozy, à peine élu, effectue en juillet : en guise de témoignage du lien spécial qui unit le Maroc à la France, le nouveau chef de l'exécutif français lui consacre la première visite d'État de son mandat, en octobre 2007. Et si Muhammad VI se rallie aisément au programme d'Union pour la Méditerranée promu par ce dernier, il n'en donne pas moins le sentiment de bouder le sommet de Paris qui le lance le 13 juillet 2008, en envoyant à sa place, comme représentant du royaume, son frère, le prince Moulay Rachid. En octobre 2008, aboutissement du projet de renforcement des liens porté par la France depuis 2005 dans le cadre du « partenariat privilégié » qu'elle cherche à établir avec le Maroc, l'Union européenne accorde à ce dernier un « statut avancé », qui ne vaut certes pas pour future adhésion, mais signifie intégration poussée, à la fois économique, mais aussi politique.