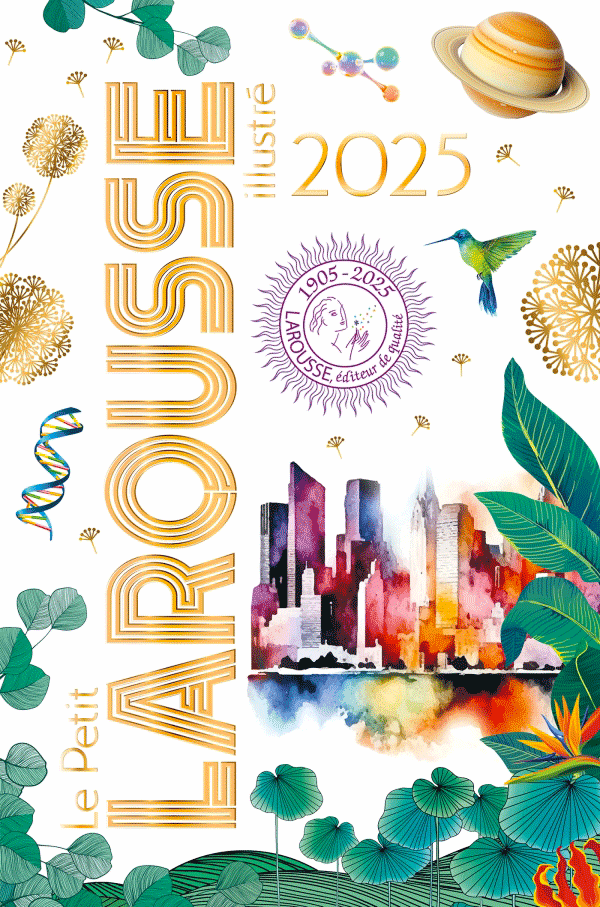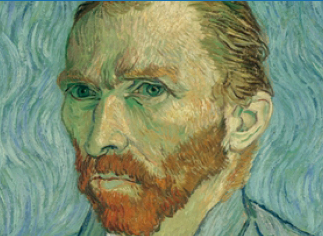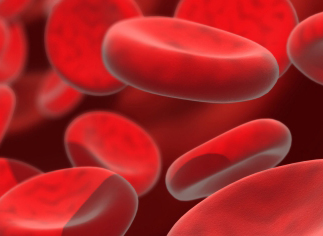France : vie politique depuis 1958

1. De la IVe à la Ve République
Le 13 mai 1958, à l'annonce de la formation du gouvernement Pflimlin, réputé libéral, les partisans de l'Algérie française mettent sur pied, à Alger, un Comité de salut public. Beaucoup d'entre eux perçoivent alors le général de Gaulle comme l'homme providentiel. Le 27 mai, ce dernier déclare : « J'ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain. » Deux jours plus tard, le président de la République, René Coty, le nomme président du Conseil (chef du gouvernement sous la IVe République).
Les 2 et 3 juin 1958, le gouvernement d'union nationale formé par de Gaulle reçoit les pleins pouvoirs pour six mois et le droit de réviser la Constitution, en respectant plusieurs principes : la séparation des pouvoirs, le maintien du régime parlementaire, la consultation des Français sur le projet de Constitution par voie de référendum.
1.1. La Constitution du 4 octobre 1958 : des institutions « sur mesure »
La nouvelle Constitution est rédigée en trois mois, principalement par Michel Debré, en se fondant sur les conceptions exposées par le général de Gaulle en 1946, lors de son discours de Bayeux. Elle est présentée le 4 septembre – date anniversaire de la proclamation de la république en 1870 – par de Gaulle lui-même, sur la place de la République, à Paris. Le 28 septembre, le texte est approuvé par 80 % des électeurs, ce qui lui confère une légitimité incontestable.
Enfin, le 21 décembre, le général de Gaulle est élu président de la République par un large collège électoral : un exécutif fort et personnalisé se met en place (le septennat, introduit en 1873 pour l'exécutif, est maintenu). La guerre d'Algérie contribue à accentuer le caractère présidentiel du régime, qui trouve son aboutissement dans la réforme constitutionnelle de 1962, instaurant l'élection du président de la République au suffrage universel. Il s'agit alors de donner au président « la force et l'obligation d'être le guide de la France et le garant de l'État » (discours du général de Gaulle du 18 octobre 1962). À certains égards, la Ve République commence pleinement en 1962.
1.2. La place des partis sous la Ve République
La Constitution de la Ve République institutionnalise le rôle des partis politiques dans son article 4 : « Les partis et groupements concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. » Il leur revient d'élaborer des programmes susceptibles de répondre aux problèmes et préoccupations des citoyens, et de proposer des projets dans lesquels chaque citoyen pourra se reconnaître, ou non, à l'occasion d'un scrutin.
Les partis représentés au Parlement y forment des groupes parlementaires, autour desquels s'organisent les débats, les propositions de loi et le vote de ces dernières. Ce système permet de trouver un équilibre qui évite la confusion dont le régime des partis serait générateur tout en donnant ses chances à l'alternance politique au sommet de l'État.
L'élection du président de la République au suffrage universel direct (réforme constitutionnelle de 1962), requérant la majorité des suffrages exprimés par le peuple souverain, maintient chaque parti dans l'incapacité de faire élire son représentant avec ses seules voix. Pour être élu, il est nécessaire de rassembler des voix – notamment par le biais du désistement d'un ou de plusieurs candidats en faveur de celui qui est le mieux placé pour l'emporter – au-delà de son électorat naturel, voire de provoquer une coalition de partis autour d'un même programme ou d'une plate-forme commune de gouvernement.
Une fois en fonction, le chef de l'État n'est plus le représentant des partis qui l'ont fait élire, mais un arbitre au-dessus des partis. Selon la tradition gaullienne, il n'est responsable que devant le peuple qui l'a élu.
Pour en savoir plus, voir l'article élection.
2. Les présidences du général de Gaulle : 1958-1969

Le général de Gaulle est élu président de la République (78,5 % des suffrages) le 21 décembre. Désireux de réagir contre l'instabilité ministérielle qui caractérisait la IIIe et la IVe République, le chef de l'État veut assurer un pouvoir exécutif fort et stable, la nation étant consultée par voie de référendum.
Une nouvelle Assemblée nationale est élue en novembre 1958, avec une importante majorité de députés gaullistes (Union pour la nouvelle République, UNR). Michel Debré devient Premier ministre (janvier 1959). Les problèmes économiques sont les premiers abordés : stabilisation de la monnaie, dévaluation du 27 décembre 1958, création du franc lourd, etc.
2.1. Le problème de l'Algérie
Mais le régime est confronté avant tout au problème de l'Algérie, où la guerre sévit. Le processus de paix est engagé par de Gaulle d'une manière qui déconcerte puis révolte les partisans de l'Algérie française. Au cours de l'année 1960, de Gaulle évoque plusieurs fois l'« Algérie algérienne », tandis que treize États africains francophones accèdent à l'indépendance.
Les résultats du référendum de janvier 1961 sur la politique algérienne du gouvernement lui sont largement favorables. À Évian se rouvrent les négociations avec le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) ; mais le blocus de Bizerte aggrave le contentieux franco-tunisien.
Le 22 avril 1961, un putsch militaire éclate à Alger ; il échoue rapidement. Mais une Organisation armée secrète (OAS) se développe : les attentats se multiplient en Algérie. De Gaulle prolonge l'application de l'article 16 de la Constitution. Les accords d'Évian sont paraphés le 18 mars 1962 et approuvés par référendum le 8 avril.
2.2. Premier gouvernement Pompidou (14 avril-28 novembre 1962)
En avril 1962 est constitué le ministère Pompidou. Une forte opposition se manifeste au Parlement, due surtout à la politique européenne du régime (l'« Europe des États », retrait de l'OTAN), et le gouvernement doit faire face au malaise paysan grandissant. Le chef de l'État, désirant assurer la pérennité des institutions, prépare l'opinion à un référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel ; 280 députés votent la censure, le ministère Pompidou démissionne, l'Assemblée est dissoute (octobre).
Le référendum du 28 octobre donne 13 millions de « oui », mais 8 millions de « non » au projet du chef de l'État. Les élections de novembre 1962 renforcent la majorité gouvernementale. Le second cabinet Pompidou est formé en décembre. Le gouvernement, aux prises avec l'inflation, la hausse des prix et les conflits sociaux, promulgue un « plan de stabilisation » et entame une politique contractuelle. À l'extérieur, hostile à l'entrée dans le Marché commun de la Grande-Bretagne, le chef de l'État accentue la coopération franco-allemande (1962).
Les élections municipales de mars 1965 sont marquées par les progrès de l'opposition. Au premier tour de l'élection présidentielle (5 décembre), de Gaulle est mis en ballottage par le candidat unique de la gauche, François Mitterrand, qui obtient encore au second tour (19 décembre) 44,8 % des suffrages exprimés.
2.3. Second et troisième gouvernement Pompidou (1962-1968)
De Gaulle entame un second septennat et reconduit le cabinet Pompidou. L'alliance des partis de gauche joue à plein lors des élections législatives de mars 1967 ; les gaullistes gardent la majorité absolue, mais celle-ci est très réduite. Georges Pompidou constitue un nouveau gouvernement, qui prend en août des ordonnances relatives à la participation des salariés aux profits des entreprises, à la réforme de la Sécurité sociale, etc.

La crise qui éclate en mai 1968 a son origine dans le malaise profond qui existe dans le monde étudiant. La classe ouvrière participe à son tour au mouvement, encore que le parti communiste (PCF) et la CGT la mettent en garde contre l'« aventurisme » ; le pays est paralysé par les grèves, tandis que de durs affrontements se produisent. Pompidou signe le 27 mai avec les syndicats les accords de Grenelle.
2.4. L'échec du référendum du 27 avril 1969
Le 30 mai, le chef de l'État réaffirme son autorité et dissout l'Assemblée nationale. Les élections des 23 et 30 juin 1968 aboutissent à une nette victoire de l'Union pour la défense de la République (UDR). Georges Pompidou est remplacé par Maurice Couve de Murville. Le ministre de l'Éducation nationale, Edgar Faure, fait voter une réforme fondée sur la participation des étudiants et des enseignants à la gestion d'établissement dotés d'une large autonomie (octobre 1968), et la loi de décembre 1968 reconnaît l'existence de la section syndicale d'entreprise.
En 1969, le général de Gaulle propose un référendum visant à la fois à la création des Régions et à la réforme du Sénat, qu'il compte fusionner avec le Conseil économique et social. Le 27 avril 1969, les « non » sont plus nombreux que les « oui ». De Gaulle se retire à Colombey-les-Deux-Églises, où il mourra en novembre 1970.
3. La présidence de Georges Pompidou : 1969-1974
Devant les élections présidentielles, la gauche se divise : elle n'est représentée par aucun candidat au deuxième tour, où Georges Pompidou l'emporte sur Alain Poher. Le nouveau président prend comme Premier ministre Jacques Chaban-Delmas ; la majorité s'élargit en incorporant une fraction du centrisme. La notion de « contrats de progrès » semble l'emporter sur celle de la participation ; la régionalisation marque le pas.
À l'extérieur, tout en demeurant dans la ligne d'indépendance et d'arbitrage tracée par le général de Gaulle, le gouvernement éprouve moins de réticences à l'égard d'une Europe élargie (admission de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark dans le Marché commun) et à l'égard des États-Unis.
En juillet 1972, Jacques Chaban-Delmas est remplacé par Pierre Messmer, qui constitue une équipe dont la mission semble être de « contrer » une gauche (PS-PCF et radicaux de gauche) qui a trouvé son unité (Programme commun). Aux élections législatives de mars 1973, l'UDR et ses alliés perdent une centaine de sièges, mais gardent la majorité à l'Assemblée nationale. À partir de 1973, la crise monétaire et la crise pétrolière se répercutent en France dans tous les domaines. L'inflation amène le gouvernement à prendre des mesures économiques autoritaires et à dévaluer en fait le franc (janvier 1974) ; le climat social s'alourdit : les grèves se multiplient. Georges Pompidou meurt le 2 avril 1974.
Pour en savoir plus, voir l'article Trente Glorieuses.
4. La présidence de Valéry Giscard d'Estaing : 1974-1981
Aux élections présidentielles des 5 et 19 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing l'emporte, au second tour, avec 50,8 % des voix contre 49,2 % à François Mitterrand, candidat de l'Union de la gauche. Jacques Chirac est appelé à présider le gouvernement. Le nouveau pouvoir manifeste une certaine volonté réformatrice (droit de vote à 18 ans, réforme de l'Office de la radiodiffusion-télévision française (ORTF), loi sur l'interruption volontaire de grossesse [IVG]).
La situation économique et sociale restant tendue, la France décide de participer de nouveau au serpent monétaire européen (mai 1975) ; un accord sur l'indemnité de chômage est signé par les syndicats et le patronat (23 juin). En novembre, le nombre de chômeurs dépasse le million.
À l'extérieur, tout en consolidant l'amitié franco-allemande et en réaffirmant l'indépendance de la France par rapport aux États-Unis, Valéry Giscard d'Estaing applique en Afrique noire une politique de prestige.
Jacques Chirac démissionne en août 1976 ; il est remplacé par Raymond Barre, qui, dès le 22 septembre, présente son plan de lutte contre l'inflation. Les élections municipales des 13 et 20 mars 1977 marquent un net succès de l'Union de la gauche ; à Paris, cependant, Jacques Chirac est élu maire, charge récemment rétablie dans la capitale. Le gouvernement adopte un plan d'action de douze mois, comportant notamment un « pacte national pour l'emploi » (28 avril). À l'approche des élections législatives, l'Union de la gauche est rompue, socialistes et communistes étant divisés sur l'actualisation du Programme commun, notamment sur les nationalisations.
Les élections législatives des 12 et 19 mars 1978 consolident la majorité Rassemblement pour la République (RPR) [l'ancienne UDR, dirigée à présent par Jacques Chirac] et Union pour la démocratie française (UDF) [291 sièges] devant l'opposition (200 sièges). Les militaires français interviennent au Tchad et au Zaïre (avril-mai).
En 1979, la situation sociale s'aggrave, provoquant, notamment dans la sidérurgie, en voie de « restructuration », une agitation quasi permanente. Alors que le système monétaire européen (SME) entre en vigueur (13 mars), un accord sur la réforme de l'indemnisation du chômage est signé par le patronat et les syndicats (27 mars). Les élections pour l'Assemblée européenne voient le succès de l'UDF (10 juin).
5. Les deux présidences de François Mitterrand : 1981-1995
L'arrivée de la gauche au pouvoir, après la victoire de François Mitterrand sur V. Giscard d'Estaing au second tour de l'élection présidentielle, le 10 mai 1981, avec 51,8 % des voix, constitue un tournant dans l'histoire de la Ve République. Avec elle, en effet, commence une période d'alternance entre la gauche et la droite, bientôt prolongée par des épisodes de cohabitation.
5.1. Une certaine continuité
Cette victoire surprend l'opinion, et la perspective de réformes radicales, si elle réjouit les uns, inquiète les autres. En réalité, il apparaît rapidement que la continuité l'emporte sur le changement, même en matière économique, avec un retour à une gestion classique après une brève période au cours de laquelle sont tentées un certain nombre de transformations structurelles. La continuité est particulièrement marquée en matière institutionnelle : F. Mitterrand, autrefois très hostile à la Constitution de 1958, se soumet sans réticence à ses règles.
Continuité aussi de la politique étrangère, avec la poursuite de la construction européenne et, plus controversé, le maintien du style traditionnel des relations avec l'Afrique noire. En fait, ce n'est pas la France, mais le monde qui va connaître, durant ces quatorze années, les plus profonds bouleversements (chute du mur de Berlin, réunification de l'Allemagne, guerre de Yougoslavie, génocide au Rwanda…).
Ces événements se déroulent sur fond de crise économique. Le chômage, en progression régulière, ne peut qu'inquiéter les jeunes comme les moins jeunes quant à leur avenir. Générant l'exclusion, il suscite néanmoins de nouvelles solidarités, notamment au sein des familles. L'effondrement du bloc de l'Est concourt au triomphe du libéralisme, dont les remèdes – renforcement de la concurrence, déréglementation, limitation du poids de l'État et des droits des salariés – déstabilisent une opinion majoritairement peu convaincue de leur efficacité, et qui garde en mémoire les brillants résultats des Trente glorieuses. Mais, alors que l'économie stagne, le secteur financier progresse considérablement. Pour se prémunir, les Français épargnent donc, restreignant leur consommation, ce qui ne peut que retarder la reprise économique.
5.2. Ouverture mémorielle et montée de l'extrême droite
Dans le même temps, l'incertitude de l'avenir semble conduire les Français à se retourner sur leur passé : la décennie 1980 marque le début d'un engouement particulier pour les commémorations et, plus significatif encore, voit se développer un débat public sur la France de Vichy (gouvernement de Vichy) et sa responsabilité dans le massacre des juifs. Pour la première fois, des procès pour crimes contre l'humanité sont organisés en France (Klaus Barbie, 1987 ; Paul Touvier, 1994 ; Maurice Papon, 1997-1998).
D'autres procès, de plus en plus nombreux, mettent en cause des personnalités du monde des affaires et de la politique. Pour l'opinion, c'est le signe d'une dégradation des mœurs de ses dirigeants. En réalité, il faut y voir d'abord la conséquence d'une attitude nouvelle de la presse et de la justice, qui, profitant de l'alternance et de la cohabitation, se sentent moins soucieuses qu'autrefois d'étouffer les « affaires ».
Dans ce contexte particulier se développe le Front national (FN). Ce parti joue sur les anxiétés des classes populaires, qui découvrent dans les populations immigrées une concurrence dangereuse ; il table sur une solution démagogique et xénophobe, la « préférence nationale », pour conforter sa base électorale. À cela s'ajoutent les craintes d'une partie de la classe moyenne qui ressent la présence des immigrés comme une menace pour sa sécurité. Le FN s'installe brutalement dans le paysage politique, attirant de 13 à 15 % de l'électorat, et faisant de la France une exception au sein des démocraties occidentales.
5.3. Le temps des réformes : juin 1981-mars 1983
La nouvelle Assemblée nationale qui est élue en juin, après la dissolution prononcée le 22 mai, offre à l'exécutif une majorité imposante, le parti socialiste (PS) détenant à lui seul plus de la moitié des sièges. Le gouvernement que dirige Pierre Mauroy, et qui comprend quatre ministres communistes, peut ainsi s'atteler à la mise en œuvre des réformes promises pendant la campagne électorale.

Quatre axes sont privilégiés :
– la modernisation de la justice, avec la suppression de la Cour de sûreté de l'État et de la peine de mort ;
– la relance économique par l'augmentation du pouvoir d'achat des catégories les moins favorisées (hausses du salaire minimum interprofessionnel de croissance [SMIC], des allocations familiales, création d'emplois publics…) ;
– la restructuration de l'économie par les nationalisations (industries d'armement, banques, assurances, divers grands groupes industriels) ;
– la décentralisation, qui renforce les pouvoirs exécutifs des Régions et des départements.
Cette politique ambitieuse se heurte à la rigidité de l'appareil productif et se traduit par un fort accroissement des déficits des finances publiques et du commerce extérieur, alors que le chômage continue de progresser (2 millions de sans-emploi en janvier 1982), ainsi que par un maintien de l'inflation à un taux élevé (plus de 10 % par an). Ainsi, le franc doit être dévalué trois fois.
5.4. La rigueur : mars 1983-mars 1986
Après des élections municipales qui traduisent un net recul de la gauche, le gouvernement de P. Mauroy est profondément remanié et adopte, le 25 mars, un plan de rigueur qui marque la conversion des socialistes aux règles de l'économie de marché. Pour autant, ces derniers ne retrouvent pas le soutien de l'opinion. Une partie de celle-ci se radicalise autour du FN, qui, à la faveur d'élections partielles, entre pour la première fois dans un conseil municipal (Dreux, septembre 1983). Le PCF voit son audience décroître : il dépasse à peine le FN aux élections européennes de juin 1984. Il apparaît alors clairement que la droite est majoritaire, ce que confirme le même mois la puissante manifestation à Paris en faveur de l'« enseignement libre », que menacerait le projet du ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary.
La nomination d'un jeune Premier ministre, Laurent Fabius (juillet 1984), ne permet pas de renverser ces tendances. La conjoncture demeure défavorable et le chômage poursuit sa courbe ascendante, malgré les mesures de « traitement social » que met en place le nouveau gouvernement. Le PCF, qui a décidé de ne pas participer au gouvernement, se montre de plus en plus critique à l'égard de la politique de rigueur.
La fin de la législature est morose. Elle est marquée notamment par l'affaire Greenpeace (en juillet 1985, dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, les services secrets français coulent le Rainbow Warrior, un bateau de cette organisation, qui proteste contre les essais nucléaires français dans le Pacifique ; il y a un mort), unanimement condamnée par l'opinion internationale.
Sur le plan intérieur, la manière hésitante et peu claire avec laquelle le pouvoir socialiste tente de se justifier lui aliène une partie de son électorat.
5.5. La première cohabitation : mars 1986-avril 1988
L'adoption du scrutin proportionnel (loi du 17 juillet 1985) pour les législatives et les régionales ne fait que limiter l'ampleur de la victoire de la droite aux élections du 16 mars 1986 et permet au FN de faire jeu égal avec les communistes. À l'Assemblée, l'union RPR-UDF obtient de justesse, avec l'apport des « divers droite », la majorité absolue, FN et PCF faisant élire chacun 35 députés. Avec les régionales, premières du genre au suffrage universel direct, la droite prend le pouvoir dans 20 Régions sur 22 ; le FN a 137 élus (sur un total de 1 830 conseillers régionaux). Plus que la défaite de la gauche, prévisible, c'est la percée du Front national qui constitue l'événement majeur de ces élections.
F. Mitterrand, qui avait déclaré qu'il ne démissionnerait pas en cas de victoire de la droite, nomme Jacques Chirac, président du RPR, Premier ministre. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que les deux têtes de l'exécutif appartiennent à des bords politiques opposés. L'expérience, que l'on prend l'habitude d'appeler « cohabitation », suscite des controverses, mais plus encore de la curiosité.
Contrairement à certaines prévisions pessimistes, elle ira jusqu'à son terme, sans crise majeure, le président de la République se bornant généralement à exprimer publiquement ses réserves sur un certain nombre de projets gouvernementaux. Et elle apparaîtra de ce fait comme une figure normale de la vie institutionnelle française, permettant de limiter les risques d'hégémonie d'un bloc majoritaire.
J. Chirac ne se contente pas de s'attaquer aux deux principaux symboles de la politique menée par la gauche, les nationalisations – un train de privatisations est mis en œuvre – et l'impôt sur les grandes fortunes, qui est aboli. Des réformes remettent également en cause des principes pourtant bien établis : suppression de l'autorisation administrative de licenciement, abrogation des ordonnances de 1945 sur le contrôle des prix et la concurrence, assouplissement de la loi sur les horaires de travail, privatisation de TF1… On rétablit également le scrutin majoritaire pour les législatives.
Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, dénonçant le laxisme de ses prédécesseurs, fait adopter une série de dispositions répressives en matière de terrorisme et d'immigration. Il s'efforce par ailleurs d'exploiter l'affaire « Carrefour du développement » dans laquelle est compromis l'ancien ministre socialiste de la Coopération, Christian Nucci.
Mais le gouvernement doit reculer parfois devant l'hostilité de l'opinion. La jeunesse lycéenne et étudiante manifeste massivement (sur le thème du refus de la sélection à l'entrée de l'université) contre le projet Devaquet-Monory de réforme de l'enseignement supérieur, puis contre la mort de Malik Oussekine, survenue lors des affrontements avec la police (novembre-décembre 1986). Le projet est abandonné, comme l'est aussi la proposition d'Albin Chalandon de construire des prisons gérées par le secteur privé.
5.6. Le second septennat de F. Mitterrand : mai 1988-mai 1995
F. Mitterrand, qui a longuement entretenu le suspense sur sa candidature, sort nettement vainqueur de l'élection présidentielle d'avril-mai 1988, qui a vu s'affronter au premier tour deux candidats de la droite parlementaire, J. Chirac et Raymond Barre, alors que le leader du FN, Jean-Marie Le Pen, obtenait plus de 14 % des voix, et que le candidat du parti communiste réalisait un score catastrophique (moins de 7 %).
Entre les deux tours, le ministre des DOM-TOM, Bernard Pons, a décidé d'employer la manière forte pour libérer des otages détenus par des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Ils sont libérés, au prix de la mort de deux militaires et de dix-neuf Kanaks, dans des conditions peu claires. Cette affaire d'Ouvéa contribue sans doute à décider un certain nombre d'électeurs hésitants à voter pour le candidat du PS.
Michel Rocard Premier ministre : mai 1988-mai 1991
Le succès le plus spectaculaire du nouveau Premier ministre, Michel Rocard, apôtre du « parler vrai » et du « gouverner autrement », est justement de parvenir à un accord entre les deux parties adverses de Nouvelle-Calédonie, mettant fin à un conflit devenu aigu depuis plusieurs années (accord de Matignon, juin 1988).
Tant par conviction que par nécessité, M. Rocard est amené à utiliser cette méthode du consensus dans l'ensemble de l'action gouvernementale : les élections législatives de juin, consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale, ne donnent qu'une majorité relative au PS. C'est donc un gouvernement « d'ouverture », avec quelques personnalités centristes, que constitue le Premier ministre.
Dans un climat qui reste lourd – grèves, profanation du cimetière juif de Carpentras (mai 1990), effervescence dans les banlieues, affaire du foulard islamique… –, le Premier ministre parvient à mettre en place un certain nombre de réformes importantes, dont l'institution du RMI (revenu minimum d'insertion) financé par l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), avatar de l'impôt sur les grandes fortunes, supprimé en 1986, et celle de la contribution sociale généralisée (CSG), qui amorce un nouveau mode de financement de la protection sociale par l'impôt et non plus seulement par les cotisations des seuls actifs.
Il échoue en revanche lorsqu'il tente de parvenir à un accord entre la majorité et l'opposition sur les problèmes de l'immigration et la lutte contre le racisme (mars-mai 1990). Il commet par ailleurs une erreur politique en introduisant dans la loi sur le financement des partis politiques (janvier 1990) une disposition amnistiant les délits commis antérieurement, ce qui heurte l'opinion.
Vers l'effondrement de la gauche : mai 1991-mars 1993
Le remplacement inopiné de M. Rocard par Édith Cresson puis la nomination, moins d'un an plus tard, de Pierre Bérégovoy comme Premier ministre sont les principales étapes du déclin de la gauche mitterrandienne. En semblant vouloir donner des gages à l'opposition (déclaration de É. Cresson sur l'utilisation de charters pour expulser les immigrés clandestins, politique du « franc fort » de P. Bérégovoy), les deux gouvernements s'aliènent de larges franges de l'électorat de gauche et du centre, déjà désorienté par les affaires qui se multiplient ou prennent de l'ampleur (financement des partis, corruption, abus de biens sociaux…, mais surtout affaire du sang contaminé).
En outre, le débat sur le traité de Maastricht instaurant l'Union européenne (référendum de septembre 1992) fait apparaître des lignes de fracture partageant aussi bien la majorité que l'opposition, ce qui relativise le traditionnel clivage gauche-droite. Les élections régionales et cantonales de mars 1992 constituent un sévère avertissement pour le PS, qui recueille moins de 20 % des voix.
La deuxième cohabitation : mars 1993-mai 1995
Les législatives de mars 1993 sont un véritable désastre pour la gauche, qui n'obtient que 93 sièges sur 577. Le suicide de P. Bérégovoy, le 1er mai suivant, jour de la fête du Travail, ajoute la dimension d'un drame humain à cette déconfiture politique. La droite ne profite que médiocrement de la situation.
Malgré l'écrasante majorité dont il dispose au Parlement, le nouveau Premier ministre, Édouard Balladur, ne parvient pas à rétablir la situation là où il est le plus attendu, c'est-à-dire sur le terrain économique. Le déficit budgétaire dérape dans des proportions inquiétantes, le projet de contrat d'insertion professionnelle (CIP) doit être abandonné. L'année 1993 se solde par une croissance négative du PIB et la Bourse perd plus de 17 % en 1994. En revanche, c'est sans aucune difficulté que C. Pasqua, de nouveau ministre de l'Intérieur, peut faire adopter tout un dispositif législatif réformant dans un sens restrictif le Code de la nationalité, le droit d'asile, les contrôles d'identité (juillet-novembre 1993). Mais, conçues dans une stricte perspective sécuritaire, ces lois seront pour partie censurées par le Conseil constitutionnel.
L'approche de la fin du second septennat de F. Mitterrand pèse lourdement sur le climat politique. Le président est gravement malade – il mourra quelques mois après la fin de son mandat, le 8 janvier 1996 – et les informations qu'il livre sur son passé comme sur sa vie privée déconcertent l'opinion. Sa succession fait l'objet d'âpres rivalités, tout au moins dans les rangs de la droite, qui dispose de deux candidats déclarés et crédibles, tous deux membres du RPR, J. Chirac (qui en est le président) et É. Balladur. Au PS, on laisse sans trop de réticences à Lionel Jospin, peu connu du grand public, le soin de défendre un camp promis à la défaite.
6. Les deux présidences de Jacques Chirac : 1995-2002 et 2002-2007
À l'initiative de Jacques Chirac, qui en fut le premier bénéficiaire, la durée du mandat présidentiel est ramenée de 7 à 5 ans, par la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000, mise en œuvre en 2002
Grâce à une campagne dynamique, axée sur la réduction de la fracture sociale, Jacques Chirac sort vainqueur de l'élection présidentielle (7 mai 1995), alors que les sondages donnaient Édouard Balladur gagnant. Lionel Jospin crée une seconde surprise : en tête au premier tour, il obtient 47,2 % des voix au second, score inespéré pour un parti socialiste que l'on dit exsangue.
6.1. Le gouvernement Juppé : mai 1995-juin 1997
Alain Juppé, fidèle adjoint de Jacques Chirac, est nommé Premier ministre. Son gouvernement constitue une innovation, avec un nombre record de femmes. La conjoncture demeurant morose, il doit renoncer peu à peu aux promesses de la campagne électorale : loin de diminuer les impôts, il augmente la TVA de 2 points.
En novembre, le gouvernement est « resserré », et les femmes secrétaires d'État sont les principales victimes de ce remaniement. Dès lors, Alain Juppé s'attache en priorité au sauvetage de la Sécurité sociale, dont les déficits vont croissant. Son « plan », mais aussi son style, jugé technocratique, le rendent impopulaire.
Fin 1995, grèves dans les transports publics et manifestations imposantes se multiplient, avec le soutien de la majorité de l'opinion. Maintenu dans ses fonctions, Alain Juppé doit faire face à un problème supplémentaire, celui des « sans-papiers », qui mobilise de nombreuses personnalités du monde du spectacle. La manière forte utilisée pour évacuer l'église Saint-Bernard de Paris (août 1996) choque, y compris à droite. Le 21 avril 1997, à la surprise générale, Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée nationale. La campagne électorale, menée par Lionel Jospin, aboutit à une nette victoire des socialistes aux législatives de juin et à une déstabilisation de la droite.
6.2. La troisième cohabitation : juin 1997-mai 2002
Des réformes prudentes
Le gouvernement de Lionel Jospin, dit de la « gauche plurielle », fait preuve d'un réformisme réel mais prudent. La lutte contre le chômage et l'exclusion constitue le premier axe de son action. Il mise sur les emplois-jeunes et sur la réduction du temps de travail ou RTT, (lois de 1998 et 2000 sur les « 35 heures » promues par Martine Aubry). La situation économique se redresse : le nombre des chômeurs tombe au-dessous des 3 millions dès 1998 et continue ensuite de diminuer. Par ailleurs, un bon accueil est fait à la couverture maladie universelle (CMU) [à l'initiative de M. Aubry] en juin 1999.
D'autres réformes modernisent le cadre juridique de la vie sociale française : pacte civil de solidarité (pacs) ; parité hommes/femmes dans les élections ; acquisition de la nationalité française facilitée. La régularisation des sans-papiers est jugée trop timorée par une partie de la gauche et la réforme de la Justice, tendant à une plus grande indépendance des juges, divise les états-majors politiques et socio-professionnels. Les réformes constitutionnelles (mandat présidentiel de cinq ans) et « inversion du calendrier » des élections sont perçues comme un jeu politicien.
Enfin, la capacité du gouvernement à résoudre le problème corse, revenu au premier plan de l'actualité avec l'assassinat du préfet Érignac (février 1998), est durement mise à l'épreuve. Les négociations, entamées au début de l'an 2000 avec toutes les parties concernées, y compris les nationalistes, s'enlisent et le climat politique de l'île se dégrade à nouveau.
En politique étrangère, la continuité caractérise l'action du gouvernement Jospin (construction de l'Europe, modernisation de la Défense, participation aux opérations internationales de maintien de la paix), malgré quelques infléchissements. Le sommet de Nice (décembre 2000), qui clôt une phase de présidence française de l'Union européenne assez terne, témoigne d'un essoufflement général de la dynamique unitaire.
L'État prend une certaine distance par rapport à l'interventionnisme traditionnel en Afrique noire (intégration du ministère de la Coopération au sein des Affaires étrangères, neutralité de la France lors du coup d'État en Côte d'Ivoire de décembre 1999). Enfin, les réserves de Paris à l'égard d'une justice pénale internationale sont partiellement levées.
Le malaise politique
Les élections municipales de mars 2001 mettent en lumière un réel malaise politique. Malgré un bilan « honorable » du gouvernement, la droite apparaît majoritaire en voix. À gauche, les « révolutionnaires », mécontents du « social-libéralisme » du gouvernement, marquent des points, ainsi que les écologistes, alors que les socialistes stagnent et que le parti communiste continue sa chute.
La droite, de son côté, n'est qu'à moitié satisfaite : les querelles de partis et/ou de personnes mettent à mal des positions solides (perte de Lyon et de Paris). L'extrême droite maintient son potentiel aux alentours de 15 % de l'électorat, mais, du fait de sa division, disparaît pratiquement des conseils municipaux. Plus significative encore est la progression de l'abstention, particulièrement forte chez les jeunes. Le décalage entre les attentes des citoyens et le fonctionnement de la démocratie représentative s'accentue.
Le « séisme » du 21 avril 2002
Ce malaise politique va éclater au grand jour le 21 avril 2002, au premier tour de l'élection présidentielle. Les Français, médusés, apprennent que L. Jospin est battu et que le second tour opposera J. Chirac à J.-M. Le Pen. Avec moins de 4 % des voix, le PCF connaît une régression considérable. Les abstentionnistes (28,40 %) n'ont jamais été aussi nombreux à une élection présidentielle. L'extrême droite recueille 19,20 % des suffrages, l'extrême gauche, 10,44 %, et Chasse, Pêche, Nature et Tradition (CPNT), 4,23 %.
À l'exception de Lutte ouvrière, tous les partis démocrates appellent à voter au second tour pour J. Chirac. Ce « front commun » est efficace : le 5 mai, l'abstention tombe à 20 % et J. Chirac obtient 82,21 % des suffrages. Mais, avec 5,5 millions de voix, le FN fait désormais jeu égal avec le PS et le RPR.
Aux législatives de juin, tout se passe comme si les Français, ayant élu un président de droite, s'attachaient à lui donner les moyens de gouverner : ils élisent une nouvelle « chambre introuvable » dans laquelle la droite dispose de 399 sièges contre 178 à la gauche. Cependant, le malaise perdure : l'abstention atteint des sommets historiques (35,59 et 39,68 %).
6.3. Les gouvernements Raffarin : mai 2002-mai 2005
Jean-Pierre Raffarin, président (Démocratie libérale) du Conseil régional de Poitou-Charentes, est nommé Premier ministre. Perçu comme un modéré libéral, il s'attache à mettre en œuvre les promesses du candidat Chirac, notamment la lutte contre l'insécurité, la baisse des impôts sur le revenu et la réforme des retraites. Mais des difficultés ne tardent pas à surgir.
Le thème de la sécurité est l'occasion pour le dynamique ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, de se mettre en avant et d'afficher ouvertement ses ambitions présidentielles, ce qui affaiblit la cohésion du gouvernement. La réforme des retraites inquiète une très large partie de l'opinion. La baisse de l'impôt sur le revenu se heurte à la mauvaise conjoncture économique (croissance en berne, stagnation des recettes fiscales et accroissement du chômage) et le gouvernement est conduit à rogner de nombreux budgets, hormis la Défense et l'Intérieur.
La décentralisation, chère à J.-P. Raffarin, apparaît à beaucoup comme un moyen pour l'État de se « défausser » d'une partie de ses charges sur les collectivités territoriales ; la réforme du statut des intermittents du spectacle se heurte à l'opposition virulente de ces derniers ; le ministre de l'Éducation nationale déclenche par ses propositions de réformes la colère des enseignants (juin 2003), une catastrophe sanitaire due à la canicule (15 000 décès parmi les personnes âgées) met en évidence la vacance du pouvoir (août)… Ainsi, peu à peu, la cote du Premier ministre et la confiance dans le gouvernement s'effondrent-elles.
Le président souffre moins de cette désaffection de l'opinion. Sans doute lui est-elle reconnaissante de son refus de suivre les États-Unis dans leur guerre contre l'Iraq. Elle approuve également l'envoi puis le maintien de militaires français en Côte d'Ivoire, qui s'en tiennent, jusqu'à présent, à leur rôle de force d'interposition. Elle ne semble pas lui tenir rigueur de l'isolement croissant de la France au sein de l'Europe (non-respect du « pacte de stabilité », menées franco-allemandes pour en modifier la donne, rejet initial du projet de Constitution européenne, ratification mal engagée du traité finalement établi).
Le paysage politique manque de relief. Les partis de gouvernement s'érodent. À droite, l'Union pour un mouvement populaire (UMP), fondée en novembre 2002 en tant que grand parti conservateur, apparaît comme une création à caractère électoraliste, sans véritable projet de société. Au point de susciter ce qui pourrait devenir une véritable dissidence, sous l'impulsion du centriste François Bayrou et de ce qui reste de l'UDF. La gauche plurielle n'existe plus, le PCF peine à se reconstruire, le PS, toujours traumatisé par le 21 avril 2002, menace de tomber dans les querelles de présidentiables et son message politique est brouillé. L'opposition politique reste atone et les manifestations de rue sans grand effet.
Dans ce contexte, les résultats des élections cantonales et surtout régionales des 21 et 29 mars 2004 créent la surprise. D'une part, pour la première fois depuis vingt ans, l'érosion de la participation est stoppée, les électeurs se sont fortement mobilisés. D'autre part, les partis extrêmes ne profitent pas de la situation : le FN confirme son ancrage dans le paysage politique mais ne progresse pas ; l'alliance Ligue communiste révolutionnaire (LCR) et Lutte ouvrière conduit les vieux rivaux trotskistes à un désastre électoral. La gauche, que l'on disait désunie, enregistre une progression spectaculaire, et s'apprête désormais à diriger 21 Régions sur 22 en métropole. Le PCF lui-même reconquiert un peu du terrain perdu.
À l'évidence, les électeurs ont voulu sanctionner la politique menée par le gouvernement Raffarin, qu'ils jugent, notamment, peu soucieuse de justice sociale et alignée sur les vœux patronaux. Le remaniement qui s'ensuit ne leur paraît être qu'un replâtrage, remplaçant les quelques représentants de la société civile dont l'action et les projets de réforme ont cristallisé les mécontentements par des professionnels de la politique.
Aussi, les élections européennes du 13 juin 2004 constituent-elles un nouveau coup de semonce pour le gouvernement et son parti, l'UMP, qui plafonne à 16,6 % des voix. La droite républicaine (37 %), qui inclut cette formation aux côtés d'une UDF dopée par un bon score (près de 12 %), et des souverainistes emmenés à nouveau – mais séparément cette fois – par Philippe de Villiers et Charles Pasqua (6,7 % et 1,7 %), est devancée par une gauche (43 %) tirée par le PS, redevenu le premier parti de France avec 28,9 % des suffrages. Les Verts et le PCF sont en recul par rapport à 1999, avec respectivement 7,4 % et 5,2 % des voix, contre 9,7 % et 6,8 %.
Privé du soutien populaire, plombé par les mauvais chiffres du chômage (qui repasse au-dessus de la barre des 10 % de la population active), le gouvernement ne peut se prévaloir de la réforme de la Sécurité sociale pour faire pièce au pessimisme ambiant (crainte de délocalisations, inquiétudes sur le pouvoir d'achat) : celle-ci fait figure d'expédient. Surveillé de près par N. Sarkozy, qui a quitté ses rangs pour être élu à la tête de l'UMP à la fin novembre 2004, il mène une campagne difficile pour le référendum sur le traité constitutionnel européen. Le rejet net de celui-ci par les Français le 29 mai 2005 (54,68 % des suffrages en faveur du « non » contre 45,32 % pour le « oui »), dans un contexte de forte participation (69,34 %), constitue un cinglant désaveu pour le président Chirac et le gouvernement. Le 31 mai, J.-P. Raffarin démissionne. Dominique de Villepin est nommé Premier ministre.
6.4. Le gouvernement de Villepin : mai 2005-mai 2007
À peine entré en fonction, Dominique de Villepin marque la rupture qu'il veut incarner en affichant sa détermination à faire reculer le chômage. Pourtant ses marges de manœuvre, en l'absence de perspectives nettes de croissance, demeurent réduites ; par ailleurs, l'équipe dont il s'entoure comprend nombre d'anciens ministres de J.-P. Raffarin ; quant à N. Sarkozy, il est à nouveau titulaire du portefeuille de l'Intérieur, et numéro deux du gouvernement, ce qui crée une source potentielle de conflit politique au sommet.
La bataille pour l'emploi
Le plan de bataille pour l'emploi mis en œuvre débouche en août sur le contrat nouvelle embauche (CNE) qui assouplit, à l'attention des petites entreprises, les conditions d'embauche par CDI. Le Premier ministre fait montre de fermeté lors du conflit social à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) et des développements de la question corse. Il doit cependant affronter la révolte des banlieues, qui enflamme pendant près de trois semaines, du 27 octobre à la mi-novembre, plus de 400 quartiers dans le pays : ce n'est qu'en ressortant une loi d'exception datant de la guerre d'Algérie que le gouvernement finit par mettre un terme aux accès de colère de cette frange, déshéritée, de la société et de la jeunesse.
Par ailleurs, la stature présidentielle que D. de Villepin adopte à la suite de l'accident vasculaire cérébral du chef de l'État (septembre 2005), ravive la rivalité entre les possibles prétendants à la succession de J. Chirac. C'est dans ce contexte de tension à droite, de malaise social et de désarroi des jeunes que le Premier ministre tente d'imposer, début 2006, le contrat première embauche (CPE) – mesure assouplissant les règles d'embauche des moins de 26 ans et destinée à leur permettre d'entrer plus facilement sur le marché du travail. Devant l'opposition manifestée, des semaines durant, par les étudiants, les lycéens et les syndicats, qui y voient un début de remise en cause du Code du travail, le Premier ministre est finalement contraint de renoncer à appliquer le CPE, ce qui paraît sonner le glas de ses ambitions présidentielles.
Éclate alors l'« affaire Clearstream », un scandale qui vise, sans toutefois provoquer trop de dommages, N. Sarkozy, et qui, surtout, révèle la permanence de fortes tensions au sein du gouvernement et de l'UMP à propos des échéances de 2007. L'été 2006 est marqué par l'adoption de la loi relative à l'immigration et à l'intégration (loi Ceseda, Code sur l’entrée et le séjour des étrangers et sur le droit d'asile) ainsi que par les résistances d'une partie de la population à une vague d'expulsions.
Campagne et élection présidentielles d'avril-mai 2007
En novembre, au terme de la primaire inédite que le PS a organisée auprès de ses adhérents, Ségolène Royal est élue candidate officielle avec 60,65 % des voix contre 20,69 % pour Dominique Strauss-Kahn et 18,66 % pour Laurent Fabius.
En janvier 2007, l'UMP officialise la candidature de N. Sarkozy. F. Bayrou, le candidat centriste de la « nouvelle UDF » fait bientôt figure de « troisième homme » dans les sondages. Le 11 mars, J. Chirac annonce sa décision de ne pas briguer un troisième mandat.
La campagne, que dominent la personnalité et les propositions du candidat de l'UMP, passionne de toute évidence les Français, comme le confirme le taux de participation très élevé du premier tour : près de 84 % des inscrits – chiffre proche du record de 1965 – se sont rendus aux urnes, pour placer en tête N. Sarkozy (31,18 % des voix), devant S. Royal (25,87 %), F. Bayrou (18,57 %) et J.-M. Le Pen (10,44 %). Le recul du score du FN, qui perd, essentiellement au profit du premier, un million de voix par rapport au premier tour des élections de 2002, est spectaculaire, tout comme l'effondrement des Verts et des petits partis d'extrême gauche.
Malgré l'appel de ces derniers à faire barrage à la droite, et la neutralité bienveillante de F. Bayrou envers S. Royal, N. Sarkozy, finalement soutenu par le gros de l'appareil UDF, remporte un second tour plus mobilisateur encore (84 % de participation) avec 53,06 % des voix contre 46,94 % à sa rivale socialiste. Investi le 16 mai, il nomme François Fillon au poste de Premier ministre.
7. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy (mai 2007-mai 2012)
7.1. Le temps de l'omniprésence : réformes et ouverture tous azimuts
Décidé à mener la politique de rupture annoncée dans la campagne et à occuper tout l'espace politique, quitte à court-circuiter son Premier ministre François Fillon, N. Sarkozy ouvre le gouvernement à des personnalités de gauche et à des membres des « minorités visibles ».
Alain Juppé, symboliquement promu numéro deux, est titulaire d'un grand ministère de l'Environnement, tandis que le fidèle Brice Hortefeux hérite d'un tout nouveau ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale.
Les législatives de juin qui s'ensuivent conjuguent les paradoxes : abstention historique de l'ordre de 40 %, et correction brutale du premier tour – amorce d'un véritable tsunami de droite, qui voit 109 députés de la majorité élus ou réélus sur 110 – au second, beaucoup plus favorable aux partis d'opposition, avec un groupe PS et apparentés qui passe à 203 représentants.
Fort néanmoins d'une confortable majorité à l'Assemblée, le gouvernement est remanié et complété : battu à Bordeaux, A. Juppé est contraint de laisser son ministère à J.-L. Borloo, sanctionné pour avoir évoqué un projet de TVA sociale impopulaire. Christine Lagarde devient la première femme à la tête de Bercy, mais doit composer avec Éric Woerth (au Budget). De nouvelles figures du centre, de la gauche et des minorités rejoignent le gouvernement.
Le président entend être présent sur tous les fronts : intérieur, mais aussi européen, avec l'adoption en juin d'un traité simplifié destiné à remplacer la Constitution précédemment rejetée, et international, avec l'organisation à la fin du mois d'une conférence, à Paris, sur la situation au Darfour. Sous sa houlette, le gouvernement fait voter nombre de projets significatifs : autonomie des universités ; peines plancher et récidive des mineurs ; service minimal dans les transports terrestres ; renforcement du « bouclier fiscal » et abaissement des prélèvements sur les successions ; détaxation des heures supplémentaires ; immigration –cependant qu'il appelle les acteurs de la société civile à la concertation (Grenelle de l'environnement, fin octobre).
Sonné par son échec et les débauchages individuels (comme celui de D. Strauss-Kahn au Fonds monétaire international (FMI), le PS peine à s'opposer à un président qui reste populaire tout en poursuivant la mise en œuvre de son programme (réforme des régimes spéciaux des retraites, refonte de la carte judiciaire).
Le retournement de l'opinion publique ne tarde cependant pas. En quelques mois, N. Sarkozy perd le soutien populaire acquis lors de son élection :
– le passage au rouge des indicateurs économiques suscite un mécontentement croissant ;
– la multiplication des initiatives, qui apparaissent de plus en plus comme des effets d'annonce, désoriente l'opinion publique ;
– des choix diplomatiques (promotion de la vente de centrales nucléaires, réception du colonel Muammar Kadhafi en décembre 2007, mésentente avec l'Allemagne, atlantisme accentué) ou la tenue de propos officiels perçus comme impulsifs ou attentatoires au modèle républicain national (notamment laïc) ajoutent aux déceptions ;
– enfin, le rejet de l'affichage ostensible de la vie privée du chef de l'État (divorce en octobre puis remariage avec l'ex-mannequin et chanteuse Carla Bruni en février) se double d'interrogations sur sa capacité à « habiter la fonction ».
À l'inverse, le gouvernement, et notamment F. Fillon, gagnent en popularité. Cela toutefois n'empêche pas la majorité de connaître une véritable sanction lors des élections municipales et cantonales de mars 2008. À nouveau première force politique du pays, la gauche, emmenée par un PS redynamisé, regagne du terrain (57 départements sur 101, 3/5 des 952 villes de plus de 9 000 habitants, et toujours 22 Régions sur 24).
Remanié à la marge, le gouvernement amorce dès lors un virage plus marqué vers la rigueur. Il engage pendant l'été une vaste réorganisation de la carte militaire du pays mais fait aussi adopter le revenu de solidarité active (RSA) à l'intention des plus démunis. Dans le même temps, le président renforce le contingent national en Afghanistan. (Un an plus tard, en mars 2009, il annonce la réintégration officielle de la France dans l'OTAN).
Il fait entre-temps entériner par le Congrès une réforme des institutions taillée à sa mesure.
La présidence en exercice de l'Union européenne, qu'il endosse pour six mois en juillet 2008 dans un contexte difficile (à la suite du « non » irlandais au traité de Lisbonne et en pleine crise financière), redore son blason par son bilan :
– adoption d'un pacte européen sur l'immigration et sur l'asile ;
– lancement d'une Union pour la Méditerranée ;
– projet de réforme de la Politique agricole commune (PAC) ;
– accord sur un plan de lutte contre le réchauffement climatique et obtention de la tenue prochaine d'un nouveau référendum irlandais sur le traité de Lisbonne.
En outre, sa médiation au nom des Vingt-Sept dans l'affrontement qui oppose pendant l'été la Russie et la Géorgie convainc. Tout comme les premières initiatives qu'il prend pour faire face à la crise financière majeure venue des États-Unis : appel à une nouvelle régulation du capitalisme et à la concertation internationale et européenne, mesures d'urgence en faveur des banques et des secteurs fragilisés, programme de relance…
7.2. Le temps des incertitudes : doutes, interrogations et rebonds
L'aggravation de la conjoncture a toutefois tôt fait de conjuguer insatisfactions et mécontentements.
Face à la pire récession depuis 1945 et à une opposition qui cherche à relever la tête (élection problématique mais effective de Martine Aubry à la direction du PS en novembre, front commun des syndicats), le président procède à plusieurs mini-remaniements gouvernementaux successifs qui n'apaisent pas les inquiétudes et ne désamorcent pas les contestations. Celles-ci s'expriment notamment à propos de la vie chère dans les DOM-TOM et des réformes sur le travail dominical et les services publics comme la santé et l'éducation (lycée, université), mais elles n'entament guère la détermination du gouvernement qui maintient pour l'essentiel un cap rejeté par la rue.
L’arrivée en tête de l’UMP aux élections européennes de juin 2009 (avec 27,9 % des voix) et le score très médiocre (à peine 16,5 %) d’un PS encore divisé et talonné par Europe Écologie-Les Verts (EE-LV) masquent l’étiage des forces de droite (40 %).
Le 22 juin, devant le Congrès, N. Sarkozy annonce le lancement d’un grand emprunt national destiné à financer des investissements stratégiques. S’ensuit un nouveau remaniement ministériel qui ne parvient pas à redonner un souffle à l'équipe emmenée par le président. Dès l’automne 2009, dans un climat économique dégradé, une série d’initiatives et de révélations ternit un peu plus son image, entre autres :
– le projet de suppression de la taxe professionnelle et de réforme des collectivités territoriales passe mal auprès des élus ;
– l’idée d’une taxe carbone (au reste invalidée par le Conseil constitutionnel à la fin de l'année) trouble une majorité parlementaire que le rythme des réformes éreinte et qui s'estime méprisée par l’exécutif ;
– les rebondissements de l’affaire Clearstream et la mise en cause de D. de Villepin font songer à de l’acharnement et à un procès politique ;
– la tentative de promotion du jeune fils du président, Jean Sarkozy, à la tête du conseil d'administration de l'Établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (ÉPAD) choque ;
– le lancement d’un grand débat sur l’identité nationale passe pour une manœuvre politicienne, à l’approche des élections régionales ;
– la gestion de la prévention de l’épidémie de grippe A H1N1 sème le doute sur la pertinence des priorités définies au sommet de l’État ;
– enfin, la poursuite de la stratégie d’ouverture à gauche, avec la nomination, début 2010, de personnalités socialistes à la tête de la Cour des comptes et au Conseil constitutionnel, achève de déboussoler la droite.
7.3. Le temps des contestations : crise, affaires, échecs et impopularité
Le résultat des élections régionales de mars 2010 a valeur d’avertissement. L’abstention culmine aux deux tours à un niveau aussi haut que peut être bas le score des forces de droite (autour de 35 %). Le PS (29,5 %) dépasse l’UMP qui plafonne à 26,3 % ; il redevient, non seulement le premier parti du pays, mais aussi la composante dominante à gauche, puisque les listes d'EE-LV n’obtiennent qu’environ 12,5 % des suffrages. Suit le FN, stimulé par les débats sur l’identité nationale et le port du voile intégral (11,7 %). Quant au Front de gauche (6,1 %), il marginalise le NPA qui semble devoir payer le choix de son isolement. Le MoDem est quasiment écarté de la vie des Régions. Au second tour, l’union des forces de gauche réalise une performance historique (54,1 % des voix) et, non contente de conserver les 20 Régions métropolitaines qu’elle dirigeait, leur ajoute la Corse. Pour la droite, la sévérité de la défaite remet en cause la double stratégie présidentielle du parti unique et du siphonnage des voix du FN.
Cherchant à couper cours à la fronde qui monte des rangs de la majorité, N. Sarkozy décide d’adresser des signes à son électorat (agriculteurs, entrepreneurs, retraités). Il évoque une pause des réformes après le grand chantier des retraites qu'il décide en revanche d'ouvrir et renonce à la mise en place de la taxe carbone ainsi qu’à l’ouverture à gauche, ce dont témoigne le nouveau remaniement ministériel qui suit.
Mais très vite, de nouvelles crises affectent l'équipe en place : le dossier Karachi resurgit tandis que la situation financière de la zone euro s’aggrave nettement. La réforme des retraites – qui abroge les 60 ans, allonge la durée des cotisations et modifie leur assise pour apaiser les marchés – soulève un puissant mouvement de protestation qui dure jusqu’à la promulgation de la loi à l’automne. La contestation populaire est amplifiée par une succession de scandales éclaboussant l’exécutif (affaire Bettencourt, frais ministrériels poussant à la démission deux secrétaires d'État). Le gouvernement doit aussi faire face à la bronca des sénateurs opposés à la réforme territoriale.
Acculé à la riposte, le président choisit le terrain de la sécurité et de l’identité nationale : il fustige les « gens du voyage » et en appelle à un énième renforcement de la répression, évoquant la déchéance possible de la nationalité des délinquants français d’origine étrangère, ce qui suscite des remous au sein même de son camp – et jusqu’à Bruxelles.
Le profond remaniement annoncé haut et fort à l’issue de la déroute des régionales accouche finalement, mi-novembre, d’une reconduction des poids lourds des précédents gouvernements, au premier chef de F. Fillon. J.-L. Borloo, comme la plupart des centristes, quitte un exécutif de plus en plus estampillé du sceau RPR (retour d'Alain Juppé, arrivée et consolidation des fidèles du président) et de toute évidence déjà en campagne pour la présidentielle de 2012.
Ce nouvel équipage semble très vite pris de court par le « printemps arabe » du début 2011. Sur fond de contestations sectorielles, les imbroglios (avec le Mexique, le Maghreb, la Turquie…) conduisent vers la sortie la chef de la diplomatie française Michèle Alliot-Marie. À l’extrême fin février, un dixième remaniement ministériel confie à A. Juppé les clés du quai d’Orsay ; Claude Guéant remplace à l'Intérieur B. Hortefeux, objet d’une procédure judiciaire, mais ce dernier ne quitte pas l’entourage du chef d’État, devenant un de ses conseillers spéciaux. Désireux d'effacer l’erreur d’interprétation à propos des révoltes en Afrique du Nord, N. Sarkozy surprend en apportant, de concert avec la Grande-Bretagne de David Cameron, le soutien de la France aux insurgés libyens début mars.
Mais le front intérieur, lui, se délite un peu plus : au Parlement, les centristes font reculer le gouvernement sur le projet de sanction des meurtriers de policiers par la déchéance de la nationalité et, de façon historique, le Conseil constitutionnel censure 13 articles de cette loi sur la sécurité intérieure. Les élections cantonales de mars sont un nouveau revers pour l'UMP, suivie de près par le FN. La multiplication des triangulaires et des cas d’opposition gauche-extrême droite, crée dans le parti présientiel de profondes divisions entre les tenants d’une ligne « ni-ni », définie par son leader J.-F. Copé avec l’aval du chef de l'État, laissant libres de leurs choix les électeurs, et les partisans – parfois, à l’instar du Premier ministre – obligés de se rétracter, d’un front républicain pour faire obstacle aux frontistes. La gauche (54 % des voix au second tour), et notamment le PS (35,5 %), sort finalement confortée du suffrage et inflige un nouveau camouflet aux forces de droite.
Cette sanction incite les centristes comme J.-L. Borloo ou Hervé Morin, à revendiquer leur autonomie et à envisager une possible candidature à la présidentielle de 2012. D'autres prétendants ne se cachent plus : F. Bayrou, malgré un MoDem quasiment disparu du terrain politique national, et Marine Le Pen, qui a succédé à son père en janvier 2011 à la tête du FN.
À l’étranger, outre le front afghan, de plus en plus meurtrier, et le terrain libyen, les forces françaises investissent dans le cadre de l'ONUCI la Côte d’Ivoire, afin de chasser du pouvoir Laurent Gbagbo et de permettre à l’élu Alassane Ouattara de prendre les rênes du pays (début avril). Ces interventions ne permettent toutefois pas à N. Sarkozy de redresser sa cote auprès d’une opinion de plus en plus inquiète de la situation économique hexagonale comme européenne (crises de l’euro et des dettes souveraines). Des thèmes clivants très marqués à droite sont dès lors mis en avant : allègement substantiel de l'ISF, réduction de l’immigration légale, fermeture des frontières aux Tunisiens, défense de la laïcité (contre les prières musulmanes dans la rue dénoncées comme synonyme d’« Occupation » par Marine Le Pen), attaque en règle contre toute forme de « fraude sociale » et d’assistanat…
À gauche, Jean-Luc Mélenchon est investi par le PCF et les militants du Front de Gauche en juin 2011 et, au tout début de l’été, les écologistes, rejetant la proposition faite par Daniel Cohn-Bendit de s’effacer derrière les socialistes moyennant un bon accord législatif, désignent à l’issue d’une primaire l’ex-juge d’origine norvégienne Eva Joly.
Pendant ce temps, conformément à la charte de rénovation du parti, les socialistes s’engagent dans une campagne interne dominée par l’ombre tutélaire de D. Strauss-Kahn, à la grande popularité. Le promoteur des primaires, Arnaud Montebourg, est le premier à faire acte de candidature en novembre 2010. S. Royal lui emboîte le pas. Puis F. Hollande rend publique fin mars sa décision d’entrer dans la compétition. Les cartes sont rebattues lorsqu’à la mi-mai, le patron du FMI est arrêté à New York pour une sombre histoire de mœurs qui réduit à néant ses ambitions politiques nationales. M. Aubry se déclare dès lors fin juin. C. Lagarde prend alors la tête du FMI, ce qui entraîne un nouveau remaniement fin juin à Paris.
Pendant l’été, la crise des dettes souveraines s’aggrave dangereusement, aux États-Unis comme en Grèce et dans d'autres pays du Sud de l’Europe, mettant en danger l’intégrité même de la zone euro et plombant toute perspective de croissance pour l'année à venir. Les plans d'aide qui se succèdent ne parviennent pas à redonner confiance aux marchés qui attendent une réforme majeure de la gouvernance de l'UE.
Aussi l’annonce de la chute du régime de Kadhafi le 22 août (puis sa mort le 20 octobre) ne parvient-elle pas à doper la cote en berne de l’exécutif : un nouveau plan de rigueur qui prévoit 12 milliards de coupes est adopté, cependant que se font jour de nouvelles révélations embarrassantes dans les affaires Bettencourt, Karachi et africaines. À l'UMP prévaut aussi fortement la morosité.
Forte de ses victoires locales successives, la gauche fait basculer fin septembre pour la première fois dans l'histoire de la Ve République le Sénat. Au tout début de l'automne, les « primaires citoyennes » (du PS associé au PRG) qui opposent M. Aubry, le radical J.-M. Baylet, F. Hollande, A. Montebourg, S. Royal et M. Valls, rencontrent un succès inattendu. À l'issue d'un second tour, F. Hollande sort nettement vainqueur et l'opposition paradoxalement renforcée et unie.
7.4. Le temps de la campagne présidentielle
Si N. Sarkozy déclare officiellement sa candidature le 15 février 2012, la campagne présidentielle fait rage depuis des mois. Elle s'inscrit dans un climat marqué par la crise (dégradation du crédit financier du pays en janvier, troubles financiers européens en cascade, recul de la croissance, montée du chômage, désarroi général) et de multiples tensions (débats sur l’immigration et la place des étrangers en France, série d’assassinats ciblés par un jeune islamiste à Montauban et Toulouse en mars). Elle oppose dans un affrontement très âpre cinq principales personnalités que les sondages tendent à placer, pour le premier tour, dans un mouchoir de poche :
– F. Hollande, qui, au-delà d’un programme social-démocrate prudent et modéré, capitalise sur le rejet massif, dans la population, du chef de l’État ;
– N. Sarkozy, qui s’attache à rattraper son retard en multipliant les annonces et les œillades à la frange la plus droitière de son électorat ;
– F. Bayrou, qui prône une politique de vérité, ralliant des membres du Nouveau Centre et de l’UMP et escomptant rassembler là où le président sortant s’emploie à cliver ;
– J.-L. Mélenchon, qui entend damer le pion à l’extrême droite auprès de l’électorat populaire et orienter le débat nettement vers la gauche ;
– M. Le Pen qui cherche à répondre aux inquiétudes des ouvriers et classes moyennes fragilisées en appelant au rejet de l’Europe et à la fermeture des frontières.
La campagne ne passionne peut-être guère un électorat désorienté et inquiet de la situation économique et financière du pays, mais le premier tour du 22 avril témoigne d’une forte participation, aux alentours de 80 %. Fait sans précédent dans l’histoire de la Ve République, il place en tête l’opposant principal au président sortant, F. Hollande, avec 28,6 % des voix, N. Sarkozy n’obtenant que 27,2 % des suffrages. Suivent M. Le Pen (17,9 %), qui, non seulement fait mieux que son père lors des précédents scrutins, mais relègue loin derrière elle le candidat du Front de Gauche J.-L. Mélenchon (11,1 %). Le score de F. Bayrou s’effondre, à 9,1 %, tandis que les cinq autres candidats, dont ceux de l’extrême gauche et des Verts, sont marginalisés.
Pour le second tour, le Front de Gauche et les Verts se rallient aussitôt derrière F. Hollande. N. Sarkozy accentue sa démarche très droitière sans pour autant obtenir le soutien de M. Le Pen, qui fait savoir qu’elle votera blanc. Dans ces conditions, même s’il crée d’abord la surprise, F. Bayrou, qui ne donne aucune consigne à ses électeurs, annonce qu’à titre personnel il mettra dans l’urne un bulletin en faveur du candidat socialiste. Le résultat du 6 mai, plus serré qu’annoncé mais toujours marqué par une participation élevée (plus de 80 %), donne F. Hollande vainqueur, avec 51,6 % des voix. Lavant l’affront du 21 avril 2002, celui-ci devient le 7e président de la Ve République et le second socialiste à accéder à cette fonction.
8. La présidence de François Hollande (2012-2017)
8.1. Des débuts difficiles : crise et discrédit des gouvernements Ayrault
Entré en fonction le 15 mai, F. Hollande nomme à la tête du gouvernement le fidèle et social-démocrate Jean-Marc Ayrault, préféré à M. Aubry, avec laquelle les rapports personnels sont moins faciles. Le cabinet qu'il compose avec ce dernier s’ouvre aux sensibilités écologistes et radicales qui l’ont soutenu dans sa campagne (avec notamment Cécile Duflot, au Logement), et, exception faite des anciens ministres que sont Laurent Fabius (Affaires étrangères), Michel Sapin (Travail), Marilyse Lebranchu (Réforme de l’État), Pierre Moscovici (Économie), Jean-Yves Le Drian (Défense), affiche une volonté de renouvellement en même temps qu’une stricte parité homme/femme. Sont ainsi promus des « éléphants » et responsables de courant du PS (Manuel Valls, à l’Intérieur ; Arnaud Montebourg, au Redressement productif ; Vincent Peillon, à l’Éducation ; Benoît Hamon, à l’Économie solidaire) et des figures de la diversité (Christiane Taubira, à la Justice ; Najat Vallaud-Belkacem, porte-parolat et Droits des femmes ; Victorin Lurel, à l’Outre-Mer ; Kader Arif, aux Anciens combattants, etc.).
Les premières mesures (réduction du salaire et du train de vie des membres de l’exécutif, réaménagement de la réforme des retraites en fonction de la pénibilité du travail, de l’entrée dans la vie active ou des maternités, hausse de l'allocation rentrée pour les familles…) rencontrent un large assentiment et valent au PS et à ses alliés d’obtenir une confortable majorité (302 sièges pour les socialistes et apparentés, 13 pour les radicaux, 18 pour les Verts) à l’Assemblée nationale lors des élections législatives de juin.
Reconduit et élargi, le gouvernement s’attelle au redressement des comptes de l’État et élabore un programme de rigueur (gel des dépenses et liquidation de l’héritage fiscal du précédent quinquennat, avec la remise en cause de l’allègement de l’ISF, des droits de succession et de la défiscalisation des heures supplémentaires ; hausse des impôts et de la taxation des dividendes ; abrogation du projet sarkozien de TVA sociale). Ces orientations mécontentent bien sûr l’opposition de droite, mais aussi l’aile la plus radicale de la gauche, au point de faire des remous jusqu’au sein d’un PS partagé à l’idée de devoir suivre la politique d’austérité imposée par le traité budgétaire européen, voté toutefois par l’Assemblée au début d’octobre. Dans la foulée est instaurée une Banque publique de l’investissement, cependant qu’est adopté un plan de compétitivité destiné à venir en aide à l’industrie française, et qu’un tour de vis budgétaire supplémentaire est opéré (par l’augmentation des recettes de l’État et le relèvement des impôts indirects sur la consommation). En outre, la France acte son retrait d’Afghanistan.
La dégradation de la conjoncture associée à l’inexorable montée du chômage, à l’impression de flottement au sein de l’exécutif (tension entre le Premier ministre et A. Montebourg à propos de la nationalisation envisagée puis rejetée de l’aciérie Mittal de Florange en fin d’année), ainsi qu’aux velléités d’indépendance d’une partie de la majorité dans les deux chambres, met vite un terme à l’état de grâce dont le président bénéficie tout d'abord, nourrit l’idée d’impréparation de la nouvelle équipe dirigeante, et attise un rejet populiste de ce qui apparaît aux yeux d’une partie de l’opinion comme une « caste politique », éloignée des problèmes du terrain et insensible à ses souffrances. La chute aussi rapide qu’abyssale des cotes de popularité de F. Hollande, de J.-M. Ayrault – et des partis de gauche au pouvoir plus généralement –, ne profite toutefois guère à la principale force d’opposition, l’UMP, empêtrée dans une querelle de leadership entre Jean-François Copé et François Fillon, sur fonds d’hypothèque Sarkozy.
Semblant reprendre la main au début de l’année 2013, d’une part, à la faveur de l’accord conclu entre la plupart des partenaires sociaux au sujet de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi, et de l’autre, à la suite de l’envoi des troupes françaises contre l’avancée des forces islamistes au Mali, le gouvernement Hollande est coup sur coup ébranlé par la décision des responsables européens de réduire à terme l’enveloppe budgétaire communautaire, les mesures drastiques prises par l’UE pour résorber la crise financière chypriote, les manifestations d’hostilité de centaines de milliers d’opposants au projet de mariage homosexuel et la démission en mars de Jérôme Cahuzac, le charismatique ministre du Budget, coupable d’avoir dissimulé un compte bancaire en Suisse. Dans ce contexte, l’horizon économique toujours aussi plombé (panne de la croissance, multiplication des annonces de plans sociaux et hausse consécutive des sans-emplois) est favorable à une opposition de droite qui cherche à se reconstruire malgré l’accumulation, de son propre côté, d’affaires en tous genres et surtout à un Front national plus que jamais en embuscade. Au grand dam d’un PS en déshérence, victime de la démonétisation de l’exécutif et condamné à encaisser humiliation sur humiliation lors des scrutins partiels qui ponctuent la période.
L’absence d’unité et d’union dans la majorité, à l’Assemblée où des dizaines de députés PS tonnent contre la politique d’austérité suivie, au Sénat, où les groupes de gauche n’hésitent plus à retoquer les projets soumis par l’exécutif, ou encore au sein d’un gouvernement qui fait régulièrement étalage de ses divisions (D. Batho, débarquée début juillet pour avoir dénoncé publiquement la baisse programmée du budget de son ministère, l’Écologie ; tensions entre C. Taubira et M. Valls sur le contenu de la réforme pénale puis entre ce dernier et C. Duflot à propos des Roms ; divergences entre le nouveau ministre de l’Écologie Philippe Martin et A. Montebourg au sujet de l’exploitation des gaz de schiste) s’ajoute à la paralysie de l’activité, au coup de rabot budgétaire (baisse inédite depuis 1958 des dépenses d’1,5 milliard d’euros pour 2014), à une nouvelle hausse des impôts, et à une série de fiascos (isolement français dans le dossier syrien à la fin de l’été, pataquès de l’expulsion d’une jeune Rom, Leonarda, en octobre, échec de l’inversion promise de la courbe du chômage à la fin de l’année) pour assombrir un peu plus l’atmosphère générale. Aussi le bénéfice de la négociation réussie d’une nouvelle réforme des retraites en septembre a-t-il tôt fait de s’épuiser devant les mouvements de fronde qui se lèvent un peu partout du pays : ainsi des « bonnets rouges » bretons en octobre. Ce contexte dégradé contraint le gouvernement à des replis stratégiques (suspension de l’écotaxe à l’automne, enterrement du « big bang » fiscal et abandon du projet de loi sur la famille en février 2014), qui désorientent sa base sans satisfaire les contestataires, alors que l’intervention en Centrafrique à la fin de l’année ne suscite plus qu’une indifférence générale…
Le pacte de responsabilité annoncé au tournant 2014 (allègement supplémentaire des cotisations patronales de quelque 30 milliards d’euros), qui témoigne un peu plus de l’orientation pro-offre prise par le président, ne manque pas de relancer les débats à gauche, d’autant que cette nouvelle aide aux entreprises, rigueur oblige, se double d’un surcroît d’économies budgétaires, qu’elle n’implique pas de contreparties, et que son impact, perceptible seulement à long terme, s’avère difficile à chiffrer. Or le temps politique, court, multiplie lui les échéances qui se présentent mal pour la majorité au pouvoir. Et ce, malgré la cascade d’affaires qui éclabousse l’opposition de droite… Marquées par une abstention record (36,3 % au second tour), les élections municipales de mars consacrent une défaite historique pour le PS en particulier et la gauche en général. Celle-ci perd en effet 175 villes de plus de 9 000 habitants, dont des bastions comme Limoges, Niort, Belfort, Roubaix, Nevers, Bastia, Saint-Ouen, Bagnolet, Villejuif ou Bobigny, au profit de l’UMP et de ses alliés centristes, tandis que l’extrême droite confirme son implantation locale en remportant 14 mairies (11 pour le FN) et un total d’environ 1 400 sièges de conseillers.
8.2. Le temps des épreuves : défis et impopularité des gouvernements Valls
En quête de renouveau et de sursaut
La sévérité du verdict des urnes, conjuguée à toutes sortes de pressions et de manœuvres internes, contraint le chef de l’État à remanier le gouvernement au-delà ce qu’il avait prévu et notamment à remplacer J.-M. Ayrault par M. Valls à la tête d’une équipe désormais resserrée. À charge pour ce dernier d’amplifier la politique de rigueur et d’offre adoptée par son prédécesseur tout en marquant une rupture en matière d’image et de méthode. Restreint, le nouveau gouvernement, toujours paritaire, comprend 16 ministres, pour la plupart reconduits, mais les postes stratégiques reviennent à des « hollandais ». Les deux écologistes Cécile Duflot et Pascal Canfin, eux, décident de ne plus faire partie de l'exécutif, officiellement pour incompatibilité de ligne politique avec le nouveau Premier ministre.
C. Taubira conserve la Justice, pendant que son homologue PRG Sylvia Pinel hérite du Logement. Parmi les principaux changements, l’arrivée de Ségolène Royal, qui se voit confier l’Écologie, le Développement durable et l’Énergie, l’entrée de François Rebsamen aux Affaires sociales, ainsi que les promotions de A. Montebourg à l’Économie et de B. Hamon à l’Enseignement, succédant respectivement à V. Peillon et à P. Moscovici sur le départ. M. Sapin passe aux Finances, B. Cazeneuve à l’Intérieur, et G. Pau-Langevin aux Outre-mer, tandis qu’aux Droits des femmes N. Vallaud-Belkacem ajoute la Jeunesse et la Ville, cédant le porte-parolat à S. Le Foll (Agriculture).
Pour sa part, Jean-Pierre Jouyet, l'ami de longue date de F. Hollande, opère un chassé-croisé de la tête de la Caisse des dépôts au secrétariat général de la présidence avec Pierre-René Lemas. S’ajoutent à la liste des ministres quatorze secrétaires d’État, tout aussi mixtes, parmi lesquels l’ex-strauss-kahnien Jean-Marie Le Guen, aux Relations avec le Parlement, ou Harlem Désir, exfiltré de la direction du PS et installé aux Affaires européennes. Un autre proche de l'ancien patron du FMI, Jean-Christophe Cambadélis, se voit confier les rênes du parti qu’il guignait depuis deux ans, avec pour mission de le sauver de l'effondrement et de l'implosion.
Mais les élections européennes de la fin mai sanctionnent un peu plus encore un PS et une gauche plus que jamais à la peine. Avec 13,98 % des voix, le premier essuie de nouveau une sévère déculottée, tandis que la seconde ne rassemble que moins d’un tiers des suffrages, un étiage. L’abstention, elle, n’est pas loin d’établir un nouveau record, à près de 57 %, cependant que le FN réalise un score inégalé, à pratiquement 25 % des suffrages exprimés, loin devant l’UMP, difficilement établie à 20,79 %. Arrivé en tête du scrutin, le parti de Marine Le Pen obtient le plus fort contingent d’eurodéputés du pays, 24 (un gain de 21 sièges), contre 20 (− 10) pour la grande formation de droite et 13 (− 1) pour les socialistes. L’Alternative UDI-MoDem suit, avec 9,94 % des voix et 7 représentants, soit un de plus qu’auparavant, tandis que les Verts reculent à 8,95 % (6 parlementaires, 9 de moins) et que le Front de gauche stagne à 6,33 % et perd un élu (4). Véritable séisme, ce résultat, qui révèle la profondeur du mal-être et du désarroi des Français, hypothèque lourdement l'avenir des partis traditionnels.
Les répliques se succèdent : immédiatement à droite, avec l’affaire Bygmalion, qui dévoile l’ampleur des dépenses et fausses factures imputables à la campagne présidentielle de 2012, ébranle une UMP grevée de dettes, en décapite la tête et éclabousse N. Sarkozy ; progressivement pour le gouvernement, avec le redoublement de la grogne en interne, qui amène A. Montebourg et B. Hamon à dénoncer la politique économique suivie par l’exécutif à la fin d'août. La sanction tombe aussitôt : les contestataires, auxquels s’ajoute A. Filipetti, sont débarqués, et le remaniement qui s’ensuit donne au tandem Hollande-Valls l’occasion d’afficher clairement l’orientation sociale-libérale qui est la sienne. C’est ainsi à l’ex-inspecteur des Finances, banquier et conseiller économique du président Emmanuel Macron qu’est confié le portefeuille de l’Économie, tandis qu’à côté de quelques aménagements plus ou moins techniques, N. Vallaud-Belkacem hérite de l’Éducation et de la Recherche et F. Pellerin de la Culture. La démission forcée pour négligence fiscale du tout nouveau secrétaire d’État au Commerce, Thomas Thévenoud, ainsi que la sortie fracassante du brûlot de l’ancienne compagne du chef de l’État, Valérie Trierweiler, portent toutefois un coup à la nouvelle équipe, qui n’obtient que le soutien d’une majorité relative à l’Assemblée et quis, desservie par une croissance au point mort et en proie à de multiples protestations locales, doit batailler ferme pour lui faire accepter budget et loi de finances. Entre-temps, prolongement des précédents scrutins locaux, le Sénat rebascule à droite ; N. Sarkozy, qui se porte candidat à la présidence de l’UMP, l’enlève à la fin novembre, mais avec moins de 65 % des suffrages des militants, contre près de 30 % pour son principal challenger, Bruno Le Maire. Par ailleurs, sur le théâtre moyen-oriental, F. Hollande décide d'engager des moyens aériens dans la coalition internationale chargée de combattre l’organisation de l'État islamique qui a pris pied en Iraq et en Syrie.
L’épreuve du terrorisme
Les 7, 8 et 9 janvier, des attentats terroristes frappent Paris et sa banlieue proche, ciblant la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, des policiers, ainsi que les employés et clients d’un supermarché kasher, faisant au total 17 morts et de nombreux blessés. Un mouvement d’union nationale quasiment spontané fait descendre 4 à 5 millions de Français dans la rue, dans le cadre de défilés républicains qui culminent le 11 dans la capitale avec le rassemblement autour des proches des victimes de près d’une cinquantaine de chefs d’État et de gouvernement ainsi que d’une foule immense. Le crédit accordé à l’exécutif dans la gestion des événements, notamment la traque puis la neutralisation des trois djihadistes responsables du bain de sang, ne dure guère. Si le PS conserve le siège de député du Doubs laissé vacant par le départ à Bruxelles de P. Moscovici en février, il le doit surtout aux maladresses de l’UMP, éliminée du second tour, au profit d’un FN conquérant. Et la gauche achève de se diviser, tant à l’Assemblée où M. Valls utilise la procédure du 49-3 pour faire passer le projet de loi Macron de libéralisation de l’économie, contesté dans ses rangs, que sur le terrain où elle se présente en ordre dispersé. Aussi les élections départementales de mars lui infligent-elles un nouveau revers : elle doit concéder à une droite unie et ragaillardie 27 conseils, dont les symboliques Corrèze, Bouches-du-Rhône, Nord, Essonne, Côtes d’Armor, Allier… Contre les pronostics, et malgré d’excellents scores au premier tour ainsi qu’une implantation désormais effective sur tout le territoire, le Front national n’obtient qu’un total de 62 représentants et rate sa transformation de l’essai en ne raflant la direction d'aucun exécutif local.
Tirant les leçons des scrutins, les principaux états-majors se mettent un peu plus en ordre de marche. Les dirigeants du FN poursuivent leur stratégie de dédiabolisation en profitant d’une nouvelle sortie de J.-M. Le Pen sur les chambres à gaz pour l’évincer du parti à la fin de l’été – non toutefois sans résistance ni difficulté. De son côté, rallié bon gré mal gré au principe de primaires ouvertes pour l’automne 2016, N. Sarkozy accentue au printemps son emprise sur l’appareil UMP, qu’il rebaptise « Les Républicains », et proroge son accord avec l’UDI en vue des élections régionales de la fin d’année. Le PS, quant à lui, officialise finalement le leadership intérimaire de J.-C. Cambadélis puis confirme son alliance tactique avec le PRG, mais, en raison de vives dissensions sur ses marges, il se trouve dans l’incapacité de sceller le moindre accord avec les autres formations de gauche. Les Verts de C. Duflot campent sur leurs positions anti-gouvernement et se prononcent en faveur de listes autonomes et/ou communes au PG et au PC, ce qui suscite bientôt les départs successifs de F. de Rugy, de J.-F. Placé, puis de B. Pompili et de quelques autres élus. En proie à une croissance toujours en berne, à des menaces terroristes accrues, et aux incertitudes que font planer sur l’intégrité de l’UE le sort de la Grèce et la pression migratoire aux frontières du continent, l’exécutif joue la carte de l’autorité et de l’action réformatrice, au risque de heurter un peu plus une partie de sa majorité et de sa base électorale. Suivant – de très loin – l’exemple de l'Allemagne qui ouvre alors largement les portes du pays aux exilés, il envisage finalement d’accueillir quelque 24 000 réfugiés de Syrie et, par ailleurs, autorise l’armée de l’air à bombarder les positions de l’EI dans la région.
Sur l'échiquier politique, les lignes évoluent sensiblement. Au début de septembre, Myriam El Khomri est promue au ministère du Travail en remplacement de F. Rebsamen, parti rejoindre sa ville de Dijon ; en vue des prochaines élections régionales, J.-F. Cambadélis organise à la mi-octobre une consultation populaire sur l’union des listes à gauche qui reste sans effet ; de la même manière, J.-M. Ayrault se rappelle au bon souvenir du gouvernement en proposant un amendement au projet de budget portant sur la fusion de l’impôt et de la CSG, qui vise à la modernisation ainsi qu'à la justice fiscales et reçoit un accueil favorable sur les bancs de la majorité jusque chez les frondeurs ; les élus Verts sécessionnistes se regroupent pour leur part dans un mouvement pro-gouvernement appelé Écologistes !. La compétition liée aux primaires s’accentue à droite, obligeant N. Sarkozy, distancé dans les sondages, à quitter son costume de rassembleur pour soutenir des propositions de plus en plus tranchées ; en revanche, les querelles familiales sur fond de révélations de malversations et autres scandales financiers n’entament en rien le pouvoir de séduction du FN, au point que M. Valls finit par envisager l'hypothèse d’une fusion des listes PS-droite pour contrer son essor au second tour des régionales.
Trois équipes de djihadistes se réclamant de l’organisation État islamique ciblent à nouveau la capitale au soir du 13 novembre 2015, faisant 130 morts et 352 blessés parmi la population rassemblée au Stade de France, dans des cafés de l’Est parisien, et dans la salle de concerts du Bataclan. Pour la première fois depuis 1955, l’état d’urgence est décrété sur l’ensemble du territoire. Devant le Congrès réuni le 16, F. Hollande annonce son intention de modifier la Constitution pour faciliter la mise en œuvre de cette disposition et renforcer la protection du pays. Afin de complaire aux représentants de droite prompts à demander des comptes et dorénavant réticents à toute manifestation d'union sacrée, il projette de déchoir de la nationalité les binationaux coupables de terrorisme. Les deux chambres votent peu après l’extension des mesures d’exception pour une période de trois mois à la quasi-unanimité, cependant que s’intensifie la traque des complices et que s’ouvre, malgré tout, à Paris la Conférence internationale sur la planète et le climat (COP21) présidée par L. Fabius et qui aboutit à l'élaboration d'un grand accord.
Les élections régionales de décembre, elles aussi en définitive maintenues, voient comme prévu le FN arriver en tête au premier tour avec près de 28 % des voix, contre un peu plus de 27 % pour l’alliance LR-UDI et environ 23 % pour le PS. Pour lui faire barrage, ce dernier retire sans contrepartie ses listes dans deux des régions que le premier menace de ravir, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et PACA. Le second tour consacre le succès d’une opération qui ne produit en somme ni vainqueur ni vaincu, puisque l’extrême droite n’enlève aucun exécutif mais progresse et s’implante davantage localement, et que droite et gauche se partagent finalement les conseils (respectivement 7 et 5 chacun).
En revanche, la question de la déchéance de la nationalité empoisonne les relations du pouvoir avec sa majorité parlementaire, tout en divisant à droite. C. Taubira, en désaccord avec le projet, démissionne de son poste de ministre de la Justice à la fin de janvier 2016 pour être remplacée par Jean-Jacques Urvoas, proche de M. Valls. La nomination de L. Fabius à la tête du Conseil constitutionnel en février et le départ de S. Pinel pour la vice-présidence du conseil régional d’Occitanie occasionnent un remaniement d’ampleur limitée : chargé du Quai d’Orsay, J.-M. Ayrault reprend du service, en lien direct avec le chef de l'État, tandis que, par le truchement de trois de leurs membres, des écologistes en rupture de ban avec leur formation réintègrent l’exécutif, comme pour mieux ressouder une gauche de gouvernement en grande difficulté, au moment où de nouvelles revendications catégorielles se font jour dans la rue et où jeunes, syndicalistes et salariés montent au créneau contre une réforme critiquée du Code du travail.
Bien qu’ayant obtenu le prolongement de l’état d’urgence pour trois mois supplémentaires, puis à nouveau jusqu’à la fin de juillet, le président, incapable de réunir la majorité des 3/5 nécessaire à la révision constitutionnelle, est contraint de battre en retraite à la fin de mars, alors même que, peu après l’interpellation dans la banlieue de Bruxelles d’un des principaux responsables des attentats parisiens de novembre, de nouvelles attaques font 32 victimes dans la capitale belge. En revanche, comptant sur les effets de l’amélioration de la conjoncture, et moyennant quelques concessions faites aux syndicats réformistes, le gouvernement entend imposer sa réforme du droit du travail, dite loi El Khomri : bravant les frondeurs de sa majorité à l’Assemblée et leur hypothétique censure, il engage à nouveau au début mai, puis en juillet, la procédure du 49-3 et table en définitive, avec raison, sur l'épuisement du mouvement de grèves et de manifestations qui a peu à peu gagné le pays.
La perspective des échéances présidentielles à venir et l’état de délitement de nombre de forces politiques précipitent les grandes manœuvres partisanes tout en aiguisant les ambitions personnelles. L’élaboration puis le passage en force de la loi travail laissent de profondes traces et obèrent les espoirs de la gauche de se maintenir au pouvoir. L’appareil d’un PS plus divisé que jamais parvient toutefois à négocier avec les radicaux et les écologistes ralliés à l’exécutif un accord sur le principe de primaires communes, cependant que ce qui reste des Verts doit renoncer à l’idée de voir le populaire N. Hulot porter leurs couleurs et se résigner, dans la controverse, à organiser une consultation interne à l’automne. J.-L. Mélenchon, qui a unilatéralement annoncé sa candidature dès février sous la bannière d’une nouvelle formation, La France insoumise (LFI), sans en référer à ses alliés communistes, enterre bientôt, de ce fait, un Front de gauche agonisant. À l’étonnement – pour ne pas dire mécontentement – de certains de ses collègues du gouvernement, E. Macron lance au printemps un mouvement politique, En Marche !, et, même s’il se défend alors de faire campagne, il organise au début de juillet un premier grand meeting. L’UDI rejette l’idée de participation à la primaire organisée par Les Républicains, où se bousculent déjà têtes d’affiche et seconds rôles, voire figurants. Pendant ce temps, dans le silence et comme en réserve, M. Le Pen, qui observe la montée du phénomène Trump aux États-Unis et le vote britannique en faveur du Brexit, capitalise sur l’exaspération, la radicalisation et les peurs qui agitent en parallèle la population française.
Après une série d’attaques par des individus isolés se réclamant de l’EI (à Valence et à Paris contre des agents en faction et un commissariat au tout début de l’année ; au même moment à Marseille contre un passant portant la kippa ; puis en juin à Magnanville, dans les Yvelines, contre un couple de fonctionnaires de police qui y laisse la vie), un attentat à la camionnette bélier lors précisément – et symboliquement – du feu d’artifice du 14 juillet sur la promenade des Anglais, à Nice, sème à nouveau la consternation et la désolation (86 morts, dont 10 enfants et adolescents, et 434 blessés). Sur fond de passe d’armes entre opposition de droite et gouvernement sur le niveau préalable de sécurité, l’état d’urgence qui devait prendre fin est prolongé de six mois. À peine quinze jours plus tard, le 26, dans une nouvelle expression de la barbarie terroriste, deux jeunes recrues de l'EI investissent une église de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen, pour y égorger deux octogénaires, le prêtre et un fidèle, tuant le premier.
Mouvements et opérations de campagne
Dans ce contexte troublé, les positions des uns et des autres se précisent au cours de l’été. M. Valls, qui place ostensiblement son action sous le signe de la défense intransigeante des valeurs républicaines et de la laïcité, s’avance comme recours possible, même s’il prend soin de réitérer sa loyauté envers le président de la République. Pour leur part, J.-L. Bennahmias, de Front démocrate, et F. de Rugy, d’Écologistes !, font connaître leur intention de participer à la compétition organisée par le PS, tout comme bientôt les frondeurs B. Hamon et A. Montebourg. C. Duflot, quant à elle, se résout à concourir à celle des Verts, dont elle ne voulait pas, face à ses confrères Yannick Jadot, Karima Delli et Michèle Rivasi. E. Macron crée la surprise en quittant à la fin d’août le gouvernement pour se consacrer à une campagne qui, pour l’heure, ne dit pas encore son nom mais en prend visiblement l’allure. N. Sarkozy, cerné par de multiples affaires judiciaires, durcit son discours et choisit de cliver toujours davantage en matière d’autorité, d’identité et de sécurité, avant de rompre le secret de Polichinelle qui entourait sa candidature à la grande consultation de droite. Une fois entré dans l’arène, il s’en prend frontalement au favori des sondages, A. Juppé, mais aussi aux seconds couteaux que sont alors J.-F. Copé, F. Fillon, N. Kosciusko-Morizet, B. Le Maire, ainsi que le président du petit parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson. Pendant ce temps, M. Le Pen et le FN, plus que jamais en embuscade, accentuent leur pression sur les uns et les autres.
L’automne se poursuit, assombri par l’atonie de la croissance, la morosité ambiante et des mouvements de protestation catégorielle. Mais la bataille en vue de la présidentielle suscite de toute évidence dans l’opinion l’intérêt, ou, à défaut, et comme en contrepoint, de vives préoccupations. Pour preuve, le succès de la primaire dite de la droite et du centre : à la mi-octobre, le premier débat télévisé entre les 7 concurrents rassemble 5,6 millions de spectateurs, et ils sont encore plusieurs millions à suivre les deux autres joutes, qui au total sanctionnent les prestations et propositions de B. Le Maire et de N. Sarkozy, confortent A. Juppé dans son statut de leader et de fédérateur, et révèlent le projet très conservateur et très libéral de F. Fillon, dont le sérieux de la personnalité déclenche, in fine, une dynamique aussi puissante qu’irrésistible. C’est de fait ce dernier qui, avec le niveau très élevé de la participation (4,3 millions de votants), crée la surprise en novembre au premier tour de la consultation, en prenant la pole position (44,1 % des voix), loin devant le maire de Bordeaux (28,6 %) et l’ancien chef de l’État (20,7 %), sèchement éliminé de la course. Le second tour amplifie les tendances puisque, soutenu par presque tous les autres candidats, F. Fillon emporte 66,5 % des 4,4 millions d'électeurs qui se sont déplacés, devenant de la sorte le chef de file de son camp et, par voie de conséquence, le nouveau favori de la prochaine présidentielle. Les sondages le placent en effet aussitôt largement en tête, reléguant sans peine M. Le Pen, pourtant créditée d’un robuste socle d’environ un quart des inscrits.
À gauche, malgré de nouvelles frictions avec un PCF qui finit par se résoudre à l’adouber, J.-L. Mélenchon porte un projet de transformation radicale qui nourrit au sein de la population une certaine curiosité et entraîne derrière ses propositions et sa personnalité quelque 10 % des électeurs. À l’inverse, les primaires organisées par les appareils politiques se déroulent mal : celle des Verts flirte avec le fiasco, du fait de la très faible participation enregistrée. Et comme à droite, elle aboutit à l’humiliation des grandes figures : C. Duflot ne parvient pas à se qualifier pour le second tour, qui voit Y. Jadot l’emporter sur M. Rivasi. Au PS, le dispositif concocté pour neutraliser la contestation interne au chef de l’État tourne court. La publication en octobre d’Un président ne devrait pas dire ça, un condensé de cinq années d’échanges entre F. Hollande et un duo de journalistes du Monde, qui révèlent que celui-ci leur a communiqué des informations censées rester secrètes, aggrave sa démonétisation sur le marché électoral comme sa délégitimation dans son camp, au point désormais de laisser clairement envisager son retrait de la compétition. Profitant des remous de l’affaire, de l’impression de flottement au sommet du pouvoir et d’un frémissement d’intérêt en faveur de sa démarche, E. Macron officialise un mois plus tard, à la mi-novembre, sa candidature, tandis que, le 1er décembre, dans une allocution faite aux Français, F. Hollande se résigne à leur notifier sa décision de ne pas briguer un second mandat. Très vite dès lors, fort de sondages encourageants, M. Valls se porte candidat à la primaire du PS et démissionne de ses fonctions exécutives. Il est aussitôt remplacé à Matignon par B. Cazeneuve et le gouvernement remanié à la marge. L’état d’urgence est prolongé. De leur côté, V. Peillon et S. Pinel rejoignent les rangs des prétendants à la consultation prévue pour janvier.
8.3. Impacts de la bataille électorale et rebondissements d’une campagne sans pareille
Le gouvernement Cazeneuve, la campagne et des développements imprévus
Marine Le Pen entame l’année 2017 en position de force, ce qui nourrit les plus grands espoirs des responsables, militants et sympathisants frontistes. F. Fillon, qui s'était montré cohérent et inflexible lors du débat télévisé, pâtit de sa volte-face sur la privatisation de la Sécurité sociale. E. Macron, qui s’affirme « et de gauche et de droite », bénéficie de l’espace laissé vacant au centre après la défaite de A. Juppé et le renoncement de F. Hollande. J.-L. Mélenchon, quant à lui, commence à engranger les fruits de sa longue campagne en faveur d’une société alternative, ouvertement environnementaliste et progressiste. Les primaires dites de la gauche déjouent initialement les craintes de leurs concepteurs avant d’être rattrapées par le mauvais sort : près de 4 millions de spectateurs assistent en effet aux premiers échanges télévisés entre les 7 postulants, mais le débat s’avère si terne que l’audience chute lors des deux autres débats. Ces derniers n’en permettent pas moins de distinguer le programme radical et écologique de B. Hamon, qui arrive en tête du vote, avec 36,5 % des voix sur 1,6 million d’inscrits, coiffant une fois de plus, selon un scénario désormais bien établi, le favori initial. En effet, M. Valls, longtemps promis à la victoire, sort affaibli de l’épreuve, et ne récolte que 31,9 % des suffrages. Une série de cafouillages sur le chiffre de la participation, d’abord gonflé puis révisé à la baisse, ainsi que sur les scores respectifs des candidats, un temps contestés, entache en outre le déroulement de la consultation. Le débat entre les deux finalistes confirme la donne : au second tour, B. Hamon l’emporte facilement sur son rival, avec 58,7 % des quelque 2 millions de participants. Peu après, à l’instar de F. Hollande, M. Valls fait connaître son intention de se mettre en retrait de la campagne…
Une nouvelle affaire, le « Penelopegate », occasionne un énième coup de chamboule-tout. À partir de la fin de janvier, en effet, s’égrènent des révélations dévastatrices sur les montants importants touchés pendant des années par la femme de F. Fillon, Penelope, en tant qu’assistante parlementaire de son mari ou de son suppléant, et conseillère littéraire de la Revue des Deux Mondes, dirigée par le financier et proche du candidat LR Marc Ladreit de Lacharrière, alors même que la réalité du travail fourni dans ces occupations fait l’objet de sérieux doutes. De nouvelles fuites sur l’allocation très personnelle et familiale des indemnités de l’ancien représentant de la Sarthe impliquent bientôt également deux des enfants du couple. La défense maladroite des intéressés sème le trouble dans l’opinion, jusque dans l’électorat de droite et les grands soutiens de F. Fillon. Attaqué de toutes parts, et bien que poussé au retrait par sa garde rapprochée, F. Fillon adopte une stratégie jusqu’au-boutiste : il dénonce un hallali médiatico-judiciaire, voire une machination de l’appareil d’État, et en appelle in fine au tribunal des urnes. L’annonce, au début de mars, de sa prochaine mise en examen précipite la débandade parmi ce qui reste de ses soutiens, mais celui qui n’entend nullement abandonner la course se débrouille pour court-circuiter tout plan B (notamment Juppé), ressouder des pans entiers du parti et de la base autour d’une ligne programmatique très dure et, moyennant un nouvel accord électoral législatif, faire retourner la plupart des centristes de l’UDI dans le giron. Pourtant, au cours du mois, de nouvelles révélations achèvent d’empoisonner et de compromettre la poursuite de la campagne. Rattrapée de son côté par la justice dans le cadre des affaires liées aux frais de campagne 2012 et aux emplois présumés fictifs du FN au Parlement européen, M. Le Pen crie elle aussi à la cabale et sursoit finalement à toute injonction ou convocation avant la fin de l’ensemble de la séquence électorale, imposant de son propre chef une parenthèse forcée au travail des magistrats.
Le retentissement de ces rebondissements est cependant loin d’oblitérer les premiers faux pas du candidat qui, dorénavant sans rival au centre gauche et séduisant largement à droite, paraît bénéficier d’une conjonction des astres providentielle, E. Macron : quelques mots malheureux à la mi-février sur la colonisation en Algérie, ou sur le débat à propos du mariage pour tous à Paris, viennent infléchir la courbe de son ascension. Mais des ralliements en tout genre, comme celui, peu après, de F. de Rugy, qui s’affranchit du contrat de la primaire de gauche, ou celui, au même moment, à la portée autrement plus considérable, de F. Bayrou, autour d’une vision commune alliant rigueur, attention portée aux milieux populaires, recomposition du paysage politique, réforme institutionnelle et moralisation de la vie publique, le remettent solidement en selle et le placent en position de favori. De fait, de nouveaux soutiens symboliques ou de poids ne tardent pas à compléter la liste déjà fournie de ses appuis : ainsi de D. Cohn-Bendit, ou de figures du PS comme le président de l’Assemblée C. Bartolone, B. Delanoë, puis même M. Valls… De son côté, initialement plutôt bien placé dans les sondages d’intentions de vote, le candidat socialiste négocie une alliance avec les écologistes, ce qui aboutit au retrait de Y. Jadot mais, malgré les pressants appels du pied faits à J.-L. Mélenchon par des communistes attachés au principe de l’union de la gauche, il échoue à conclure un pacte similaire avec le leader de LFI, qui fait le pari de l’inversion prochaine des courbes de sondages en sa faveur. Pari réussi, puisqu’au début du printemps, à la suite notamment de prestations lors des débats télévisés jugées réussies, sa popularité décolle enfin, avec la captation d’une bonne partie de l’électorat de B. Hamon.
Le verdict des urnes
Dans ce contexte inédit de rebondissements imprévus, le premier tour du 23 avril, paradoxalement, ne réserve guère de surprises : certes, l’abstention, à 22,23 %, s’avère plus limitée qu’annoncé. Mais, comme prévu par les sondages, si les 4 candidats qui émergent nettement se tiennent dans un mouchoir de poche, E. Macron et Marine Le Pen se retrouvent finalement face à face, avec respectivement 24,01 et 21,30 % des suffrages. Un prétendant de 39 ans encore largement inconnu des Français à la fin de 2017, dépourvu de toute expérience électorale préalable et ayant initialement pour seul appui un mouvement créé à peine un an plus tôt, vient à bout de concurrents autrement patentés, de solides routiers de la vie politique, et de la puissante logistique de leurs partis. Malgré un résultat en deçà des attentes, M. Le Pen, elle, assoit son emprise, gagnant plus de 3,5 points et 1,2 million de voix par rapport à 2012. Elle arrive d’ailleurs en tête dans environ la moitié des départements, en particulier dans les Hauts-de-France (31,03 % à l’échelle régionale) et le Grand-Est (27,78 %), progresse dans ses bastions et renforce ses positions en outre-mer et dans les villes. Pour la première fois dans l’histoire de la Ve République, la droite et son candidat sont éliminés du second tour : F. Fillon doit se contenter de la troisième place et d’un socle, certes non négligeable mais insuffisant, de 20,02 % des voix. Il est talonné par J.-L. Mélenchon, qui, à 19,58 %, réalise un score historique mais voit disparaître l’espoir de se qualifier. Le PS subit une humiliation : B. Hamon obtient 6,36 %, juste au-dessus du seuil de remboursement des frais de campagne. Suivent les petits candidats, tels que le souverainiste de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan (4,70%), le centriste indépendant Jean Lassalle (1,21), Philippe Poutou, du NPA (1,09), le partisan du « Frexit » François Asselineau (0,92), Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrière (0,64%), et le routier des campagnes Jacques Cheminade (0,18).
Malgré l’élimination de leurs champions, les ténors de gauche et de droite organisent immédiatement un front républicain : B. Hamon, B. Cazeneuve, C. Taubira, les principaux responsables socialistes et communistes, les grands barons de la droite, A. Juppé, J.-P. Raffarin, B. Le Maire, F. Baroin, J.-C. Lagarde, E. Morin se prononcent sans hésiter en faveur d’E. Macron, tout comme F. Fillon, qui précise toutefois le faire à titre personnel. Les jours qui suivent rallongent considérablement la liste des ralliements, avec notamment F. Hollande puis N. Sarkozy ou les leaders des principaux mouvements syndicaux. Mais l’initiative est plus difficile à faire accepter dans la frange dure de LR, qui, emmenée par L. Wauquiez, fait le choix de la neutralité, tandis que, du côté de LFI, J.-L. Mélenchon sort finalement du silence ambigu, longtemps maintenu, pour décider de ne donner aucune consigne officielle de vote. Le gaulliste N. Dupont-Aignan, lui, opère un rapprochement stratégique avec M. Le Pen, qui lui promet le poste de Premier ministre si elle est élue. L’affrontement entre les deux finalistes est violent, tant sur le terrain, où l’un et l’autre se marquent à la culotte, qu’à la télévision, lors du débat du 3 mai, dont la candidate du FN sort, de l’aveu général, décrédibilisée par son agressivité et ses contradictions. Le second tour du 7 mai confirme donc la donne en attribuant 66,1 % des voix exprimées à E. Macron, qui devient, de fait, le nouveau visage de l’exécutif, le plus jeune chef d’État du pays et l’un des plus confortablement élus. Son score apparaît sans appel, même si l’abstention est remontée à 25,44 % ; le nombre de bulletins blancs ou nuls atteint un niveau très élevé à 11,47 %, et M. Le Pen réunit derrière elle, en définitive, 10,7 millions de suffrages. Peu après le verdict des urnes, désireux de s’inscrire dans la profondeur historique du pays, le futur nouveau président met en scène sa victoire par une marche symbolique suivie d’une allocution devant une foule réunie sur l’esplanade du Louvre.
Changement d’ère et passation des pouvoirs
L’élection du nouveau président participe d’un big bang politique : si d’aucuns, dans les appareils traditionnels, estiment impossible l’obtention, aux prochaines législatives, d’une majorité destinée à mettre en œuvre son programme, d’autres, au contraire, prennent la mesure des bouleversements induits par sa victoire et s’emploient à les accompagner, quitte à les rendre plus inéluctables encore. Aussi droite et gauche se divisent-elles immédiatement d’une part en ailes plutôt favorables à un soutien au futur chef de l’État, bientôt appelées « Macron-compatibles », et d’autre part en blocs d’adeptes d’une opposition ferme et résolue. M. Valls fait ainsi très tôt connaître son intention de rejoindre le mouvement de son ancien ministre ; pour leur part, B. Le Maire puis A. Juppé, et nombre de leurs proches, ne font pas mystère des convergences existant entre hommes et projets, jusqu’à envisager une possible coopération avec l’équipe bientôt au pouvoir. La formation En marche !, rebaptisée La République en marche (LRM), décide de ne pas présenter de candidat dans des circonscriptions où les candidats, de gauche ou de droite, sont jugés compatibles avec le nouvel exécutif. Et certains élus socialistes franchissent le pas, quittent le PS et obtiennent l’investiture LRM pour les échéances de juin. Les défections sont moindres chez les Républicains, mais les rangs des candidats qui affichent une certaine proximité avec le nouveau chef de l’État grossissent singulièrement. Aussi les états-majors PS et LR, déjà particulièrement fragilisés par la déroute au scrutin présidentiel, n’en sont-ils que davantage ébranlés.
Les autres états-majors politiques subissent tout autant l’onde de choc de la présidentielle : parmi les cadres du FN, le temps est au ressassement amer de la défaite, voire au règlement de comptes, à telle enseigne que M. Maréchal-Le Pen décide de se mettre en retrait, au moins temporairement, de la vie publique ; en butte à la fronde des plus droitiers du mouvement, F. Philippot continue de défendre l’orientation souverainiste et anti-euro adoptée par la candidate et songe à organiser autour de ces grandes orientations un courant du parti ; quant à N. Dupont-Aignan, il s’empresse de dénoncer les accords conclus dans l’entre-deux-tours et s’engage en solo dans la bataille des législatives. À l’autre bout du spectre politique, le torchon brûle désormais à nouveau entre LFI et le PCF, contraints en fait de mener campagne à part ; les Verts sont écartelés entre les obligations issues de l’alliance passée avec les socialistes de B. Hamon et un fort tropisme mélenchoniste. Enfin, insatisfait du nombre d’investitures initialement consenti par la direction de LRM dans la perspective des scrutins de juin au regard de sa contribution à l’élection de E. Macron, F. Bayrou donne de la voix et, avec, au final, quelque 90 têtes de liste en lice dans les 577 circonscriptions hexagonales, finit par arracher un quasi-triplement du contingent MoDem concédé par le futur parti présidentiel.
La passation des pouvoirs a lieu une semaine après la désignation par les urnes du nouveau chef de l’État, le 14 mai. Alliant tradition et innovation, Emmanuel Macron choisit de défiler sur les Champs-Élysées dans un command-car militaire, puis de se rendre dans la foulée au chevet des soldats blessés soignés à l’hôpital Percy, à Clamart. Le lendemain, envoyant un message au centre droit et achevant de désorienter les Républicains et leurs alliés, il nomme Premier ministre un des leurs, le député-maire du Havre et juppéiste Édouard Philippe, avant de rejoindre la chancelière Merkel à Berlin, comme l’avait fait avant lui son prédécesseur, F. Hollande.
9. La présidence d’Emmanuel Macron (2017–)
9.1. Les gouvernements Philippe (depuis mai 2017)
Accident ou révolution politique ? Gestation d’un « nouveau monde »
Le gouvernement intérimaire, resserré, globalement paritaire, fait une large place aux experts et représentants de la société civile : ils sont en effet 11 au total, sur 18 ministres et 4 secrétaires d’État. Ainsi l’ex-DRH de Danone et haut fonctionnaire Muriel Pénicaud est-elle placée à la direction du Travail ; l’ancien recteur, professeur de droit et directeur de l’ESSEC Jean-Michel Blanquer prend les commandes de l’Éducation ; la présidente de l’université de Nice Frédérique Vidal hérite de l’Enseignement supérieur ; l’hématologue Agnès Buzyn dirige la Santé, l’éditrice Françoise Nyssen la Culture ou encore la championne d’escrime Laura Flessel les Sports… E. Macron et É. Philippe convainquent en outre le populaire journaliste, animateur télé et écologiste Nicolas Hulot d’intégrer l’exécutif, en le portant à la tête d’un grand ministère de l’Environnement et en le promouvant, lui et sa cause, au 3e rang protocolaire. Deux membres des cabinets Hollande reprennent du service, le patron de la Défense J.-Y. Le Drian, qui passe aux Affaires étrangères, et la radicale Annick Girardin, qui troque la Fonction publique contre les Outre-mer. Le baron et maire socialiste de Lyon Gérard Collomb décroche l’Intérieur et le titre de numéro 2 du gouvernement, tandis qu’un autre PRG rallié à E. Macron, le sénateur du Cantal Jacques Mézard, devient ministre de l’Agriculture. Du côté LRM, Richard Ferrand se voit confier l’important portefeuille des Territoires et de la Cohésion nationale, et Christophe Castaner, lui aussi ex-élu PS, est chargé des relations avec le Parlement ainsi que du porte-parolat. Le MoDem place dans la nouvelle équipe trois de ses têtes de file, et non des moindres : l’eurodéputée Sylvie Goulard aux Armées, Marielle de Sarnez aux Affaires européennes, et F. Bayrou à la Justice. Enfin, deux recrues venues de droite s’ajoutent à la liste des personnalités : Gérald Darmanin obtient le poste stratégique du Budget et des Comptes publics, et B. Le Maire est placé à la tête de la puissante forteresse de Bercy.
Rompus ou pas à l’exercice du pouvoir, les nouveaux promus semblent devoir particulièrement dépendre des directives venues de l’Élysée : la réduction imposée des effectifs de leurs cabinets rend d’autant plus impératifs le travail avec les conseillers du président et la concertation entre les différents échelons des organes de l’État. La composition du gouvernement atteste clairement que priorité est donnée à l’efficacité, ce qui séduit l’opinion et contribue à l’état de grâce dont bénéficient en général les chefs d’État à leur entrée en fonction. En outre – et ce n’est pas le moindre de ses buts et effets –, elle achève de troubler le marigot politique, de la gauche de gouvernement jusque dans les rangs des Républicains. Ainsi le PRG fait-il aussitôt une offre de service pour la période post-législatives ; quant à l’opposition LR, elle apparaît tétanisée, écartelée qu’elle est entre le parti pris du rejet frontal et l’option du soutien vigilant, pour ne rien dire des multiples tentations individuelles de ralliement qui l’ébranlent en interne. Pourtant, la divulgation par la presse d’une opération immobilière compromettante, effectuée dans le passé par le pilier du parti présidentiel et du gouvernement R. Ferrand, contrevient à l’objectif d’exemplarité qu’il s’est donné. Puis, à la veille du scrutin, une nouvelle affaire d’emplois fictifs au Parlement européen implique le MoDem et ses trois ministres, en particulier le garde des Sceaux F. Bayrou, sans pour autant altérer la popularité de l’équipe au pouvoir.
Jugés très réussis, les premiers pas de E. Macron sur la scène internationale à la fin du mois de mai (réunion de l’OTAN à Bruxelles, rencontre à cette occasion avec Donald Trump, sommet du G7 à Taormina) l’aident à revêtir aux yeux des Français les habits de chef d’État. Dans la foulée, il invite V. Poutine à Paris : désireux d’entourer la fonction présidentielle d’un surcroît de lustre et de solennité, et par égard pour son hôte et le pays qu’il représente, il choisit de situer sa rencontre avec le chef du Kremlin au château de Versailles, mais, attaché également à mettre en scène une certaine forme de courage et d’autorité, aborde frontalement les sujets qui fâchent (Ukraine, droits de l’homme). Dans ce contexte, les résultats du premier tour des législatives du 11 juin s’avèrent particulièrement bons pour le nouveau pouvoir et comme annonciateurs d’un futur raz de marée LRM et affidés qui recouvrirait in fine jusqu’aux 4/5e des bancs de l’Assemblée. En effet, souvent très jeunes et sans expérience d’élus, les candidats de ce tout nouveau mouvement recueillent 28,21 % des suffrages exprimés, et, avec l’allié MoDem (4,12 %), dont les responsables peuvent d’ores et déjà envisager la formation d’un groupe parlementaire conséquent, arrivent en tête dans 449 circonscriptions, se qualifient dans 64 autres et, au passage, terrassent nombre de barons locaux, voire de dinosaures nationaux. L’abstention, qui établit un record à 51,29 %, empêche la tenue de triangulaires, à l’exception d’une seule, ce qui a pour effet d’accroître la dynamique à l’œuvre, exceptionnellement favorable aux soutiens de E. Macron.
La recomposition du paysage politique du pays préfigurée lors de la présidentielle se confirme et elle se révèle cruelle pour toutes les autres formations : le PS s’effondre, à 7,44 % des voix ; la plupart de ses caciques sont déboulonnés, à l’instar de B. Hamon, J.-C. Cambadélis, Élisabeth Guigou, Jean Glavany… De son côté, tout aussi impacté, le PRG n’est en mesure d’aligner que 5 représentants au scrutin du 18 juin, et EELV, tout bonnement laminé, 2 ; émargeant à 2,72 %, le PCF ne peut en envoyer qu’une douzaine, quand LFI, qui recueille 11,03 % des voix à l’échelle nationale, parvient à repêcher un petit contingent de 67 de ses candidats. La droite n’est guère en meilleure posture : LR recule très nettement, pour plafonner à 15,77 %, tandis que l’UDI associée culmine à 3,03 % ; à eux deux, ces partis ne sauvent que 296 des leurs (264 pour LR, 32 pour l’UDI), dont 67 seulement (49 pour LR, 18 pour l’UDI) figurent devant leurs divers concurrents. Le FN, pour sa part, ne capitalise en rien son score de la présidentielle : les 13,20 % que ses candidats cumulent au niveau national lui permettent d’en renvoyer devant les électeurs 118, soit un maigre bataillon au regard des anticipations initiales.
Le second tour du 18 juin rectifie à la marge la tendance. L’abstention atteint un nouveau sommet, à 57,35 %, doublé d’un taux élevé de bulletins blancs ou nuls. LRM enlève facilement une majorité absolue, mais qui n’a rien du tsunami annoncé. Avec 43,06 % des voix et 308 sièges, le parti présidentiel dispose d’une confortable assise, que consolident l’allié MoDem (6,04 %) et ses 42 députés. LR sauve en définitive les meubles et fait élire 112 des siens, auxquels s’ajoutent 18 représentants de l’UDI. En revanche, N. Dupont-Aignan prolonge son mandat, comme, à quelques voix près, M. Valls. Comme prévu, le PS connaît un étiage mais, contre toute attente, dépêche 30 des siens à l’Assemblée… Le nouvel hémicycle comprend en outre 3 radicaux, 11 communistes et 17 députés LFI, dont J.-L. Mélenchon, qui peut dès lors prendre la tête d’un groupe parlementaire et ainsi faire pleinement entendre l’une des oppositions au gouvernement. À l’inverse, quoique élue, M. Le Pen ne peut compter à ses côtés que 7 collègues de parti et apparentés, en nombre insuffisant pour former un collectif institutionnellement reconnu et bénéficier d’un surcroît de temps de parole et de visibilité. Mais le bouleversement que connaît alors la représentation nationale n’est pas que politique et partisan, il est aussi humain : à l’issue de la consultation, les bancs du Parlement se trouvent profondément renouvelés. Certes, du fait de l’application de la loi sur le non-cumul des mandats, près de 250 parlementaires avaient décidé de se consacrer à leurs missions locales et de ne pas se représenter, ou de passer la main… En définitive, seuls 145 ont été reconduits dans leurs fonctions, soit un taux anormalement bas de 25 % de réélection. En conséquence, et à la faveur de la vague LRM, ce sont en fait 415 nouveaux députés qui découvrent l’Assemblée, en rajeunissent l’âge moyen, en diversifient le profil sociologique et la féminisent sensiblement (à presque 39 %).
En dépit de la très forte abstention, la victoire du parti présidentiel peut s’interpréter comme la confirmation populaire de la légitimité du nouvel exécutif, l’approbation de ses orientations et l’octroi d’un quitus pour la réalisation de son programme, ce qui n’échappe pas à nombre d’élus, à droite comme à gauche. Ainsi une douzaine de députés LR se désolidarisent-ils de la direction de leur parti pour former un groupe parlementaire distinct, dit des Constructifs. M. Valls, quant à lui, officialise bientôt sa sortie de l’orbite du PS pour rejoindre en tant qu’apparenté la galaxie LRM. Confirmé par ses administrés dans le Finistère, R. Ferrand est exfiltré du gouvernement et placé à la tête du groupe parlementaire, pléthorique, du parti présidentiel. Au même moment, S. Goulard démissionne pour pouvoir se défendre des accusations d’emploi fictif sans perturber le fonctionnement des Armées dont elle avait la charge. Son retrait précipite celui de F. Bayrou et de M. de Sarnez, ouvrant la voie à un remaniement gouvernemental moins technique et d’une plus grande ampleur que prévu. L’équipe Philippe II s’étoffe, composée désormais de 30 portefeuilles qui respectent, sur le papier, la parité. De nouveaux professionnels et représentants de la société civile font leur entrée : entre autres, la juriste Nicole Belloubet devient garde des Sceaux ; l’ex-secrétaire d’État de L. Jospin, haut fonctionnaire et responsable de la SNCF Florence Parly prend les commandes de la Défense ; la directrice de l’ENA Nathalie Loiseau est nommée aux Affaires européennes… Des permutations ont lieu : J. Mézard passe de l’Agriculture, qui revient à l’ancien socialiste Stéphane Travert, à la Cohésion et aux Territoires. Du côté du MoDem, Jacqueline Gourault obtient la charge de ministre déléguée auprès de G. Collomb et sa collègue Geneviève Darrieussecq est, de même, appelée à seconder la responsable des Armées. Deux personnalités de droite sont également cooptées, pour faire office de secrétaires d’État : c'est le cas pour Sébastien Lecornu, à l’Écologie, et pour le sénateur LR Jean-Baptiste Lemoyne, aux Affaires européennes. Les « marcheurs » historiques Benjamin Griveaux, Julien Denormandie et Brune Poirson complètent le dispositif et se voient attribuer de semblables attributions, respectivement à l’Économie, aux Territoires et à l’Écologie.
Sans surprise, les postes-clés du Parlement reviennent au même titre à des responsables LRM ou à des supplétifs de la formation : F. de Rugy, qui a rallié le mouvement et retrouvé son siège de Loire-Atlantique sous ses nouvelles couleurs, enlève le perchoir. Seule la présidence de la commission des Finances échoit à une figure de l’opposition, en l’occurrence le Républicain Éric Woerth. En parallèle, au Sénat, se constitue un petit groupe estampillé majorité présidentielle, essentiellement à partir d’une bonne vingtaine d’anciens socialistes emmenés par François Patriat. Rompant avec les usages, et au motif qu’il ne se soumettra pas à l’interview traditionnelle du 14 Juillet, E. Macron décide de réunir le Congrès à Versailles et de prononcer une grande allocution devant la population et la représentation nationale au tout début de juillet, à la veille du discours de politique générale que doit tenir à l’Assemblée son Premier ministre ; en signe de protestation, les représentations de LFI et du PC ainsi que des figures de l’UDI choisissent de boycotter l’événement. Le 4 juillet, le gouvernement Philippe obtient la confiance de 370 députés, et se trouve dès lors en position de mener tambour battant les réformes inscrites à l’agenda présidentiel…
Le gouvernement Philippe à l’œuvre : la transformation « en marche » ?
L’onde de choc des derniers scrutins n’en finit pas d’entraîner des répercussions dans les états-majors politiques. B. Hamon quitte bientôt le PS pour se consacrer au lancement d’un nouveau mouvement de gauche qui se veut fédérateur ; J.-F. Cambadélis cède la place, à la direction de ce qui reste du parti, à un collectif temporaire ; à droite, le champ se libère pour les ambitions affichées de L. Wauquiez ; au FN, les voix se lèvent, les comptes de l’après-second tour et des législatives se règlent, et le torchon brûle entre d’une part Florian Philippot et le courant qu’il anime désormais (« Les Patriotes ») et, d’autre part, M. Le Pen, les partisans d’un retour aux fondamentaux identitaires et conservateurs, et, en somme, le gros de l’appareil. Le président invite son homologue américain D. Trump à Paris et le convie au défilé du 14 Juillet dans une atmosphère particulièrement chaleureuse, alors que les relations se tendent, au sujet du surcroît d’effort exigé de la Défense par le nouveau gouvernement, avec le chef d’état-major des Armées Pierre de Villiers, qui, fait inédit, finit par démissionner. Attaché à la rigueur et au respect des règles de Maastricht, l’exécutif doit en effet compenser la baisse de la pression fiscale annoncée par des coupes d’ampleur similaire dans les dépenses publiques. La poursuite de la diète imposée aux fonctionnaires, les restrictions budgétaires demandées aux grands ministères, mais aussi l’effort réclamé auprès des collectivités territoriales passent mal. La hausse programmée de la CSG pour les retraités, l’étalement de la suppression de la taxe d’habitation ou de la baisse des cotisations salariales, puis l’amputation de 5 euros des APL à la fin de juillet suscitent la réprobation de l’opinion au regard des projets d’allégement, voire de suppression, de l’ISF, de l’assouplissement de la taxation des revenus des capitaux et de l’ensemble des mesures prises en faveur des entreprises pour doper l’initiative, l’innovation et l’investissement, en un mot la croissance. Aussi l’état de grâce semble-t-il prendre fin dès le milieu de l’été.
Mais le gouvernement poursuit résolument la ligne réformatrice qu’il s’est fixée. Il impose un rythme effréné aux assemblées, leur faisant voter un premier volet de la loi de moralisation de la vie publique pendant l’été et obtenant de sa majorité le droit de légiférer par ordonnances sur la réforme du Code du travail en chantier. Malgré l’agitation de la rue, la protestation des mouvements de gauche et le mécontentement de la plupart des organisations syndicales, qui s’estiment mises sur la touche, le président signe dès la fin de septembre ces textes qui ont pour but principal d’alléger les contraintes pesant sur la main-d’œuvre des TPE-PME, de faciliter les procédures de licenciement, de flexibiliser le marché de l’emploi et de contribuer à l’attractivité économique du pays. Les élections sénatoriales qui se tiennent à la fin du mois sanctionnent quelque peu LRM, qui, loin de passer à 50 comme un temps escompté, voit ses effectifs dans la Haute Assemblée se rétracter de 29 à 25 ; le PS résiste, même s’il ne compte plus que 69 représentants au lieu de 86 ; les communistes et affiliés conservent leur groupe, passé de 18 à 12 ; le contingent FN reste inchangé (à 2 membres) ; et la droite confirme sa domination de chambre, LR gagnant 17 sièges, à 159, et l’UDI 8, à 50. G. Larcher se succède de la sorte tout naturellement à la tête du Sénat.
À la fin de novembre, un petit remaniement consécutif à la nomination de C. Castaner à la tête de LRM le maintient dans l’équipe au pouvoir, comme secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, mais il est contraint de céder le porte-parolat, qui revient à B. Griveaux.À droite, l’impact des ralliements individuels et de la séduction qu’opère auprès de certains la politique suivie par l’exécutif continue de se faire sentir, mais les lignes s’éclaircissent aussi par contrecoup : au Sénat, 11 élus LR se désolidarisent du groupe pour en former un, au nom et autour des idées et valeurs des « Constructifs ». Par ailleurs, un certain nombre de soutiens de E. Macron, tels G. Darmanin, S. Lecornu ou encore le député Thierry Solère, que le bureau de LR n’est pas parvenu à exclure de ses rangs, abandonnent finalement d’eux-mêmes la formation pour rejoindre LRM. Un nouveau mouvement se crée, à la jointure des Républicains et des partisans du président, « Agir, la droite constructive ». Dans ce contexte de réalignement, la compétition pour la direction de LR oppose finalement en décembre 3 concurrents, L. Wauquiez, l’ancienne porte-parole et fidèle de F. Fillon Florence Portelli, et le jeune juppéiste Maël de Calan : le premier l’emporte facilement sur ses adversaires, avec près de 75 % des voix des quelque 40 % d’adhérents (environ 100 000) qui ont participé à la consultation.
Parallèlement aux sujets hexagonaux, E. Macron s’implique dans les grandes questions internationales, en particulier dans la question libyenne en invitant une première fois les parties en présence au dialogue. Au tout début de l’automne, il en appelle à une puissante relance de l’UE, autour notamment du développement du gouvernement et du budget de la zone euro, puis il obtient de ses partenaires un début de réglementation sur les emplois et travailleurs détachés si contestés dans le pays. En novembre, de passage à Abu Dhabi pour l’inauguration du nouveau Louvre et le renouvellement des partenariats entre la France et les Émirats arabes unis, il fait étape à Riyad et tente une médiation entre le royaume saoudien et son grand rival et ennemi iranien, puis s’implique dans la résolution des troubles qui agitent le Liban. En décembre, il célèbre le second anniversaire des accords sur le climat de Paris, qu’il entend préserver malgré le retrait des États-Unis de D. Trump, par la tenue d’un nouveau sommet international dans la capitale (en l’absence toutefois des dirigeants américain, chinois et allemand). Juste avant, au tout début du mois, É. Philippe fait, quant à lui, un déplacement remarqué en Nouvelle-Calédonie pour rassurer les populations locales, loyalistes autant qu’indépendantistes, un an avant le référendum sur l’autodétermination de l’archipel sur lequel les uns et les autres se sont mis d’accord en novembre.
Premières embûches
Le gouvernement affronte ses premières difficultés au cours de l’année 2018 tandis que le taux de popularité du président connaît une chute libre de 40 % en avril à 20 % en décembre. Occulté par la nouveauté et la dimension transpartisane du « macronisme », le fossé entre le « nouveau monde » annoncé par les « marcheurs » en 2017 et les territoires, déjà perceptible dans les résultats électoraux, s’élargit.
Promulguée en janvier, la loi fixant les orientations budgétaires pour les années 2018-2022 prévoit une réduction échelonnée de la dette et des dépenses publiques ainsi que des prélèvements obligatoires, tandis qu’un plan d’investissement de 57 milliards d’euros doit respecter quatre grandes orientations : l’accélération de la transition écologique, l’innovation, l’amélioration de l’accès à l’emploi et la modernisation (numérisation) de l’État.
Le chantier de la réforme de la fonction publique (rénovation du dialogue social, refonte de la politique de rémunération, augmentation du recours aux contractuels…) est lancé, suscitant l’opposition de la plupart des syndicats représentatifs, hostiles au développement de la contractualisation et de la possible rémunération « au mérite » selon des critères « antinomiques de ceux du service public ».
Les mécontentements se multiplient, en particulier parmi les retraités à la suite de l’augmentation de la CSG, entrée en vigueur en janvier, et chez les cheminots après l’adoption du nouveau pacte ferroviaire prévoyant une transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics et la fin du recrutement au statut en vigueur. À l’appel des syndicats CGT, Unsa, Sud et CFDT réunis en intersyndicale, une grève perlée de 48 heures tous les 5 jours est ainsi déclenchée d’avril à juin.
Les manifestations, en mars, avril et mai – dont une grève interprofessionnelle « contre la politique de Macron », une « Fête à Macron » à l’initiative du député de la France Insoumise François Ruffin et une « marée populaire » lancée par une soixantaine d’organisations – sont loin d’inquiéter le gouvernement, pourtant encouragé par certains à réorienter une politique annoncée à l’origine comme devant être « et de droite et de gauche » et désormais qualifiée plus simplement de « progressiste ». Après quelques concessions (dont la prise en charge par l’État de la dette de la SNCF) et une grève sans dommage majeur pour la plupart des usagers, la loi sur l’évolution des chemins de fer et l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire est promulguée le 27 juin.
Faute de relais locaux solides, le gouvernement doit nouer des relations de confiance avec les communes et départements, qui s’inquiètent notamment de la suppression programmée de la taxe d’habitation alors même que l’État leur demande une participation accrue à la réduction des dépenses publiques. Si un programme de revitalisation des centres-villes a été annoncé et si la contractualisation financière entre l’État et les collectivités en vue de contrôler leurs dépenses de fonctionnement a été acceptée par 70 % des 322 collectivités concernées, les relations entre le gouvernement et les associations d’élus restent tendues.
La politique de réformes structurelles est alors interrompue par l’« affaire Benalla » (du nom d’un chargé de mission auprès du président de la République, accusé d’avoir frappé deux manifestants le 1er mai à Paris, alors qu’il était équipé d’un brassard et d’une radio de police) qui focalise l’attention des médias depuis les révélations du Monde (18 juillet) et mobilise l’opposition (rejet de deux motions de censure le 31 juillet). Surmédiatisée, l’affaire écorne toutefois l’image présidentielle et sème le trouble dans le gouvernement, tandis qu’est mise en place une commission d’enquête parlementaire.
Promulguée le 30 juillet, la loi relative à la protection du secret des affaires suscite également des controverses (quant à la protection des « lanceurs d’alerte » et à la liberté de la presse) de même que celle relative aux migrants (« Pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie »), qui est amendée à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel visant à garantir un « principe de fraternité » (au nom duquel une aide désintéressée à des étrangers ne saurait être passible de poursuites).
Parallèlement, la réforme du marché du travail suit son cours avec le texte présenté par Muriel Pénicaud (« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »), axé sur l’apprentissage et la formation professionnelle, prévoyant également l’extension, sous conditions, des droits au chômage pour les salariés démissionnaires et travailleurs indépendants, et adopté le 1er août.
Cependant, tandis que le gouvernement connaît sa première crise ministérielle avec la démission de N. Hulot à la fin du mois d’août (remplacé par François de Rugy), montrant les limites des engagements écologiques de l’État, l’image d’E. Macron – perçu comme le « président des riches » depuis la suppression de l’ISF (en partie remplacé par l’IFI, impôt sur la fortune immobilière) et sa défense des « premiers de cordée » –, se détériore de plus belle. Le gouvernement est de nouveau fragilisé par le départ du ministre de l’Intérieur G. Collomb (le 3 octobre, en partie à la suite de l’affaire Benalla) qui laisse sa place à Christophe Castaner.
Soucieux alors de renouer avec la population, E. Macron entreprend, à partir du 5 novembre, une « itinérance mémorielle » dans l’est et le nord de la France, dans le but de commémorer le centenaire de la guerre de 1914-1918, mais aussi d’expliquer la politique et les réformes du gouvernement. Ces déplacements sont surtout l’occasion pour le président de prendre la mesure des mécontentements, alors que, depuis la fin du mois d’octobre, une sourde révolte couve avec l’apparition du mouvement des « gilets jaunes ».
Une crise sociale inédite : la révolte des « gilets jaunes »
Né sur les réseaux sociaux et nourri par ces derniers, le mouvement des « gilets jaunes » a notamment pour origine une pétition contre la hausse des prix des carburants, en particulier du gazole, à la suite de l’augmentation de la « taxe carbone » qui frappe au premier chef les habitants de la « France périphérique » (des villes moyennes et petites, rurale et périurbaine), obligés d’utiliser leur véhicule dans leurs déplacements quotidiens. Si cette grogne (dirigée également contre la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires) peut, au début, sembler conjoncturelle, la protestation s’amplifie – la pétition, lancée au mois de mai sur internet, récolte plus d’un million de signatures – et se transforme en un vaste mouvement qui prend la forme d’occupations spontanées de ronds-points, dans l’ensemble de l’Hexagone, à l’initiative de petits groupes n’ayant pour tout signe de ralliement que leurs gilets de sécurité. Sans chefs ni représentants,refusant toute récupération politique, à l’écart des syndicats totalement pris de court, le mouvement est difficile à cerner, même si les interprétations diverses l’associent au poujadisme des années 1950, voire aux jacqueries d’Ancien Régime, tandis que les premières ébauches d’analyse tendent à montrer un recrutement très majoritaire parmi les employés, les ouvriers et les « professions intermédiaires », actifs pour la plupart, mais aussi retraités, et avec une forte participation des femmes. Cette mobilisation hétéroclite attire des citoyens qui n’ont été jusque-là jamais ou peu engagés dans l’action collective et reçoit surtout le soutien massif de l’opinion publique.
Outre les occupations de ronds-points et de péages autoroutiers, la révolte prend la forme d’une manifestation hebdomadaire, chaque samedi, à partir du 17 ovembre. Visant directement, et parfois très agressivement, le Président, dont la démission est souvent réclamée, les manifestants peinent à s’organiser et, débordés par des « casseurs » et des activistes plus expérimentés, certains cortèges – celui du 1er décembre à Paris notamment – tournent à l’émeute et à l’affrontement violent avec les forces de l’ordre. Les revendications se multiplient, au-delà de la baisse du prix de l’essence à la pompe, exprimant un mécontentement général face au coût de la vie, au poids de la fiscalité et au creusement des inégalités. Traduisant la forte défiance à l’égard des élites politiques et singulièrement envers les nouveaux élus promus par LRM, allant jusqu’à l’antiparlementarisme dans les franges plus extrémistes, s’y ajoute cependant une demande politique de démocratie directe ou participative avec la proposition de référendum d’initiative citoyenne (RIC).
Après les premières concessions – augmentation de la prime à la conversion en cas d’achat d’un véhicule neuf, extension du chèque énergie, puis suspension de l’augmentation prévue de la « taxe carbone » –, le chef de l’État doit reconnaître la gravité de la crise. S’adressant aux Français dans une allocution télévisée, le 10 décembre, et constatant « un état d’urgence économique et social », il annonce une augmentation du SMIC de 100 euros (par une baisse des charges et la hausse de la prime d’activité), une défiscalisation des heures supplémentaires, l’annulation de la hausse de la CSG pour les retraites de moins de 2 000 euros par mois ainsi qu’une incitation au versement par les entreprises d’une prime exceptionnelle défiscalisée, des concessions jugées insuffisantes par une grande partie des « gilets jaunes », qui poursuivent leurs actions bien que leur mobilisation semble faiblir.
En signe d’ouverture et en vue d’un apaisement, l’organisation, de janvier à mars 2019, d’un grand débat national, devant aborder les questions de la transition écologique, de la fiscalité, des services publics, de l’évolution du débat démocratique et de l’immigration, est alors présenté comme l’acte II du quinquennat.