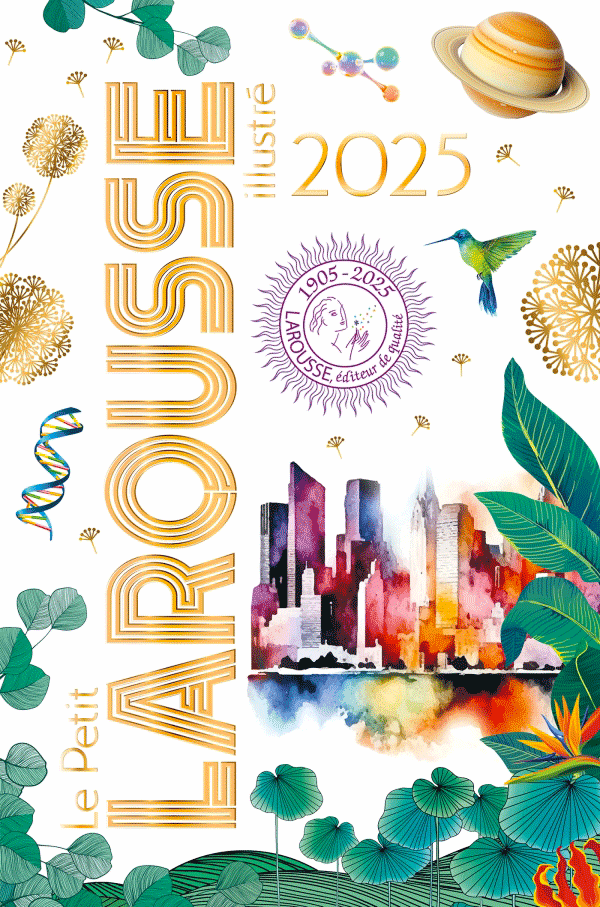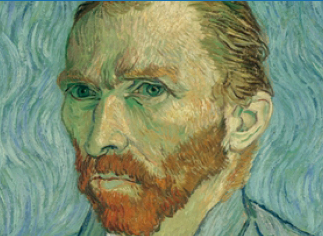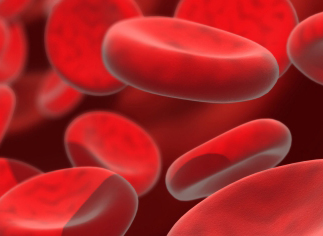Tunisie : histoire

Résumé L'Ifriqiya antéislamique Cœur de l'Ifriqiya après avoir été celui de l’empire punique de Carthage, et de l’Afrique proconsulaire, la Tunisie est conquise par les Arabes dans la seconde moitié du viie siècle. La conquête arabe Inaugurée avec la fondation de Kairouan par les Omeyyades en 670, cette conquête conduit à une islamisation et une arabisation rapide. Des Aghlabides aux Fatimides Le pays connaît une grande prospérité sous le règne des Aghlabides (800-909) qui s’émancipent de leurs suzerains abbassides avant d’être chassés du pouvoir par les Fatimides (910). xe-xie siècles : des Zirides aux Banu Hilal Transférés en Égypte (969), ces derniers laissent l’Ifriqiya à la dynastie berbère des Zirides (972-1148) qui, rejetant l’autorité du Caire au milieu du xie siècle subissent, en représailles, l’invasion de la tribu arabe des Banu Hilal (Hilaliens). Le royaume hafside de Tunisie (1229-1574) Les Almohades, régnant au Maroc, mettent fin aux troubles. Confiée alors aux Hafsides (1229-1574), l’Ifriqiya retrouve, avec désormais Tunis pour capitale – d’où son nouveau nom de Tunisie – expansion et prospérité, jusqu’à son inclusion dans l’Empire ottoman (1574). La Tunisie ottomane Affirmant cependant rapidement son autonomie vis-à-vis d’Istanbul, Tunis passe sous la souveraineté des dynasties beylicales des Muradides (1613-1702) puis des Husaynides (1705-1957). Un protectorat français Convoitée par l’Angleterre, la France et l’Italie, qui lui imposent leur tutelle financière, la Tunisie devient un protectorat français en 1881-1883. La marche vers l'indépendance Organisé par le Néo-Destour (1934), le mouvement nationaliste obtient l’indépendance en 1956. Depuis l'indépendance Jusqu’à son éloignement pour incapacité en 1987, son chef historique, Habib Bourguiba, imprime à la Tunisie une modernisation aux tendances laïcisantes, muselant ou contrôlant les oppositions, notamment islamistes, tout comme son successeur Zine el-Abidine Ben Ali, « réélu » sans interruption jusqu'à sa chute inattendue en janvier 2011, sous la pression de manifestations populaires.
1. La Tunisie antéislamique
1.1. Hégémonie de Carthage

Bien située à la jonction du bassin oriental et du bassin occidental de la Méditerranée, là où le détroit de Sicile la rend proche de l'Europe (140 km), la Tunisie est également le point de croisement de la seule route terrestre qui unit l'Égypte au Maghreb occidental (Algérie et Maroc), et des pistes caravanières qui, à travers le Sahara, permettent de gagner le Kanem et le Bornou.
Ainsi, au peuplement primitif de nomades berbères ont pu se superposer des apports ethniques très différents, venus souvent par mer. Dès le Ier millénaire avant J.-C., les Phéniciens établissent des colonies marchandes dans le sud de l'actuelle Tunisie ; colonie de Tyr, Carthage, fondée vers 820 avant J.-C., s'émancipe progressivement et impose son hégémonie aux autres colonies phéniciennes du détroit de Sicile et du golfe de la Petite Syrte. Il en résulte une orientalisation assez profonde des régions sédentarisées de l'Afrique du Nord-Ouest, tandis que les Berbères nomades sont repoussés vers le sud et vers l'ouest ; certains se sédentarisent, au moins partiellement, en constituant le royaume des Numides de Masinissa et de Jugurtha, qui, après la chute de Carthage (146 avant J.-C.), s'oppose à la pénétration romaine jusqu'en 105 avant J.-C.
1.2. Romanisation et christianisation
Cœur de l'Afrique proconsulaire, la future Tunisie est, sous le contrôle de l'annone, l'un des greniers de Rome en grains, huile et même vin, les cultures progressant sans cesse vers le sud. Romanisé et urbanisé, le pays devient un foyer majeur du christianisme en Afrique romaine du iiie au ve siècle (Tertullien et saint Cyprien à Carthage, saint Augustin, évêque d'Hippone).
1.3. Invasion des Vandales et des Byzantins
Mais les Vandales ariens, envahisseurs venus de l'ouest (429-533), l'ébranlent. Les Byzantins, de 533 (débarquement de Bélisaire) à 698 (perte définitive de Carthage) ne peuvent totalement rétablir sa prospérité, car les Berbères, toujours révoltés, tiennent l'intérieur du pays.
2. L'Ifriqiya musulmane (647/698-1228)
2.1. Kairouan, capitale des Aghlabides puis des Fatimides
Débutant en 647, l'expansion des Arabes vers l'ouest, au début du règne des Omeyyades, aboutit à la fondation, par Uqba ibn Nafi, de Kairouan (670), place d'armes et ville sainte de l'islam au Maghreb (le « Couchant » ou Occident) et, après la chute de Carthage (698), capitale incontestée de l'Ifriqiya musulmane. L'islamisation et même l'arabisation sont rapides et profondes, la romanisation et la christianisation étant restées superficielles dans les zones rurales et surtout steppiques. Intégrés dans le monde musulman, les Berbères conservent pourtant leur originalité, en adhérant au kharidjisme, dont les adeptes se maintiennent longtemps dans certains djebels et à Djerba.
Dépendant tour à tour des califats omeyyade de Damas et abbasside de Bagdad, l'Ifriqiya est gouvernée localement par les Aghlabides, dynastie fondée par l'émir Ibrahim ibn al-Aghlab, puis par les Fatimides, qui créent à Kairouan un califat chiite (910).
2.2. Les Zirides
Lorsqu'en 972 les Fatimides transfèrent leur capitale au Caire, l'Ifriqiya est placée par eux sous l'autorité de la dynastie berbère des Zirides, fondée par Bologgin ibn Ziri, qui rejette leur suzeraineté en 1052.
2.3. Des Hilaliens aux Almohades
Pour se venger, les Fatimides font déferler sur ce pays les nomades Banu Hilal, qui détruisent systématiquement les villes (Kairouan, 1057) et les cultures, afin de recréer une steppe pour leurs troupeaux.
Cette invasion, qui ruine l'Ifriqiya, entraîne sa dislocation en d'innombrables principautés vassalisées par les Hilaliens et favorise l'intervention du roi normand de Sicile, Roger II, qui s'empare de Djerba (1134), et de Mahdia (1148) devenue la résidence princière des Zirides dont le dernier souverain trouvera refuge au près du calife almohade du Maroc, Abd al-Mumin. Ce dernier chasse alors les Normands (1159-1160) et fait de l'Ifriqiya une province administrée par un gouverneur résidant à Tunis : l'Ifriqiya devient la Tunisie.
3. Le royaume hafside de Tunisie (1229-1574)
Les Almohades donnent à la Tunisie un vice-roi, Abu Muhammad Abd al-Wahid ibn Hafs, fondateur de la dynastie hafside. Cette dernière érige la Tunisie en royaume indépendant (1229-1574). Tout en continuant à verser le tribut aux Almohades jusqu'à leur disparition (1269), les Hafsides installent une administration, dirigée surtout par des chrétiens renégats ou par des bourgeois de Tunis, et une armée, formée de mercenaires andalous et arabes ; avec eux, Abu Zakariyya (1229-1249) occupe Alger (1235) et Tlemcen (1242), donnant à son État son maximum d'extension.
Si son fils al-Mustansir (1249-1277) repousse Saint Louis, qui a cru à la possibilité de sa conversion au christianisme (1270), ses descendants perdent le pouvoir à la suite d'une révolte intérieure (1279-1284) et ne le retrouvent qu'avec Abu Hafs (1284-1295). Ébranlée par les attaques des nomades Banu Sulaym et par des crises successorales qui facilitent l'intervention des Marinides du Maroc (1347-1350 et 1357-1358), la Tunisie retrouve son unité et son essor économique sous Abu al-Abbas (1370-1394) et Abu Faris (1394-1434), qui éliminent les Banu Sulaym, et accueillent les Juifs chassés d'Espagne en 1391.
Au xvie siècle, l'intérêt égal, mais opposé, que portent l'Espagne et l'Empire ottoman au détroit de Sicile, entraîne la chute des Hafsides. À la suite de la prise de Tunis par Khayr al-Din Barberousse (1534), le Hafside Hasan (1526-1542) obtient l'aide de Charles Quint, qui occupe sa capitale (1535), mais lui impose sa suzeraineté, ce qui provoque l'intervention des corsaires turcs Dragut et Ali le Renégat, pacha d'Alger, qui s'emparent, le premier, de Gafsa (1556) et de Kairouan (1558), le second, de Tunis (1569). Momentanément réoccupée par don Juan d'Autriche (1573), cette ville est enlevée par les Turcs (1574) ; la Tunisie devient province ottomane.
4. La régence de Tunis jusqu'à l'intervention française (1574-1881)
Après quelques années de régime ottoman, les janissaires confient le pouvoir à un officier subalterne, le dey (1590), secondé par le bey, qui contrôle l'administration et les finances. Le dey est bientôt mis en tutelle par ce dernier.
4.1. L'instauration du beylicat
Des Muradides aux Husaynites
Une première dynastie beylicale, celle des Muradides, est fondée par Murad Ier (1612-1631) ; Murad II (1659-1675) emprisonne le dey (1671), dont la charge est supprimée en 1705 par le fondateur de la deuxième dynastie beylicale, Husayn ibn Ali (1705-1740) ; ce dernier instaure le régime monarchique et fonde la dynastie husaynite qui se maintiendra au pouvoir jusqu'à la proclamation de la République en 1957.
Malgré son despotisme, l'autorité du souverain, héréditaire dès 1710, ne dépasse guère, à l'origine, Tunis et les grandes villes, car l'insoumission des clans rivaux de l'intérieur est entretenue par Alger, Istanbul et par les Européens ; la première de ces puissances lui impose même un tribut (1756), dont elle n'est délivrée que par la seconde (1821). Aussi la conquête de l'intérieur n'est-elle réellement achevée que sous Ali Bey (1759-1782) et Hammuda Bey (1782-1814) qui, affirmant sa quasi indépendance à l'égard de la Porte, marque l'apogée de la dynastie.
Le développement économique de la Tunisie
Au xviie siècle, la Tunisie connaît un redressement après les troubles du siècle précédent avec notamment la mise en valeur de la plaine de la Medjerda et du cap Bon, entreprise par des morisques expulsés d'Espagne en 1609. Les marchés urbains renaissent (reconstruction de Kairouan au xviiie siècle), des ports sont créés. Mais l'activité la plus rentable reste la guerre de course (corsaires). Ce trafic, combattu par les Anglais, n'empêche pas les Français de créer dans les ports des fondouks soumis au régime des capitulations (privilèges commerciaux accordés aux étrangers représentés et défendus par un consul), et dont le premier est celui des Marseillais à Tunis (1577) ; d'ailleurs, la France, alliée à la Régence de Tunis contre celle d'Alger (1685), contrôle son commerce : pêcheries de corail exploitées dès le xvie siècle sur les confins algéro-tunisiens et reprises par la Compagnie d'Afrique (1700), qui fonde des établissements au cap Bon (1781).
4.2. Vers le protectorat français
L'intérêt porté à la Tunisie par la France s'accroît quand celle-ci occupe Alger (1830) et surtout Constantine (1837). Son intervention est facilitée par les difficultés de la Régence du fait de l'interdiction de l'esclavage (1819) et de la course (1824), et de nombreuses épidémies et famines (1784, 1805, 1818). Pour rétablir la situation, les beys Ahmad (1837-1855), Muhammad al-Saduq (1859-1882) font appel à des conseillers étrangers (surtout français), qui réorganisent l'armée (1837), créent des réseaux télégraphiques (1857) et ferroviaires. Certains réformateurs, secondés par les consuls de France et surtout de Grande-Bretagne, s'efforcent de moderniser les institutions : déclaration des droits des Tunisiens (1857), enfin octroi d'une Constitution (1861), très vite inapplicable.
Cette politique onéreuse provoque une grave crise financière. Pour la résoudre, Muhammad al-Saduq recourt à la fiscalité, ce qui provoque la révolte de 1864 ; ayant contracté des emprunts trop coûteux (1863, 1865), l'État tunisien, ruiné, doit accepter la création d'une commission financière internationale anglo-franco-italienne, présidée par un Français (1869) et chargée d'assurer le paiement de sa dette.
Malgré les efforts du ministre des Finances, Khayr al-Din (1873-1877), la Tunisie ne peut échapper à l'intervention européenne. Trois pays ont un intérêt particulier pour s'en emparer : l'Angleterre, qui possède de nombreuses entreprises commerciales et industrielles dans la Régence ; la France, qui contrôle déjà l'Algérie ; et l'Italie, qui installe de nombreux colons sur son territoire et qui assure 80 % de ses échanges. À la suite du congrès de Berlin (1878), la Grande-Bretagne, qui a obtenu Chypre, reconnaît les intérêts particuliers de la France en Tunisie.
La France et l'Italie restent donc seules en compétition. Le rachat de la voie ferrée Tunis-La Goulette par la Compagnie italienne Rubattino (juillet 1880), la concession de la construction des voies ferrées à la Compagnie française des Batignolles (août 1880), enfin la tentative tunisienne de faire contester à la Société marseillaise d'Eugène Pereire la possession du domaine de l'Enfida (100 000 hectares) décident la France à intervenir. Prenant prétexte d'une incursion de Kroumirs en territoire algérien (30-31 mars 1881), Jules Ferry décide (4 avril) une expédition punitive qui contraint le bey à remettre la souveraineté externe de la Tunisie à un ministre résident français, responsable de la diplomatie et de l'armée (traité du Bardo, 12 mai 1881). Une révolte nationaliste, dans le centre et le sud de la Régence (1881-1882), est réprimée par la force ; le résident, Paul Cambon, impose alors au nouveau bey Ali ibn Husayn (1882-1902) la convention de La Marsa (8 juin 1883), qui institue officiellement le protectorat.
5. Le régime de protectorat (1881/1883-1939)
Paul Cambon, qui devient résident général en 1885, place aux côtés du bey et du Premier ministre un secrétaire général chargé de contrôler leurs décisions (1883) ; en outre, des directeurs techniques se substituent aux ministres tunisiens (1882-1890). D'autre part, après une courte période d'administration militaire (1883-1884), la France met en place des contrôleurs civils venus d'Algérie, qui, peu à peu, supplantent localement les caïds. On assiste à une reprise économique : mise en place du réseau ferroviaire ; mise en valeur des phosphates de Gafsa ; plantation des olivettes de Sousse et de Sfax.
5.1. La naissance du nationalisme tunisien
Du Destour au Néo-Destour
L'évolution économique entraîne la formation d'une bourgeoisie réformiste et la montée du nationalisme, qui s'incarne dans le parti des Jeunes Tunisiens d'Ali Bach Hanbach et de Bachir Sfar (1907), et qui aboutit aux émeutes du 7 novembre 1911. Brisé par la répression, il reparaît après 1918. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes proclamé par Thomas Woodrow Wilson (1917), la publication de la Tunisie martyre du cheikh Thaalibi (1920), la création en 1920 d'un parti libéral constitutionnel, le Destour (de l'arabe (dustur : « constitution »), relancent le mouvement nationaliste, mais n'aboutissent qu'aux réformes de 1922 (création de conseils de caïdat et d'un Grand Conseil, purement consultatif).
Atteint par l'arrestation et l'exil des chefs de la Confédération générale des travailleurs tunisiens (CGTT) en 1925, ce mouvement reçoit une impulsion décisive lorsque Habib Bourguiba oriente le Destour dans un sens purement tunisien, libéral et laïque (1933). Dès 1934, la rupture entre le Vieux Destour, plus bourgeois et plus traditionaliste, et le Néo-Destour, plus dynamique, est consommée.
Déportés presque aussitôt dans le Sud, les chefs du Néo-Destour sont libérés en 1936 par le gouvernement Léon Blum, mais les négociations engagées pour instaurer un régime démocratique et constitutionnel sont interrompues par la chute du gouvernement (juin 1937). Des incidents sanglants (juillet 1937) entraînent l'arrestation des chefs du Néo-Destour, la suppression des libertés et la proclamation de l'état de siège (1938).
6. La marche à l'indépendance (1939-1956)
À la faveur de la guerre, Moncef bey (1942-1943) tente de canaliser à son profit le courant nationaliste. Aussi est-il déposé au bénéfice de Lamine bey (al-Amin) au lendemain de la campagne de Tunisie, provoquée par l'occupation de son pays par les Allemands (novembre 1942-mai 1943).
Tandis que les Français profitent de leur victoire pour enlever aux Italiens leur statut privilégié, le Néo-Destour utilise le mécontentement né des ruines de la guerre pour réclamer de nouveau des réformes. Appuyé par la Ligue arabe, Bourguiba participe à la création du Bureau du Maghreb au Caire (1947), favorise la constitution de l'UGTT (Union générale des travailleurs tunisiens de Farhat Hachid, 1948) et obtient quelques concessions (1947) du résident général Jean Mons (1947-1950). S'étant rallié à cette politique (avril 1950), le bey constitue un gouvernement (Chenik [Muhammad Chaniq]) où entre Salah Ben Youssef, secrétaire général du Néo-Destour (août 1950) ; en février 1951, il obtient des réformes partielles. La proclamation par le gouvernement français du « caractère définitif du lien qui […] réunit la France et la Tunisie » (15 décembre 1951) dresse le Néo-Destour contre la France, qui fait alors arrêter Bourguiba (janvier 1952) et destituer le cabinet Chenik (mars).
Le recours au terrorisme amène la France à promettre l'autonomie interne (discours de Pierre Mendès France à Carthage, 31 juillet 1954) et à signer avec le gouvernement Tahar ben Ammar les conventions du 3 juin 1955, qui rendent aux Tunisiens la gestion de leurs affaires intérieures (substitution d'un haut-commissaire au résident général) et créent une union monétaire et douanière entre les deux pays. Au sein du parti destourien, des divergences opposent les conservateurs à ceux qui, avec Salah ben Youssef, estiment les accords insuffisants. Pendant quelques mois règne un climat de guerre civile, qui conduit la France à reconnaître l'indépendance totale de la Tunisie (20 mars 1956).
7. La Tunisie de Bourguiba (1956-1987)

Durant trente ans, Habib Bourguiba va profondément imprégner et modifier la Tunisie. Même ses nombreux détracteurs, en raison de son autoritarisme, conviennent, surtout en raison de ses positions sur la scène internationale, que celui qu'ils appelaient le « combattant suprême » était trop grand pour ce petit pays.
7.1. Modernisation et autoritarisme
Le Code du statut personnel (1956)
La première réalisation de H. Bourguiba – celle qui finalement restera la plus probante – est le Code du statut personnel (13 août 1956), qui entraîne un profond changement de la situation de la femme, sans équivalent dans le monde arabe : interdiction de la polygamie et de la répudiation, accès progressif à l'égalité juridique puisque le Code fut plusieurs fois amendé, en dépit de l'opposition des milieux religieux. À partir de ce Code, et par une politique systématique d'enseignement, H. Bourguiba entreprend de moderniser la Tunisie, déjà davantage pénétrée des idées réformistes que les autres pays du Maghreb depuis la fin du siècle dernier.
Parti unique, première Constitution (1959)
Après la déposition du bey et la proclamation de la République (juillet 1957), il crée un État fort, centralisé et structuré autour du Néo-Destour (érigé en parti unique et devenu par la suite le parti socialiste destourien ou PSD), et de la première Constitution (juin 1959). Il impose un pouvoir sans partage : le principal rival de H. Bourguiba, Salah ben Youssef, est assassiné à Genève en août 1961 et la découverte d'un complot, en décembre 1962, entraîne une dure répression. Les autres partis, dont le parti communiste tunisien (PCT), sont interdits en janvier 1963. Les organisations annexes (syndicats, associations de femmes) sont obligatoirement soudées au parti gouvernemental.
La voie du libéralisme
Bénéficiant d'un statut très particulier parmi les leaders arabes, H. Bourguiba masque constamment les problèmes internes générés par le contrôle d'une société poussée presque malgré elle vers la modernisation : le « combattant suprême » pense en effet que c'est à ce prix que son pays, petit et dépourvu de ressources en quantités suffisantes, peut survivre et s'imposer.
Réélu en 1964 et 1969 (puis en 1974 avant d'être désigné président à vie en 1975), il tombe malade et doit faire face à des dissensions internes permanentes qui l'amènent à composer davantage, notamment avec certains milieux conservateurs et religieux. Ses premiers conflits avec les syndicats (UGTT) et avec les étudiants commencent en 1964-1966. Ceux-ci s'élèvent contre la soumission qu'il impose à tous les corps constitués. Au sein du PSD, les opposants cherchent à s'organiser : ils ne seront autorisés à le faire qu'en 1980 avec la création du Mouvement des démocrates socialistes (MDS). Autre signe de déstabilisation politique, la ville de Gafsa est attaquée en 1980 par un commando armé soutenu par la Libye et l'Algérie.
La politique autoritaire et collectiviste de Ben Salah (1963-1969), secrétaire d'État au Plan et aux Finances, provoque des émeutes en 1969. H. Bourguiba y met brutalement un terme : Ben Salah est arrêté, jugé et en mai 1970 condamné à dix ans de travaux forcés (il s'évadera de prison en 1973). Le pays est dès lors orienté sur la voie du libéralisme, ce qui provoque la montée des troubles sociaux.
Vers le multipartisme
H. Bourguiba, secondé par ses Premiers ministres successifs (Bahi Ladgham, Hedi Nouira, Muhammad Mzali, désignés comme ses successeurs potentiels) fait alterner les phases d'apaisement (pacte social en 1977 et autorisation de la Ligue tunisienne des droits de l'homme ou LTDH, la première dans le monde arabe) et de répression (grève générale en janvier 1978 dégénérant en émeute et réprimée par l'armée).
H. Bourguiba admet au congrès du PSD (mai 1981) la nécessité d'évoluer vers le multipartisme. Le PCT est réautorisé (juillet), ainsi que le MDS et plusieurs petits partis. La même année, le Mouvement de la tendance islamique (MTI), apparu en Tunisie dès après les événements d'Iran (1979), se constitue officiellement dans la recherche d'un compromis politique. Mais les islamistes sont très vite réprimés. En décembre 1983 et janvier 1984 de graves émeutes éclatent à Tunis et dans le sud du pays en raison de la hausse des prix de certaines denrées de première nécessité et des difficultés de la mise à niveau de l'économie.
7.2. Une politique étrangère équilibrée
À partir des années 1960, H. Bourguiba s'impose au plan international dans une conjoncture alors marquée par la guerre d'Algérie. Ainsi, il n'hésite pas à entrer en conflit avec la France qui refuse d'évacuer la base de Bizerte (1961), et offre l'asile aux membres du gouvernement provisoire algérien jusqu'à l'indépendance de leur pays (1962). Il intervient pour calmer les tensions régionales, et rétablit ainsi de bonnes relations avec l'Occident, particulièrement avec la France et les États-Unis, auxquels le pays est solidement amarré, surtout après la fin de l'expérience collectiviste de Ben Salah.
Vis-à-vis du conflit du Proche-Orient, H. Bourguiba a été le premier chef d'État arabe à déclarer, dès 1966 et surtout en 1973, qu'il fallait œuvrer dans le sens d'une fédération israélo-arabe. Cette prise de position modérée lui vaudra une rupture des relations diplomatiques avec l'Égypte (1966), puis avec la Syrie (1968), avant que ses vues soient reconnues comme prémonitoires. Bien que marquée par quelques différends avec le Maroc en raison de la Mauritanie (1961), la politique maghrébine de H. Bourguiba consiste surtout à améliorer les relations de la Tunisie avec l'Algérie par une série d'accords en 1968, 1970 et 1983, dont la délimitation définitive des frontières. La politique de H. Bourguiba rencontre moins de succès avec la Libye, qui, dès le coup d'État de Mouammar Kadhafi (1969), tente de lui imposer des relations étroites qu'il aura du mal à gérer (tentative d'union avortée en 1974).
7.3. Vers la fin du régime
Les troubles sociaux et politiques, liés surtout aux islamistes vis-à-vis desquels H. Bourguiba alterne le chaud et le froid, marquent les dernières années du pouvoir absolu d'un dictateur malade et diminué. Ils sapent également les bases d'une influence qui restera pourtant très forte : la Tunisie accueille, à partir de 1980, la Ligue arabe (qui a rompu avec l'Égypte depuis que celle-ci a reconnu Israël), puis, à partir de 1982 et des événements du Liban, avec l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Un raid de représailles américain contre les Palestiniens en 1985, une grave crise avec l'UGTT et avec les islamistes (trois dirigeants sont condamnés à mort et exécutés en juillet 1986), un attentat contre des établissements touristiques de Monastir en août 1987, rendent très difficiles les derniers mois du « combattant suprême ».
Chef des services secrets tunisiens, ministre de l'Intérieur depuis 1984, puis appelé au poste de Premier ministre pour mater les islamistes en octobre 1987, le général Zine el-Abidine Ben Ali destitue, le 7 novembre 1987, H. Bourguiba, âgé de 84 ans et mis en résidence surveillée à Monastir (où il meurt en avril 2000).
8. L'« ère nouvelle » de Ben Ali (1987-2011)
8.1. Premières mesures
Ce coup d'État « constitutionnel et sans violence » bénéficie d'un très large consensus, d'autant que le nouveau maître de la Tunisie s'attire d'emblée la sympathie générale en pratiquant l'apaisement, y compris avec les islamistes, dont 600 cadres sont libérés. Ben Ali reconstitue et rajeunit le PSD, rebaptisé en février 1988 Rassemblement constitutionnel démocrate (RCD), supprime la présidence à vie (juillet) et se réapproprie le domaine religieux par le contrôle des mosquées.
Sur le plan diplomatique, il rétablit les relations avec la Libye en décembre 1987 et avec l'Égypte l'année suivante. Sur le plan intérieur, il accentue le libéralisme économique, absorbe des élites autrefois laissées pour compte et signe, le 7 novembre 1988, un pacte national avec toutes les formations politiques, y compris le MTI. Mais ces dispositions apaisantes sont de courte durée : à partir de 1989, mais surtout de 1990-1991, le président Ben Ali engage une lutte sans merci contre les islamistes, puis met au pas les démocrates qui avaient cru pouvoir s'épanouir sous son égide.
8.2. La personalisation du pouvoir
Élu président de la République en avril 1989, puis réélu en 1994 avec 99,99 % des voix des 95 % de votants, Ben Ali va tenir, comme son prédécesseur, la Tunisie d'une main de fer et même se lancer dans une « dérive sécuritaire » amplement dénoncée à l'extérieur, au point que les Tunisiens en viendront à regretter le régime de Bourguiba.
Modernisation
Comme celui-ci, Ben Ali va pourtant poursuivre une œuvre drastique de modernisation : les avantages politiques et juridiques accordés aux organisations féminines, autorisées dès 1988, sont renforcés en 1993-1994 au point que le statut de la femme tunisienne est désormais, sauf pour l'héritage, très proche du statut européen. Les programmes scolaires sont modifiés et débarrassés des influences islamiques introduites sous M. Mzali. L'administration est simplifiée pour faciliter l'ouverture économique, saluée unanimement par la communauté internationale. L'industrie de transformation et de sous-traitance se développe.
Mise sous contrôle de la société
Mais, parallèlement, la vie sociale et politique, fortement contrôlée, devient vite atone : la presse nationale est muselée, la presse étrangère est interdite en 1994, et les opposants sont sévèrement poursuivis, y compris à l'extérieur du pays. Dès 1989, le MTI, qui voulait obtenir sa légalisation sous le nom de parti de la Nahda, est mis au ban de la vie politique. Il n'en gagne pas moins, sous le vocable « indépendant », 15 à 30 % des sièges lors des élections communales de juin 1990, et entretient des troubles universitaires en 1991-1992, ce qui signe son arrêt de mort : un complot est découvert, 800 cadres sont arrêtés ou exilés et 300 condamnations sont prononcées lors des procès de juillet et août 1992 qui sonnent le glas d'un mouvement dont le danger est exacerbé par la proximité de l'Algérie.
Les démocrates, marginalisés lors des élections de 1989 et de 1994-1995, dénoncent la fâcheuse bipolarisation de la vie politique, mais doivent également se plier aux diktats du régime. Même la LTDH est mise au pas sous le couvert d'une nouvelle loi sur les associations, entre 1992 et 1994. Le RCD et ses affidés – comités de quartiers et indicateurs – retrouve sa totale prééminence sur tous les rouages de la société et de la vie politique tunisiennes tandis que le président et ses proches (notamment son épouse et sa famille, le « clan des Trabelsi ») ne cessent d'accaparer les richesses du pays. Le consensus initial s'est effrité.
8.3. Une politique étrangère tournée vers l'Europe
Ben Ali sait gérer au mieux la grave crise qui aboutit à la guerre du Golfe en 1991 malgré le désarroi d'une population fortement pro-irakienne, alors que trois leaders palestiniens sont assassinés à Tunis en août 1990. Il s'investit également dans la coopération entre les pays d'Afrique du Nord et tente constamment, mais en vain, de relancer l'Union du Maghreb arabe (UMA, née en février 1989), handicapée par les différends algéro-marocains et par la guerre civile algérienne. Il tente aussi de jouer un rôle conciliateur dans l'Orient arabe, mais doit abandonner les relations nouées avec Tel-Aviv entre 1994 et 1997, en raison des blocages du processus de paix. Devant tenir compte d'un environnement international particulièrement défavorable (guerre civile en Algérie, embargo contre la Libye), Ben Ali fait alors prévaloir ses préoccupations sécuritaires dans nombre d'accords.
Il mène une politique visant à renforcer les liens de son pays avec l'Europe. Ainsi la Tunisie est le premier pays maghrébin à conclure un accord avec l'Union européenne (dès 1996). Ben Ali améliore les relations non seulement avec la France, mais aussi avec l'Espagne et l'Italie, ainsi qu'avec les États-Unis, tout en profitant habilement de la fermeture des frontières libyennes. Il est également très actif dans la politique euro-méditerranéenne mise en place après la conférence de Barcelone en novembre 1995. Confrontée à l'abrogation de l'Accord multifibres le 1er janvier 2005 qui lui garantissait depuis 1973 l'exportation d'un certain quota de sa production de textiles et vêtements vers l'Europe, et par conséquent à la forte concurrence chinoise, la Tunisie est le premier pays de la rive sud de la Méditerranée à intégrer la zone de libre-échange pour les produits industriels avec l'Union européenne trois ans plus tard, le 1er janvier 2008. Soutenu de longue date par les présidents français, Ben Ali est l'un des plus fervents partisans de l'Union pour la Méditerranée proposée par Nicolas Sarkozy (sommet de Paris, 13 juillet 2008).
8.4. Le raidissement du régime
Malgré ses efforts économiques et diplomatiques, le président tunisien se heurte (comme lors de sa visite officielle en France en juin 1997), du fait des dérives sécuritaires de son régime de plus en plus mal comprises et condamnées, aux critiques de toutes les organisations de défense de droits de l'homme. Fort d'un large soutien populaire, tenant solidement en main son pays, ayant vaincu les islamistes et mis au pas les tenants d'un petit parti de gauche, le parti ouvrier et communiste tunisien (POCT), il perpétue pourtant la répression systématique de tous les opposants potentiels. En octobre 1995, c'est Mohammed Moada, le secrétaire général du MDS, le plus influent des partis de l'opposition, qui est arrêté (condamné en février 1996). En 1997, un nouveau Code pénal, extrêmement rigoureux, est voté pour réprimer tous ceux qui désapprouveraient, oralement, la politique tunisienne. Les défenseurs des droits de l'homme subissent un harcèlement quotidien. Selon Amnesty International 6 000 à 8 000 Tunisiens sont emprisonnés (20 décèdent en prison), toutes les organisations politiques et sociales, complètement nivelées, les voix démocrates, définitivement anéanties, les élites, déstabilisées par des changements de gouvernement bisannuels.
Certes, comme il l'avait annoncé dès novembre 1990, Ben Ali pense que « le climat social et les performances économiques sont plus importants que les jeux politiques ». Mais certains de ses partenaires extérieurs relèvent que dans la phase nouvelle et difficile de la libéralisation économique et de la mise à niveau des industries due aux accords européens et internationaux, cet « équilibre » risque d'être remis en question. Les atteintes au droit de la presse sont régulièrement dénoncées : en avril 2000, la grève de la faim du journaliste, écrivain et opposant tunisien Taoufik Ben Brik rencontre un large écho dans la presse française ; le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), organisé par le pouvoir à Tunis en novembre 2005 se tient sous haute surveillance policière pendant que huit personnalités poursuivent une grève de la faim illimitée pour protester contre ces atteintes à la liberté d'expression. Alors que l’opposition légale tente de se mobiliser et demande notamment une loi d'amnistie pour les « prisonniers politiques », de nouvelles condamnations sont prononcées contre des journalistes en 2010.
8.5. L'instauration de la présidence à vie
En dépit de la présence, pour la première fois, de deux adversaires, la réélection de Ben Ali en octobre 1999 se déroule sans surprise (plus de 99 % des voix). Mais, grâce à une nouvelle loi destinée à réaffirmer le pluralisme, l'opposition obtient 20 % des sièges au Parlement malgré un mauvais résultat aux législatives. En mars 2001 est rendu public le « manifeste des démocrates progressistes » ainsi qu'une pétition « pour une citoyenneté souveraine ». L'ancien président de la LTDH, Mohamed Charfi, rejoint officiellement l'opposition qui semble prendre de l'ampleur. Elle ne peut pourtant rien contre ce qu'elle considère comme « un coup d'État constitutionnel » ou l'instauration de la présidence à vie.
En effet, en mai 2002, Ben Ali demande au peuple tunisien d'approuver une réforme de la Constitution, destinée à lui permettre de solliciter de nouveaux mandats présidentiels puisque leur nombre sera désormais illimité et que l'âge de l'éligibilité du président est repoussé de 70 à 75 ans, tout en lui garantissant une immunité judiciaire pendant et après ses fonctions. La teneur de ce texte et le résultat quelque peu « suspect » (99,61 % de « oui » ) du référendum montrent bien que les autorités tunisiennes entendent, pour l'heure, rester sourdes aux demandes internes et externes de démocratisation du régime. Le 24 octobre 2004, le président Ben Ali est donc « réélu » pour un quatrième mandat de cinq ans avec 94,4 % des voix.
Aux élections législatives, le RCD remporte la totalité des 152 sièges attribués au scrutin majoritaire. Le Mouvement des démocrates socialistes (MDS), le parti de l'Unité populaire (PUP), l'Union démocratique unioniste (UDU), le parti Ettajdid (ex-parti communiste) et le parti social libéral (PSL) se répartissent les 37 autres sièges attribués à la proportionnelle. En 2005 est élue pour la première fois la nouvelle chambre haute du Parlement tunisien, la Chambre des conseillers, introduite par la réforme de la Constitution de 2002 et composée de 126 membres élus par de grands électeurs ou nommés par le président, pour six ans.
Au cours de l'été 2008, faisant fi des critiques de ses opposants réclamant une alternance du pouvoir, le président Ben Ali annonce qu'il sera candidat pour un cinquième mandat en 2009 : à l'issue d'un scrutin sans surprise marqué par un taux de participation global de plus de 89 % des électeurs, le président Ben Ali est réélu avec 89,62 % des suffrages, tandis que le RCD rafle 161 sièges sur 214, six partis d'opposition (dont un nouveau parti des Verts pour le progrès, PVP) se partageant les 53 sièges restants.
8.6. La révolution tunisienne
Un mouvement de révolte contre le vie chère et contre le chômage
Ce qui aurait pu n’être qu’un tragique énième fait divers – l’immolation par le feu d’un vendeur ambulant de Sidi Bouzid, le 17 décembre 2010, pour protester contre la confiscation de sa marchandise par la police – est suivi d’un mouvement social et politique d'une ampleur sans précédent. Le mouvement de révolte contre la vie chère et contre le chômage – qui frappe l'ensemble de la jeunesse tunisienne, qu’elle soit défavorisée ou qualifiée – et dont souffrent plus particulièrement les régions du centre de la Tunisie laissées à l’écart du développement économique, s’intensifie en dehors de toute force politique organisée ; il s'étend en premier lieu à d’autres villes de l’intérieur du pays comme Meknassi, Thala, Kasserine ou Regueb avant de gagner Tunis à partir du 11 janvier 2011, alors que l’UGTT s’est jointe au mouvement.
Le pouvoir réagit dans un premier temps par la force en mobilisant son appareil policier qui, malgré les blessés et les morts – dont le nombre est estimé à plusieurs dizaines –, ne parvient pas à faire plier les manifestants ; ceux-ci – étudiants, chômeurs mais aussi fonctionnaires, avocats et médecins –, encouragés par les révélations récentes de WikiLeaks sur l'état de la Tunisie et ayant eux-mêmes appris à déjouer la censure sur Internet, parviennent à surmonter leur crainte de la répression et réclament une rupture politique totale.
Le départ du président Ben Ali
Le 14 janvier, au lendemain de l’annonce de concessions présidentielles tardives – création de 300 000 emplois, renvoi du ministre de l’Intérieur, renoncement à un nouveau mandat en 2014, rétablissement de la liberté de la presse, dissolution du gouvernement et organisation d’élections anticipées –, la nouvelle du départ précipité du chef de l’État est révélée par le Premier ministre M. Ghannouchi. Le président de la Chambre des députés, Fouad Mebazaa, assure par intérim les fonctions de chef de l'État (réfugié en Arabie saoudite). Le couvre-feu est maintenu et l’armée – restée à l’écart et dont l’état-major a refusé d’intervenir contre les manifestants – est déployée. Au côté de celle-ci, la population s’organise pour empêcher les pillages et les exactions commises par des milices restées fidèles au président déchu.
Un gouvernement provisoire d'« union nationale »
Le 17 janvier, un gouvernement provisoire « d’union nationale est formé sous la direction de M. Ghannouchi : les dirigeants de trois partis de l’opposition « légale » – parti démocrate progressiste, Mouvement Ettajdid et Forum démocratique pour le travail et les libertés – en font partie au côté de personnalités indépendantes issues de la société civile et de l’UGTT. Mais plusieurs ministres (RCD) de l’équipe sortante sont également reconduits aux postes-clés ce qui suscite aussitôt l’hostilité des manifestants et la démission de plusieurs ministres dont ceux représentant le syndicat. Parallèlement, une série de grandes décisions est annoncée, dont l’organisation d’élections présidentielle et législatives transparentes et démocratiques dans les six mois, la libération prochaine de tous les prisonniers politiques, la légalisation des partis et ONG interdits, la création d’une commission chargée d’enquêter sur les malversations et la corruption.
L'éviction de tous les représentants du régime de Ben Ali
Craignant que cette révolution lui soit confisquée par les tenants d’une politique de compromis, le mouvement maintient sa pression sur le pouvoir afin qu’en soient expurgés tous les représentants de l’ancien régime. Après un premier remaniement gouvernemental, les manifestants obtiennent le départ de M. Ghannouchi (27 février), remplacé par Béji Caïd Essebsi, plusieurs fois ministre sous la présidence d'Habib Bourguiba. À la suite d’un nouveau remaniement ministériel le 7 mars, plus aucun ministre de l’ère Ben Ali ne figure désormais dans le gouvernement. Parallèlement, le démantèlement de l’ancien appareil de sécurité de l’État est annoncé. Dans l’attente de la convocation d’une Assemblée constituante, s’ouvre ainsi une transition aussi inattendue qu’incertaine.
9. La Tunisie démocratique après Ben Ali (2011-)
La révolution ouvre un nouvel espace pour l’expression d’une multitude de sensibilités idéologiques donnant naissance à un paysage politique extrêmement pluraliste, mais en même temps profondément éclaté. Des jeunes internautes, en première ligne dans le mouvement révolutionnaire, aux anciens routiers de l’opposition « légale » au régime de Ben Ali, des milliers d’hommes et de femmes veulent apporter leur contribution à la construction de la nouvelle Tunisie. Dans ce foisonnement, c’est toutefois le parti islamiste Ennahda (« Renaissance »), fondé à la fin des années 1970 et resté relativement à l’écart de la mobilisation, son chef historique Rached Ghannouchi n’étant rentré d’exil que le 30 janvier, qui tire le mieux son épingle du jeu.
9.1. L’émergence d’un nouveau système politique
Neuf mois après la chute de Ben Ali, s’ouvre la campagne électorale en vue de l’élection de l’assemblée constituante. Plus de 1 500 listes y sont présentées – dont 830 par des partis, 655 par des candidats indépendants et 34 par des coalitions –, avec, dans certains cas, près d’une centaine pour une seule circonscription. Alors que le pays s’ouvre pour la première fois de son histoire à la démocratie, cette profusion ne peut qu’engendrer une certaine confusion dont profitent les partis les plus connus ou médiatisés.
Dans une société atomisée par l’autoritarisme et l’absence de libertés, le clivage religieux retrouve toute sa force. La division des forces démocratiques « laïques » qui se présentent en ordre dispersé favorise l’islamisme politique qui a conservé ses réseaux informels et sa capacité de mobilisation malgré la répression dont il a été la principale victime à partir des années 1990.
À l’issue des élections du 23 octobre auxquelles participent 54,1 % des électeurs, le parti Ennahda vient ainsi en tête du scrutin avec plus de 41 % des suffrages et 89 sièges sur 217 devant le Congrès pour la République (créé en 2001 et présidé par Moncef Marzouki) qui obtient 29 sièges. La Pétition populaire pour la liberté, la justice et le développement, constituée par Hechmi Hamdi, un homme d’affaires basé à Londres, ancien membre d’Ennahda puis rallié au RCD, ayant mené sa campagne à distance par l’intermédiaire de sa chaîne télévisée, crée la surprise en obtenant 26 sièges. Elle arrive ainsi en troisième position devant le Forum démocratique pour le travail et les libertés (Ettakatol, créé en 1994 par Mustapha Ben Jaafar issu tout comme Moncef Marzouki de la LTDH (20 sièges), et le parti démocrate progressiste (16 sièges), fondé en 1983 et dirigé par Ahmed Najib Chebbi et Maya Jribi. Le Pôle démocratique moderniste, coalition de partis de gauche et d’organisations de la société civile dont le Mouvement Ettajdid, lancée en mai 2011, n’arrive qu’en sixième position avec 5 représentants. 21 autres listes (dont 16 avec un seul élu) se répartissent les 32 sièges restants.
Le parti Ennahda, qui ne dispose pas de la majorité absolue et doit donc négocier avec ses principaux rivaux pour former une coalition gouvernementale, s’efforce de dissiper – par la voix notamment de son élue « non voilée » de Tunis (et seule femme de sa direction) Souad Abdelrahim –, les craintes exprimées en Tunisie comme à l’étranger en affichant un islamisme « modéré » et en s’engageant à respecter les principes d’une démocratie « civile ».
Les partis Ennahda, Ettakatol et le Congrès pour la République étant parvenus à un accord sur le partage du pouvoir, Moncef Marzouki est élu président de la République le 12 décembre par l’Assemblée constituante dont la présidence a été confiée à M. Ben Jaafar. Hamadi Jebali, secrétaire général d’Ennahda, prend la tête d’un gouvernement de coalition – de 41 membres dont 30 ministres – dans lequel son parti détient une vingtaine de postes dont les ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères. Le CPR en obtient 6 (les ministères de l’Emploi, de la Réforme administrative ainsi que celui de la Femme notamment) et Ettakatol 5, dont les Affaires sociales, l’Éducation, la lutte contre la corruption et la réforme de la police. Une dizaine de personnalités indépendantes, parmi lesquels le ministre des Finances, font également partie de ce gouvernement qui après avoir obtenu la confiance de l’Assemblée constituante par 154 voix pour et 11 abstentions, entre en fonctions le 26 décembre après l’adoption d’une loi sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics en remplacement de la Constitution de 1959 et dans l’attente du nouveau texte constitutionnel.
9.2. L’épreuve du pouvoir et les tensions internes
En juillet 2012, après avoir renoncé en mars à inscrire la charia dans le projet de Constitution, le parti Ennahda tient son premier congrès depuis son accession au pouvoir : son orientation « centriste et modérée » semble se confirmer et son chef, R. Ghannouchi, est reconduit dans ses fonctions.
Mais les relations avec les partis politiques laïcs et une partie de la population tunisienne se tendent. Le projet de loi visant à réprimer les « atteintes au sacré », le projet d’article constitutionnel sur la « complémentarité » entre l’homme et la femme (à la place du mot « égalité »), ou encore les opérations musclées de groupes salafistes contre la liberté d’expression et une série d’incendies criminels par ces derniers de plusieurs mausolées de saints musulmans, constituent, parmi d'autres, des signes qui inquiètent l’opposition libérale et laïque regroupée autour du « Front populaire », du parti républicain, de la Voie démocrate et de Nidaa Tounes (Appel de la Tunisie). Lancé par l’ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi mais accusé par Ennahda d’être la résurgence de l’ancien RCD, Nidaa Tounes tente de fédérer les oppositions de droite et de gauche qui restent toutefois encore éparpillées.
Par ailleurs, la reprise économique fragile (compromise par la récession au sein de l’UE, principal partenaire commercial du pays) et accompagnée de tensions inflationnistes, ne permet guère d’améliorer la situation sociale, en particulier dans les régions défavorisées du centre, foyer originel de la révolution tunisienne. C’est ainsi que d’importantes manifestations à l’initiative de l’UGTT sont suivies de violents affrontements avec les forces de l’ordre à Siliana en novembre ; une situation explosive désamorcée par le gouvernement et le syndicat qui le menaçait d’une grève générale après l’attaque de son siège, à Tunis, perpétrée par des miliciens proches du parti Ennahda.
À ces tensions s’ajoutent des tiraillements au sein de la « troïka » au pouvoir et les lenteurs dans l’élaboration de la nouvelle Constitution, dont le projet aurait dû être prêt un an après l’élection de l’Assemblée constituante. La date butoir du 23 octobre n’est cependant pas respectée, aucun compromis ne se dégageant sur la nature du régime, en particulier concernant les prérogatives respectives du président et du Parlement. Le 17 décembre, c’est sans euphorie que la Tunisie célèbre le deuxième anniversaire du début de sa révolution.
Le climat de défiance et de violence culmine avec l’assassinat, le 6 février 2013, de l’opposant de gauche Chokri Belaïd (parti des Patriotes démocrates, membre du Front populaire). Le fossé entre islamistes et laïcs se creuse alors dans le pays. Après avoir proposé la formation d’un nouveau cabinet « apolitique » mais essuyé le refus de la direction d’Ennahda divisée entre pragmatiques et radicaux, le Premier ministre H. Jebali démissionne et le ministre de l’Intérieur Ali Larayedh lui succède. Après des discussions infructueuses avec des représentants politiques extérieurs à la « troïka », la même coalition est reconduite. Concession notable du parti islamiste, les ministères régaliens sont confiés à des personnalités indépendantes. Mais l’assassinat en juillet du député de l’opposition Mohamed Brahmi exacerbe encore les tensions.
L’opposition exige du parti Ennahda qu’il quitte le pouvoir, l’accusant d’incompétence et d’être indirectement responsable de la montée de la violence islamiste, en dépit de l’intervention des forces de l’ordre contre la mouvance salafiste Ansar al-Charia impliquée dans ces attentats. À l’issue de plusieurs mois de crise, un difficile dialogue national encadré par l’UGTT s’ouvre en octobre, tandis que l’état d’urgence – adopté en janvier 2011 et plusieurs fois prolongé – est reconduit pour huit mois afin de faire face à la recrudescence des attaques attribuées à des groupes armés.
Tirant les leçons de l’évolution de la situation en Égypte et voulant éviter une confrontation similaire entre camps islamiste et laïc en Tunisie, le parti Ennahda accepte finalement de laisser les rênes du gouvernement à Mehdi Jomaa, ministre de l’Industrie et présenté comme sans étiquette politique. Parallèlement, ses députés font d’importantes concessions à l’opposition laïque lors de la discussion du projet de Constitution : la référence à la charia est ainsi définitivement abandonnée, tandis que l’égalité entre hommes et femmes (dont les droits sont garantis) est acceptée.
Le 26 janvier 2014, le texte est enfin adopté à une très large majorité de 200 voix pour. Un nouveau gouvernement, composé de personnalités indépendantes des partis, est formé dans l’attente des prochaines élections.
9.3. Les élections d’octobre-décembre 2014
Les élections de 2014 marquent un tournant depuis le déclenchement de la révolution de janvier-février 2011, alors que le chômage et la dégradation de la situation sécuritaire figurent parmi les principales préoccupations des Tunisiens.
Si la scène politique tunisienne reste très fragmentée, l’effort de réorganisation et d’unification de l’opposition conduit à la victoire relative de Nidaa Tounes de Béji Caïd Essebsi, qui, avec 86 élus, arrive en tête des élections législatives du 26 octobre devant le parti Ennahda (69 sièges). Il est suivi, notamment, de l’Union patriotique libre (issue de la fusion de divers partis libéraux, 16 députés), du Front populaire (coalition de partis de gauche, 15 sièges) d’Afek Tounes (se définissant « libéral-social », 8 sièges) et du Congrès pour la République du président sortant, déjà très affaibli par plusieurs défections et qui est réduit à 4 sièges.
Le 21 décembre, au second tour de scrutin, B. C. Essebsi remporte la première élection présidentielle au suffrage universel avec 55,68 % des suffrages face au président sortant M. Marzouki, qui, recevant l’appui tacite du parti islamiste, obtient 44,32 % des voix. Le taux de participation atteint 59 % en moyenne.
Âgé de 88 ans, engagé dans la vie politique tunisienne depuis 1956 comme conseiller de H. Bourguiba dont il fut notamment le ministre des Affaires étrangères, l’ancien chef du gouvernement provisoire formé en février 2011 l’emporte ainsi largement malgré ses liens passés indirects avec le régime de Ben Ali.
Le 5 janvier 2015, Habib Essid, ancien ministre de l’Intérieur en 2011, est désigné comme Premier ministre. Un gouvernement de coalition dominé par Nidaa Tounes mais auquel participent également des représentants d’Ennahda, de l'Union patriotique libre et d’Afek Tounes, est investi en février par une majorité de 166 députés sur 204 présents.
9.4. Les défis du nouveau gouvernement
Ce gouvernement doit faire face à une situation économique et sociale d’autant plus précaire que le tourisme est directement visé par l’attaque terroriste, le 18 mars, dans le musée national du Bardo à Tunis, revendiquée par Daech (État islamique). S’y ajoute, en juin, un nouvel attentat meurtrier sur une plage de la station balnéaire de Port El-Kantaoui, près de Sousse. La violence islamiste exerce ainsi sa menace sur un pays dont sont originaires de nombreux djihadistes étrangers engagés dans les rangs de l’EI en Syrie et qui est séparé de la Libye par une frontière poreuse. Outre le renforcement du contrôle de cette dernière, un ensemble de mesures sécuritaires est adopté et l’état d’urgence réinstauré à la suite d’un nouvel attentat en novembre ciblant cette fois la garde présidentielle.
Mais l’unité nationale recherchée semble compromise par les divisions au sein du parti Nidaa Tounes, qui provoquent sa scission en décembre, en dépit de la mue officielle d’Ennahda qui annonce, lors de son 10e congrès en mai 2016, la séparation de ses activités politiques et religieuses. « Sortir de l’islam politique pour entrer dans la démocratie musulmane », tel est le nouveau slogan proposé par R. Ghannouchi.
Cette transformation de l’échiquier politique – qui comprend également le lancement d’une nouvelle formation (Al-Irada, la Volonté) par l’ex-président M. Marzouki – advient alors que la lutte contre la corruption marque le pas. À cet égard, un projet de loi sur la réconciliation économique et financière, visant à accélérer les procédures judiciaires pesant sur les hommes d’affaires et les fonctionnaires afin de rétablir un climat favorable à l’investissement, suscite les protestations de l’opposition.
C’est dans ce contexte que, fragilisé par la lenteur des réformes et des résultats économiques décevants, le Premier ministre H. Essid doit démissionner en juillet 2016 sous la pression du chef de l’État et à la suite d’un vote de défiance d'une très large majorité de députés. Youssef Chahed, ministre des Affaires locales dans l’équipe sortante, forme un nouveau gouvernement d’« union nationale » qui obtient la confiance du parlement le 26 août par 167 députés sur 194 présents.