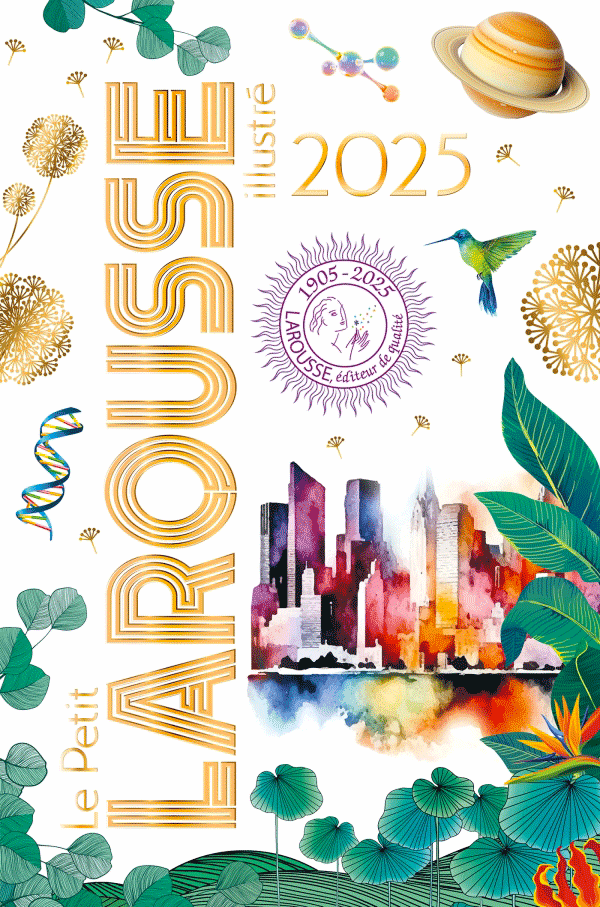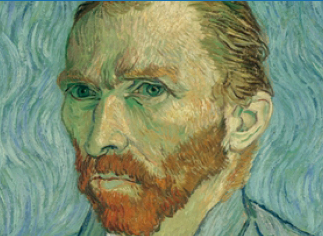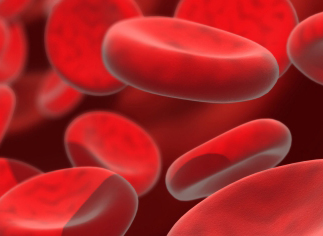Grèce : vie politique depuis 1974
1. Le rétablissement et l'ancrage de la démocratie
1.1. La crise de Chypre
Le 15 juillet 1974, la junte militaire organise un coup d'État contre le président de la République de Chypre, l'archevêque Makários, après que celui-ci a exigé le retrait des officiers grecs encadrant la garde nationale chypriote. La Turquie intervient alors militairement et occupe le nord de l'île. Face à cette situation désastreuse, les militaires sont contraints d'abandonner le pouvoir. Le 29 juillet, un gouvernement provisoire est constitué par Konstandínos Karamanlís, de retour d'exil.
1.2. Le retour à un pouvoir civil
Après le rétablissement de la Constitution de 1952 et des libertés fondamentales, les principales étapes du retour à la démocratie sont les élections du 17 novembre 1974, qui consacrent la victoire de la Nouvelle Démocratie, dirigée par Karamanlís (54 % des voix), puis le référendum du 8 décembre, par lequel 69 % des électeurs se prononcent en faveur de la république. Enfin, le 7 juin 1975, une nouvelle Constitution est adoptée par le Parlement.
1.3. Les maux de la vie politique grecque
Bipartisme
À partir de cette date, la vie politique est dominée par la Nouvelle Démocratie (ND) et par le parti socialiste panhellénique (Pasok).
En 1977, ND remporte les élections législatives malgré une nette progression du Pasok (25 %). Konstandínos Karamanlís est élu président de la République (mai 1980) Gheórghios Rállis le remplace au poste de Premier ministre. Le Pasok remporte les élections législatives de 1981 (Andhréas Papandhréou est chargé de constituer un gouvernement), et celles de 1985 (Khrístos Sárdzetakis est élu à la présidence de la République).
Les élections de mai et novembre 1989 n'ayant pas permis de dégager une majorité parlementaire, de nouvelles élections, organisées en avril 1990, se soldent par une courte victoire de ND ; Konstandínos Mitsotákis devient Premier ministre et Konstandínos Karamanlís retrouve la présidence de la République.
Les élections d'octobre 1993 entraînent une nouvelle alternance et le retour d'Andhréas Papandhréou à la tête du gouvernement. En mars 1995, le candidat socialiste Kostís Stefanópoulos est élu président de la République. Peu après, en janvier 1996, Andhréas Papandhréou, gravement malade, est remplacé par Kóstas Simitis.
Le Pasok remporte les élections législatives de 1996 mais se maintient de justesse au pouvoir lors du renouvellement anticipé du Parlement en mars 2000. Quelques semaines auparavant, Kostís Stefanópoulos a été réélu à la présidence de la République pour un nouveau mandat de cinq ans. Largement réélu à la présidence du Pasok en octobre 2001, Kóstas Simitis forme un gouvernement, composé de membres du Pasok.
En dehors de ces deux principaux partis, le paysage politique grec est constitué par des petites formations centristes (dont l'Union du centre démocratique, qui recueille 20 % des voix en 1974, mais sera progressivement évincée par la ND et le Pasok), les deux partis communistes (« orthodoxe » et « eurocommuniste », qui recueillent environ 10 % des voix) et par des petits partis de droite et d'extrême droite.
Clientélisme, scandales, discrédit de la classe politique
Le Pasok et ND restent cependant prisonniers de discours populistes et de pratiques clientélistes, et renoncent à moderniser une fonction publique pléthorique qui nourrit leur clientèle respective, mais pèse lourdement sur l'économie. Cette réalité se traduit, en 1989, par une série de scandales financiers impliquant d'importants responsables du Pasok, et suscite un discrédit général de la classe politique.
De même, l'introduction du mariage civil en 1981 n'empêche pas l'Église orthodoxe de conserver une forte influence sur la vie sociale, politique et culturelle, au mépris parfois de certaines libertés fondamentales (la mention de l'appartenance religieuse sur les cartes d'identité est obligatoire jusqu'en 1998).
Enfin, la retraite politique de Konstandínos Karamanlís en 1995 suivie du décès d'Andhréas Papandhréou en 1996 privent la Grèce des deux grands ténors qui ont assuré le retour à la démocratie, et ouvre une nouvelle période de la vie politique grecque, davantage centrée sur les questions économiques et européennes.
1.4. Une politique étrangère dans un entre-deux (1980-2001)
Le contentieux gréco-turc
Après 1974, les relations avec la Turquie constituent la préoccupation majeure de la Grèce. Au conflit à propos de Chypre s'ajoutent bientôt d'autres contentieux concernant les eaux territoriales et l'espace aérien de la mer Égée, ainsi que la minorité turque de Thrace occidentale. La question des rapports gréco-turcs déborde alors sur d'autres volets de la politique étrangère grecque.
Mécontente de l'attitude des États-Unis face à la crise chypriote de 1974, la Grèce quitte les structures militaires de l'OTAN et esquisse un rapprochement avec l'URSS et les pays non alignés. En 1981, toutefois, Andhréas Papandhréou renonce vite au référendum sur l'OTAN, annoncé pendant la campagne électorale, et la Grèce réintègre les structures militaires de l'Alliance grâce à une levée du veto turc. La diplomatie grecque, quant à elle, s'oppose alors à toute forme de rapprochement entre la Communauté économique européenne (CEE) et la Turquie.
Une intégration difficile à l'Europe
En janvier 1981, la Grèce devient le dixième État membre de la CEE. Sur le plan politique, cette adhésion consolide son retour à la démocratie et lui donne une position de force dans ses rapports avec la Turquie. Sur le plan économique, elle lui ouvre les immenses marchés de l'Europe occidentale et lui permet de bénéficier d'importantes aides européennes au développement régional.
Entre 1990 et 1995, la fin du communisme et l'éclatement de la Yougoslavie suscitent en Grèce une importante vague de nationalisme. Athènes s'oppose à la constitution d'un État indépendant portant le nom de Macédoine et, en février 1994, instaure contre cette République un embargo commercial considéré comme illégal par la Commission européenne. De même, en réponse à l'arrestation de plusieurs membres de la minorité grecque en Albanie, les autorités grecques expulsent pendant l'été 1994 plusieurs centaines de milliers de travailleurs clandestins albanais.
Soutenant la Serbie (de confession orthodoxe) dans ses conflits avec la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, la Grèce se brouille non seulement avec la plupart de ses voisins balkaniques, mais aussi avec les institutions européennes. Alors qu'elle compte parmi les pays qui ont le plus bénéficié des fonds européens, une forte défiance envers l'Europe, accusée de vouloir attenter aux « valeurs nationales », perdure dans certains secteurs de la société.
Ces critiques viennent aussi bien de la mouvance communiste, très eurosceptique, que des courants liés à l'Église orthodoxe. Bruxelles a ainsi dû longtemps batailler pour obliger Athènes à ôter la mention de l'appartenance confessionnelle sur les cartes d'identité. L'archevêque d'Athènes, Monseigneur Christodoulos, chef de l'Église territoriale de Grèce (décédé en janvier 2008), s'était ainsi fait le champion des « valeurs orthodoxes », croisant le fer avec les institutions européennes sur nombre de questions sociales ou morales (dépénalisation de l'homosexualité, par exemple).
Autre sujet potentiel de tension entre Athènes et les institutions européennes, la Grèce n'a pas signé les documents du Conseil de l'Europe sur les droits des minorités nationales. Officiellement, la Grèce ne reconnaît qu'une communauté « musulmane » en Thrace, regroupant des Turcs et des Pomaks (Slaves musulmans), dont les droits sont garantis par le traité de Lausanne, signé en 1923 avec la Turquie. En revanche, les Slaves macédoniens, les Roms ou les Aroumains ne bénéficient d'aucune espèce de reconnaissance officielle.
Une volonté de stabilisation
Revenant cependant à plus de modération à partir de 1996, la Grèce décide de normaliser ses relations avec la Macédoine et l'Albanie, et adopte une attitude plus constructive dans la résolution des crises régionales (participation à l'opération internationale « Alba », organisée au printemps 1997 en Albanie ; réaction modérée lors des bombardements de l'OTAN contre la Serbie en 1999).
Les relations gréco-turques se détendent à leur tour, malgré l'enlèvement par les Turcs, en février 1999, du leader kurde du PKK, Abdullah Öcalan, alors qu'il venait de quitter l'ambassade de Grèce au Kenya. Mais cet incident diplomatique n'entame pas durablement la volonté d'apaisement des autorités grecques et turques. Lors des séismes qui touchent la Turquie et la Grèce en 1999, les deux peuples manifestent spontanément leur solidarité. En décembre, la levée du veto grec permet à la Turquie de devenir candidate officielle de l'Union européenne.
Grâce à une politique de rigueur, la Grèce parvient à combler son retard par rapport aux autres membres de l'Union européenne, et peut rejoindre la zone euro à la date prévue (le 1er janvier 2001). À cette fin, une partie de la dette et du déficit publics est sciemment dissimulée ; ce qui ne sera révélé que plusieurs années plus tard.
1.5. Vers l'éclatement du système bipartite (2005-2009)
Emmenés par Kóstas Karamanlís (neveu de l'ex-président Konstandínos Karamanlís), la Nouvelle Démocratie inflige une lourde défaite aux socialistes du Pasok lors des élections législatives de mars 2004, puis lors des élections européennes de juin. Mettant à profit la dynamique créée par les jeux Olympiques, les conservateurs donnent la priorité à une politique économique libérale centrée sur la croissance et l'emploi, la modernisation de l'agriculture et des services, la lutte contre la corruption et la modernisation de l'éducation.
En 2005, alors que le socialiste Károlos Papoúlias est élu à la présidence de la République, la Grèce ratifie par voie parlementaire le traité constitutionnel européen. Une série d'affaires écorne l'image du parti au pouvoir, mais la persistance du clientélisme et l'inanité des réformes annoncées (notamment dans l'éducation, la recherche, la santé et sur le marché du travail) discréditent le gouvernement. En réaction à cette faillite de l'État, le malaise grandit au sein de la jeunesse, dont les diplômes n'assurent pas de débouchés, inquiète sur son avenir et réclamant des crédits supplémentaires pour l'éducation.
L'été 2007 est endeuillé par des incendies qui font au moins 77 morts dans le Péloponnèse, l'île d'Eubée et la région d'Athènes. Confronté à la colère de l'opinion publique scandalisée par l'incurie des services de l'État mise en évidence lors des incendies, Kóstas Karamanlís convoque des élections législatives anticipées le 16 septembre, à l'issue desquelles les conservateurs n'obtiennent qu'une majorité parlementaire réduite à 152 sièges (sur 300). Le Pasok de Gheórghios Papandhréou (fils d'Andhréas Papandhréou) limite les dégâts en conservant 102 voix. Les véritables gagnants du scrutin sont les petites formations – le parti communiste, la coalition de gauche radicale, Syriza et l'extrême droite, le LAOS – qui profitent du discrédit des grands partis.
Dans ce contexte politique très fragile, la Grèce connaît une nouvelle flambée nationaliste autour de la question du nom de la République voisine de Macédoine. Au sommet de Bucarest de l'OTAN (2-4 avril 2008), de grands efforts sont déployés pour parvenir à un compromis entre Athènes et Skopje, mais la médiation internationale se solde par un échec, et la Grèce oppose son veto à l'adhésion de la Macédoine à l'Alliance atlantique, alors que l'Albanie et la Croatie sont invitées à la rejoindre. Dans le même temps, le gouvernement Karamanlís s'oppose fermement à la reconnaissance de l'indépendance unilatérale du Kosovo, faisant front commun avec Chypre et la Roumanie pour soutenir les positions serbes.
Le 6 décembre 2008, le décès d'un adolescent victime d'une bavure policière à Athènes, suivi du déploiement de plusieurs unités antiémeute pour faire face à ces centaines d'Athéniens manifestant contre l'« arbitraire policier », suffit à mettre le feu aux poudres. Une flambée de violences urbaines et de manifestations embrase la capitale et s'étend rapidement à plusieurs villes de province (Salonique, Patras, Ioánnina, Iráklion, Khaniá). L'opposition réclame la démission du gouvernement et des élections législatives anticipées.
À l'issue des élections européennes de juin 2009, le Pasok – devançant de près de 4 points Nouvelle Démocratie – réclame à nouveau des élections anticipées. À l'issue du scrutin du 9 octobre, Nouvelle Démocratie, enregistrant son plus mauvais score depuis sa création (33,49 % des voix, 91 députés), perd le pouvoir au profit du Pasok, qui, avec 43,93 % des suffrages, obtient une confortable majorité de 160 sièges. Le LAOS (5,6 % des voix) réussit à canaliser une partie des déçus de droite et devient la quatrième force politique du pays derrière le parti communiste qui demeure stable avec 7,5 % des suffrages.
2. La Grèce au bord de la faillite (2009-2018)
Gheórghios Papandhréou (à la tête du Pasok depuis 2004) devient Premier ministre ; il constitue un cabinet resserré dans lequel il se réserve, étant partisan d'un rapprochement avec la Turquie, le portefeuille des Affaires étrangères. Confronté à une situation économique et financière alarmante – un déficit public estimé après révision des statistiques (depuis 2004) à 12,7 % du PIB, une dette de 300 milliards d'euros (soit 113 % du PIB) –, à la défiance des marchés et à la mise en garde de l'Union européenne, il affirme dès la mi-décembre 2009 sa volonté de ramener le déficit à 3 % en 2012.
2.1. Les premiers plans d’aide et d’austérité
Appelant ses concitoyens à un « pacte social », G. Papandhréou dévoile un plan de sauvetage « douloureux », prévoyant une cure d'austérité sans précédent dans la fonction publique, la réduction de l'exorbitant budget militaire et des dépenses de santé, le lancement d'une ambitieuse lutte contre la fraude fiscale et le recul de l'âge du départ à la retraite. Le 3 février 2010, la Grèce, qui a lancé un grand emprunt de 8 milliards d'euros, est placée sous l'étroite surveillance budgétaire de la Commission européenne. Début mai, les ministres des Finances de la zone euro décident d'activer un mécanisme de soutien à la Grèce d'une ampleur inédite – 110 milliards d'euros sur 3 ans, dont 80 milliards à la charge des États membres de l'Union monétaire européenne (la somme sera substantiellement réduite après la défection de la Slovaquie et, frappés à leur tour par la crise, de l’Irlande et du Portugal), et 30 milliards financés par le Fonds monétaire international (FMI) –, en contrepartie de mesures supplémentaires d'austérité, dont l'annonce suscite de nouvelles manifestations et un mouvement de grève générale.
Victime d'une récession sévère au dernier trimestre 2010, la Grèce, ne parvient pas à tenir les objectifs fixés. G. Papandhréou, écartelé entre les pressions de l'UE et les très fortes tensions politiques (au sein de l'opposition comme au sein du Pasok) et sociales dans son pays, réduit encore son cabinet pour faire adopter un deuxième train de mesures de rigueur (juin 2011) : celui-ci prévoit 28,4 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur 4 ans ; il est assorti d'un plan de privatisation de 50 milliards d'euros devant être mis en œuvre d'ici à 2015.
Le 21 juillet, au terme de difficiles tractations, le FMI, la BCE et les 17 membres de la zone euro (soucieux d'éviter la contagion à d'autres pays européens) parviennent à un accord en vue d'un second plan de sauvetage d'un montant de plus de 100 milliards d’euros, assorti d’une contribution du secteur privé, sur la période 2011-2014. Mais la solvabilité du pays étant de plus en plus mise en doute, notamment en raison de la récession estimée à - 5 % en 2011, de très fortes tensions sur les marchés frappent les établissements financiers et bancaires européens les plus exposés. Tandis qu’interviennent les banques centrales, les ministres de l’Économie et des Finances de l’Eurogroupe peinent à trouver une position commune, se contentant d’exiger de la Grèce – dont le maintien dans la zone euro reste cependant une priorité – qu’elle tienne ses engagements (privatisations, réduction supplémentaire des dépenses publiques, réforme fiscale en vue d’une levée de l’impôt) avant le déblocage de la prochaine tranche de 8 milliards d’euros.
Le 27 octobre, sous la pression des marchés et des agences de notation, les 17 États européens parviennent finalement à un accord unanime prévoyant l’annulation de la moitié de la dette grecque auprès des banques et la poursuite du soutien financier au pays en échange d’un renforcement du contrôle des institutions créancières sur le budget national, d'une accélération du programme de privatisations et de la poursuite des mesures d'austérité. Contre toute attente, G. Papandhréou, décide avec le soutien de son gouvernement, de soumettre cet accord à référendum (« mémorandum ») avant d’y renoncer et de démissionner, cédant son poste à Loukás Papadhímos, un technocrate sans parti, ancien vice-président de la BCE. Dans l’attente d’élections anticipées en 2012, un gouvernement de coalition provisoire avec la Nouvelle démocratie et le parti d’extrême droite LAOS, est formé le 11 novembre. Le Pasok y conserve la plupart de ses représentants, dont le ministre des Finances et vice-Premier ministre sortant, Evángelos Venizélos.
En mars 2012, le second programme d’ajustement et d’assistance est avalisé par l’Eurogroupe (près de 142 milliards d’euros seront apportés par un Fonds européen de stabilité financière [FESF, opérationnel depuis août 2010] et 12 milliards par le FMI jusqu’en 2015), tandis que la dette détenue par le secteur privé est restructurée, ce qui allège le stock de la dette grecque de plus de 100 milliards d’euros.
2.2. Les élections législatives de 2012
Le scrutin organisé en mai 2012 se solde par l’effondrement du Pasok et de la Nouvelle Démocratie : le premier, réduit à 13 % des voix contre près de 44 % en 2009, perd 119 sièges, tandis que ND, avec 18,8 % des suffrages (contre 33,4 % en 2009) en conserve 108, grâce à la prime des 50 sièges attribués au parti arrivé en tête. La coalition de la gauche radicale, Syriza, menée par Aléxis Tsípras – résolument hostile à la politique d’austérité et prônant l’annulation du mémorandum – fait une entrée fracassante sur la scène politique grecque, passant de 4,6 % à 16,8 % des suffrages et 52 sièges, en deuxième position devant les socialistes.
Par ailleurs, un groupe de députés indépendants (Anexártitoi Ellines, « Les Grecs indépendants »), issu de ND mais opposé au mémorandum, remporte plus de 10 % des suffrages et 33 sièges ; un groupuscule néonazi, Aube dorée, qui s’est notamment illustré par ses violentes exactions contre la communauté immigrée, parvient à entrer au Parlement avec près de 7 % des voix et 21 députés.
Aucun des principaux partis ne parvenant à former un gouvernement majoritaire, un nouveau scrutin est organisé en juin : alors que l’éventualité d’une sortie du pays de la zone euro (avec ses menaces sur la stabilité de l’ensemble de l’Union) est envisagée par certains en cas de victoire des formations les plus hostiles à la politique imposée par Bruxelles, l’équilibre global des forces reste le même. Mais la légère avance de ND (29,6 % des voix et 129 sièges) face à Syriza (26,8 % et 71 sièges) permet à son chef, Antónis Samarás, de réunir une fragile coalition avec le Pasok et la gauche démocrate Dimar (Dimokratikí Aristerá), un groupe dissident ayant rompu avec la gauche radicale. Si ces résultats sont accueillis avec un certain soulagement par l'UE, le nouveau gouvernement, où ND détient la plupart des postes ministériels, doit répondre aux exigences des bailleurs de fonds tout en essayant d’obtenir un assouplissement des conditions de la poursuite de l’aide internationale.
2.3. Austérité, marasme économique et dérives xénophobes
En dépit des manifestations et des tensions aiguës qu’elle suscite, la politique d’austérité est poursuivie par le gouvernement Samarás : en novembre 2012, la loi sur la programmation budgétaire à moyen terme (prévoyant quelque 18 milliards d’euros d’économies d’ici à 2016), ainsi que le budget de rigueur pour 2013, sont votés par le Parlement, les aides de l’Eurogroupe et du FMI étant débloquées en plusieurs tranches à partir de décembre. Appliquées dès le mois de janvier 2013, ces mesures comportent notamment de nouvelles réductions de salaires et de pensions dans les secteurs public et parapublic, un report de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans, et des licenciements dans la fonction publique. Une réforme fiscale est également adoptée en juillet, tandis que le secteur touristique est encouragé par une baisse de la TVA.
La situation sociale continue de se dégrader (le taux de chômage dépasse 27 %, 58 % parmi les jeunes) et devient délétère, constituant un terrain favorable aux actions brutales d’Aube dorée. L’assassinat par un membre de ce parti, le 18 septembre, du rappeur antifasciste Pávlos Fýssas (nom de scène Kyllah P.) provoque d’importantes manifestations et oblige les autorités à agir contre les dirigeants du mouvement et contre certains responsables de la police accusée de passivité, voire de collusion avec l’extrême droite.
Appauvrie, avec un revenu disponible amputé d’environ un tiers depuis le début de la crise, la population grecque reste très majoritairement hostile à la politique menée, sans envisager pour autant ni une sortie de la zone euro (à l’instar de la gauche radicale Syriza) ni une alternative claire au gouvernement en place. Soutenu par environ 40 % des Grecs, le Premier ministre et la coalition au pouvoir ne disposent toutefois plus que d’une courte majorité parlementaire depuis le retrait de la gauche démocrate Dimar en juin, à la suite de la fermeture abrupte de la télévision publique ERT pour des raisons budgétaires.
Alors que des coupes supplémentaires dans les dépenses de l’État et un nouvel impôt foncier sont adoptés en décembre, le pays prend la présidence tournante de l’UE en janvier 2014. Si la dette culmine désormais à 177 % du PIB, une timide embellie semble pourtant se profiler après six ans de récession grâce notamment au retour à un excédent budgétaire primaire en avril. Les échéances électorales du mois de mai constituent ainsi un important test politique pour le gouvernement.
2.4. Des élections intermédiaires de 2014 à la victoire de Syriza
Des trois élections municipales, régionales et européennes organisées concomitamment en mai 2014 (auxquelles participent entre 58 % et 62 % des électeurs), le dernier scrutin retient le plus l’attention : avec 26,6 % des voix et 6 sièges sur 21, Syriza (dont le président A. Tsípras a été choisi comme candidat emblématique à la présidence de la Commission européenne par la gauche radicale européenne) arrive en tête devant ND (22,7 % et 5 sièges). Contribuant à la montée des partis d’extrême droite en Europe, Aube dorée se hisse à la troisième place avec 9,3 % des suffrages et 3 sièges devant l’alliance de centre gauche forgée par le Pasok (l’Olivier, 8 % et 2 sièges). Viennent ensuite la nouvelle formation centriste To Potami (« la Rivière », 6,6 %), le parti communiste (6 %) et Les Grecs indépendants (3,4 %). La gauche Dimar n’obtient que 1,2 % des voix. La même tendance, mais de moindre ampleur, s'observe à l’issue des deux autres consultations.
La percée de Syriza, qui obtient approximativement le même nombre de voix qu’aux législatives de juin 2012 (25 %-26 %), est surtout due à sa performance en Attique, région la plus peuplée de Grèce (29 % du corps électoral) dont la candidate Rena Dourou enlève le gouvernorat au Pasok. Le parti l’emporte également dans les Îles ioniennes mais, tout en progressant, ne parvient pas à s’imposer dans les autres régions. S’il enlève Corfou et Larissa à la ND, la mairie d’Athènes lui échappe de justesse au second tour, le maire sortant indépendant (soutenu par les socialistes et les écologistes), Georgios Kaminis, étant reconduit avec 51,4 % des voix, tandis qu’à Thessalonique, Iannis Boutaris, soutenu par le Pasok et Dimar, est largement réélu. Dans d’autres grandes municipalités comme Patras (remportée par les communistes), Rhodes ou Le Pirée, le parti arrive en troisième position.
Par ailleurs, les scores d’Aube dorée – 16 % et 4 sièges dans la capitale ; 11 % et 6 conseillers en Attique ; 9 % en Grèce centrale, au Péloponnèse et en Macédoine centrale – montrent que l’extrême droite, qui entre dans la plupart des conseils régionaux ainsi que dans d’importants conseils municipaux dont celui de Thessalonique, n’est pas près de disparaître malgré l’arrestation de plusieurs de ses dirigeants.
Contrairement au scrutin de 2010 beaucoup plus ouvertement politisé, dans la plupart des circonscriptions, les élections municipales sont surtout marquées par l’élection ou la reconduction de candidats sans étiquette, soucieux de se démarquer de la coalition au pouvoir à Athènes. L’emportant directement ou indirectement dans 7 régions sur 13 – dont 4 où elle succède au Pasok (Égée du Sud, Égée du Nord, Grèce centrale et Macédoine orientale-Thrace) –, ND parvient dans l’ensemble à résister en recueillant au total autour de 30 % des voix. Le parti socialiste, lui, semble bien sur le déclin en dépit de la réélection des gouverneurs sortants « indépendants », issus de ses rangs, de Crète et de Grèce occidentale.
Rassuré par ces résultats contrastés, A. Samaras rejette la demande d’élections législatives anticipées formulée par A. Tsípras et remanie son gouvernement en juin. En vain cependant : en décembre, le candidat du gouvernement Stavros Dimas n’ayant pas recueilli assez de voix au Parlement pour être élu président de la République, de nouvelles élections législatives s’avèrent nécessaires.
2.5. La victoire de Syriza et la reprise des négociations avec l’Eurogroupe
Le 25 janvier 2015, le rejet des programmes successifs d’austérité conduit à la victoire historique de Syriza qui, avec 36,3 % des suffrages, remporte 149 sièges sur 300 devant ND (27,8 % et 76 sièges), frôlant ainsi la majorité absolue. Aube dorée (6,2 % des voix et 17 sièges) arrive en troisième position au coude à coude avec To Potami, devant le parti communiste, le Pasok et Les Grecs indépendants. Ayant conclu une alliance avec ces derniers, A. Tsípras accède le lendemain à la tête du gouvernement, avec pour premier objectif l'obtention de la part des créanciers du pays de la renégociation de la dette devenue quasi insoutenable. Des discussions très tendues s’engagent dès lors entre Athènes, Bruxelles et le FMI.
La situation économique, budgétaire et financière se dégradant et la Grèce ayant fait défaut sur sa dette vis-à-vis du FMI le 30 juin, un nouveau programme d’assistance s’avère nécessaire, alors que l’éventuelle sortie du pays de la zone euro (« Grexit »), alternative aux graves conséquences pour l’UE comme pour la Grèce, est de moins en moins écartée.
Interrompant les négociations engagées avec les créanciers, A. Tsípras annonce, suscitant surprise et irritation chez ces derniers, la tenue d'un référendum sur les propositions des créanciers, qu'il appelle à rejeter. Bien que conforté par le « non » massif de ses concitoyens (61,3 %) exprimé le 5 juillet, le Premier ministre doit pourtant céder, au prix de plusieurs défections au sein de sa propre formation et de la démission de son ministre des Finances Yánis Varoufákis : un accord est finalement signé le 12 dans le but avant tout de « rétablir la confiance » entre les institutions européennes et le gouvernement grec. Conduits par l'Allemagne, les partisans les plus inflexibles des mesures d’austérité et les plus hostiles à une décote de la dette l’emportent et la tutelle sur la Grèce s’en trouve renforcée.
L’ouverture de discussions en vue d’un troisième plan d’aide financière d’un montant maximum de 86 milliards d’euros, octroyé par le Mécanisme européen de stabilité (MES, institué de manière permanente en octobre 2012), est acceptée sous de strictes conditions : notamment, l’élargissement de l’assiette de la TVA et la hausse de son taux de 13 % à 23 % pour plusieurs biens et services, l’accélération et l’approfondissement de la réforme des retraites, des limitations quasi automatiques des dépenses publiques en cas de dérapages par rapport aux objectifs d’excédents primaires (« règle d’or » budgétaire). Figure également une intensification du programme de privatisations, sous la supervision des institutions européennes avec l'objectif de récolter 50 milliards d’euros destinés au remboursement de la recapitalisation des banques (pour 50 %), à la diminution du ratio d’endettement et à l’investissement.
Jugé irréaliste, inefficace et « toxique » par les uns, accueilli avec soulagement par les autres, l’accord est adopté par le Parlement grec à une large majorité ; il permet de parer au plus pressé (éviter momentanément au pays de faire défaut et réinjecter des liquidités dans le système bancaire), mais il laisse en suspens la question de la restructuration de la dette et ouvre une nouvelle période d’incertitudes politiques.
Les membres de Syriza les plus hostiles à ce revirement font ainsi scission, faisant perdre au gouvernement sa majorité. En démissionnant et en provoquant des élections anticipées le 20 septembre, A. Tsípras parvient cependant à surmonter ces difficultés : avec 35,46 % des voix, Syriza obtient 144 sièges devant la ND (28,1 % et 75 sièges) et peut reformer un gouvernement de coalition, quasiment inchangé, avec les Grecs indépendants (3,69 % et 9 sièges). Si ce nouveau scrutin est marqué par une hausse de l’abstention (43,4 %), le Premier ministre en sort d’autant plus conforté que les frondeurs de Syriza hostiles à l’accord passé avec l’UE et réunis dans un nouveau parti, Unité populaire, ne parviennent pas à franchir le seuil de 3 % des voix qui est nécessaire pour être représenté.
La coopération avec les créanciers s’améliore : un ensemble de réformes peut être adopté en octobre-novembre et une première évaluation conduit au déblocage d’une nouvelle tranche de l’aide européenne en novembre puis en décembre. La poursuite de la réforme des retraites – qui provoque cependant en février 2016 la troisième grève nationale depuis la reconduction du Premier ministre –, les privatisations et le règlement de la question des prêts bancaires « non performants » sont parmi les chantiers en cours dans l’attente de l’ouverture de discussions sur une restructuration de la dette.
Parallèlement, à partir de l’été 2015, la Grèce doit faire face à l’arrivée massive de migrants et de réfugiés (en provenance surtout de Syrie, d’Iraq et d’Afghanistan) à destination de l’Europe. Nécessitant l’appui de l’UE, cette « crise migratoire » est partiellement résorbée dans l’urgence par un accord avec la Turquie, en mars 2016, qui prévoit que cette dernière retienne la population concernée sur son territoire, et par l’instauration de « centres d’accueil et d’enregistrement » (hotspots) sur cinq îles grecques (Chio, Kós, Léros, Lesbos et Samos) entre octobre 2015 et juin 2016.
3. La Grèce convalescente (2018-)
Le 20 août 2018, le troisième et dernier programme d’aide à la Grèce, lancé en 2015, prend fin. Le montant total des prêts octroyés dans le cadre des trois plans appliqués depuis 2010 s’élève à près de 289 milliards d’euros, dont environ 204 milliards octroyés par le Fonds européen de stabilité financière (FESF) puis par le MES. En 2017, l’économie a renoué avec la croissance (1,5 % et autour de 2 % en 2018) et l’État présente un excédent budgétaire à partir de 2016 (0,5 %) contre un déficit de 15 % en 2009. Le nombre de fonctionnaires a été réduit de 25 % et les salaires dans la fonction publique de 30 %.
Par ailleurs, s'élevant à plus de 27 % en 2013, le taux de chômage a connu une baisse continue pour atteindre 18,1 % en mars 2019. Mais cette diminution est aussi due à l’émigration qui a plus que doublé par rapport aux années précédant la crise (avec plus de 100 000 départs par an depuis 2012, dont beaucoup de diplômés) ; la précarité s’est aggravée et le revenu disponible net des Grecs est désormais l’un des plus bas au sein de la zone euro et de l’OCDE, malgré quelques mesures compensatoires comme la première hausse depuis 2012 du salaire minimum (de 11 %), décidée en 2019.
Bien que stabilisée, la situation macroéconomique demeure fragile. Si on a accordé à la Grèce, en août 2017 et en juin 2018, un allègement de sa dette à court et moyen terme et l'étalement d’une partie des remboursements à partir de 2032, le pays reste sous la stricte surveillance de ses créanciers et la marge de manœuvre du gouvernement – qui s’est engagé à dégager un excédent budgétaire primaire de 3,5 % jusqu’en 2022 (puis de 2,2 % jusqu’en 2060) – reste très étroite.
Politiquement fragilisé depuis la signature de l’accord de Prespa – ratifié de justesse par le Parlement grec par 153 voix favorables contre 146 et une abstention – qui normalise les relations avec « l’ex-république yougoslave de Macédoine » mais provoque en Grèce des réactions nationalistes et une crise gouvernementale (janvier 2019), A. Tsípras doit faire face aux déceptions et tenter de surmonter l’usure du pouvoir.
3.1. La défaite de Syriza et le retour au pouvoir de la Nouvelle démocratie
Avec 23,7 % des voix, derrière la Nouvelle démocratie (33,1 %), Syriza subit un premier recul au scrutin européen de mai 2019. A. Tsípras annonce alors des élections législatives anticipées trois mois avant la date prévue. Considéré comme un test, le second tour des élections municipales et régionales (2 juin) se solde par une victoire écrasante de la ND qui s’impose dans la quasi-totalité des régions. Dirigé depuis 2016 par Kyriákos Mitsotákis (fils de l’ex-Premier ministre, entre 1990 et 1993), ce parti remporte notamment la mairie d’Athènes avec plus de 60 % des voix.
Comme prévu, la ND s’impose aux élections de juin en remportant une majorité absolue de 158 sièges, avec 39,8 % des suffrages, devant Syriza (31,5 % et 86 sièges), le Mouvement pour le changement (coalition de quatre partis dont le PASOK, Dimar et To Potami, 8 % des voix et 22 sièges) et le parti communiste (5,3 % et 15 députés). Deux nouveaux partis (à droite, Solution grecque ; à gauche, Méra25 ou Front de désobéissance réaliste européen, de Yánis Varoufákis), font leur entrée au Parlement tandis qu’Aube dorée disparaît de l’assemblée en ne franchissant pas le seuil de 3 % des voix.
En juillet, K. Mitsotákis est investi au poste de Premier ministre.