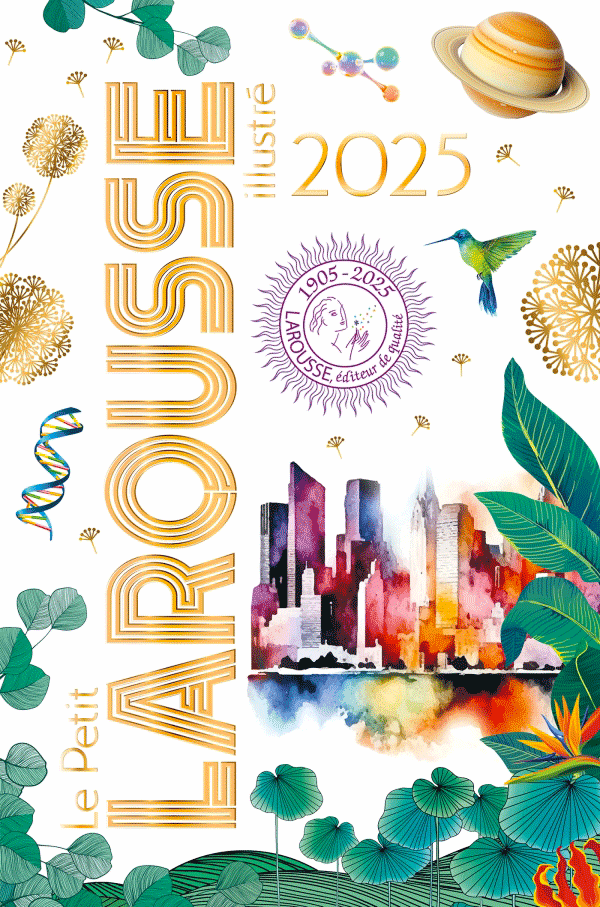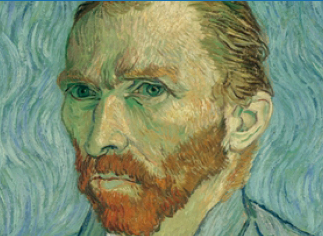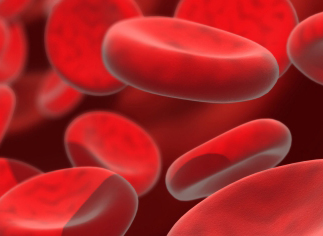Côte d'Ivoire : histoire
1. Peuples et royaumes : une histoire complexe inégalement connue
1.1. Coexistence pacifique de plusieurs populations
L'histoire du territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire, mais aussi celle de ses voisins (Ghana, Guinée), est caractérisée par l'installation à diverses époques de populations issues des régions voisines, les plus anciennes implantations étant localisées sur la lagune côtière.
Les Sénoufos, puis les Malinkés vinrent du Nord (actuels Burkina Faso et Mali), les Baoulés, les Agnis, les Abrons, membres du groupe akan, de l'Est (actuel Ghana), les Bétés de l'Ouest (actuel Liberia). Sans que l'on puisse prétendre que cette coexistence fut totalement pacifique, il ne semble pas qu'elle ait donné lieu à des affrontements majeurs, aucun peuple n'érigeant de véritable empire conquérant. Il n'y a pas eu d'organisations politiques englobantes. Les groupes akans ignoraient la notion de pouvoir central : la richesse conférait l'autorité. L'activité de ces populations, très mobiles tout en restant liées à la lagune, était en partie dédiée à la pêche.
1.2. Premiers royaumes
Lorsque les Achantis commencèrent à se structurer dans la zone de savane, il arriva fréquemment, à partir de la fin du xviie siècle, que des princes vaincus, mécontents du sort qui leur était réservé, quittent la région avec leur peuple pour aller fonder un royaume ailleurs et échapper ainsi aux querelles dynastiques. Parmi ces migrants, les Agnis fondèrent Enchi (Ghana) et le royaume littoral d'Assinie.
Au xviiie siècle, les Denkyiras, vaincus, fondèrent le petit royaume de Ndemé et Moronou. Les Baoulés quittèrent eux aussi l'espace conquis par les Achantis pour fonder, au début du xviiie siècle, les villages de Béoumi et de Beglessou dans la moyenne vallée de la Bandama. La seconde implantation baoulée, venue de l'espace achanti en Côte d'Ivoire, date du début du xviiie siècle. Vers 1717, une querelle entre le roi achanti Opoku Ware et la reine Abla Pokou conduisit celle-ci à franchir la Comoé et à s'installer dans les environs de Bouaké avec un groupe qui prit le nom de Baoulés. Ce royaume n'eut qu'une existence éphémère : la nièce de la reine Pokou put maintenir l'unité du groupe mais, à sa mort sur le champ de bataille, les Baoulés se dispersèrent ; les clans furent la seule trace de l'organisation sociale baoulée qui subsista alors qu'ils se mêlaient aux Sénoufos ou aux Malinkés. Une partie de ces migrants prit la direction du Nord puis de l'Est pour fonder le nouveau royaume de Tyokosi (Togo).
Dans la région, seuls les Akans créèrent à l'Est et au Centre des royaumes durablement structurés. L'empire dioula de Kong, au Nord, n'eut qu'une existence éphémère dans la première moitié du xviiie siècle.
La dynastie Ouattara : royaume de Kong, de Bobo-Dioulasso
La ville de Kong vit s'installer la famille mandée de Tiéba Ouattara, qui fit fortune dans le tissage et acquit des armes pour ses trois fils. L'aîné, Sékou, chef d'une armée au service du roi de Kong, Kéréou Sésouma, le détrôna et devient roi grâce au soutien de ses hommes qui appréciaient son intégrité dans le partage des butins.
Le cadet de Sékou, Famaghan, alla fonder quant à lui le royaume de Bobo-Dioulasso vers 1714, sans doute comme épilogue à une crise dynastique. Les relations entre les deux cités furent souvent tendues : les héritiers Ouattara se disputaient la primauté ainsi que des territoires qu'ils ambitionnaient de contrôler l'un et l'autre. Famaghan s'empara même des insignes du pouvoir de Kong et son fils Tiéba (1729-1742) refusa toujours de les rendre. Le royaume Ouattara de Bobo-Dioulasso s'assura le contrôle de vastes régions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso jusqu'au début du xixe siècle. Sous Maghan Oulé Ouattara (1749-1809), roi lettré et soldat, le royaume atteignit son apogée avant de s'effondrer sous la pression des peuples dominés à partir de 1851. Le royaume n'existait plus lors de la conquête française car, entre-temps, il avait été absorbé et dépecé par Samory Touré et ses alliés.
La puissance du royaume de Kong fut bientôt moins liée à la guerre qu'au contrôle des voies commerçantes au Sud (or, kola, armes) et au nord (esclaves, bétail, sel et chevaux), à ses activités commerciales et à son rayonnement culturel. Les marchands musulmans firent construire de vastes maisons à terrasse de style soudanais, s'entourèrent de lettrés et de marabouts et les cinq mosquées avec leurs medersa dominaient la ville protégée par des remparts. Sa défense n'était plus assurée quand Samory se présenta en mai 1897 et la rasa.
2. Les premiers Européens
Des navigateurs portugais abordèrent en 1469 et fondèrent les comptoirs de Bassam et de Sassandra. Leur succédèrent, deux siècles plus tard, les Hollandais, puis les Français à partir de 1842 (bien après une brève installation à Assinie, de 1687 à 1705).
Les comptoirs européens avaient pour objectif de servir de points d'appui pour le commerce de l'ivoire, mais également du poivre et des esclaves. La Côte d'Ivoire fut toutefois relativement épargnée par la traite en raison du caractère plutôt inhospitalier de sa côte, mais aussi du fait de l'absence de royaumes guerriers et négriers.
La colonisation française suivit, à ses débuts, une voie pacifique à travers des traités de protectorats négociés par de jeunes administrateurs (Treich-Laplène, Binger, Delafosse), aujourd'hui encore honorés par les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire fut érigée en colonie en 1893, et sa place dans l'Afrique-Occidentale française (A-OF) précisée en 1904. La conquête du centre du pays se heurta à une vive résistance des Gouros et des Baoulés, et celle du Nord à la présence du chef malinké Samory Touré, qui avait commencé son combat contre le colonisateur en Guinée. Il fut vaincu en 1898, mais des troubles sporadiques durèrent jusqu'à la Première Guerre mondiale.
3. De la colonie à l'indépendance
3.1. Mise en valeur de la colonie
La Côte d'Ivoire connaît trois capitales successives : Grand-Bassam, Bingerville puis Abidjan, à partir de 1934, lors de la réforme qui rattache une partie de la Haute-Volta à la colonie. La mise en valeur, tournée vers la satisfaction des besoins de la métropole, commence très tôt. Elle se caractérise par le développement de plantations, de café principalement, et par l'exploitation des palmeraies naturelles et de la forêt. Les plantations ne sont pas exclusivement européennes : certaines sont détenues par des « indigènes ». L'un d'entre eux, Félix Houphouët, lance dès 1932 un mouvement de protestation contre les discriminations dont ils font l'objet. Entre les deux guerres, sont également lancés des travaux d'infrastructure (port d'Abidjan et chemin de fer Abidjan-Niger) qui seront amplifiés après 1945.
3.2. L'entrée en politique de Félix Houphouët-Boigny
L'histoire de la Côte d'Ivoire s'identifie alors avec celle de Félix Houphouët, qui a ajouté à son nom celui de Boigny, « le bélier » en baoulé. Il fonde en 1944 le syndicat des planteurs africains et est élu député du collège indigène à l'Assemblée constituante française en 1945 ; il sera constamment réélu durant toute la IVe République. Le 16 avril 1946 est promulguée la loi à laquelle son nom est attaché, « tendant à supprimer le travail forcé dans les Territoires d'outre-mer » ; elle lui vaut immédiatement une notoriété qui dépasse largement les frontières de son pays et lui permet d'être le principal artisan de la création du Rassemblement démocratique africain (RDA), parti « multi-territorial » fondé à Bamako en octobre 1946. Pour les autorités françaises, F. Houphouët-Boigny est un homme dangereux : populaire et habile, il ne connaît aucun échec électoral, ni national, ni local. Mais les milieux européens de Côte d'Ivoire ne lui pardonnent pas ses combats. À Paris, on se méfie de celui qui s'est apparenté au groupe communiste de l'Assemblée.
Fin 1949 et début 1950, de graves incidents se produisent en Côte d'Ivoire, faisant des victimes. Le parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) est interdit, et un mandat d'arrêt délivré contre son chef, F. Houphouët-Boigny, qui échappe de peu à l'arrestation. Le conflit est apaisé en 1951 grâce au ministre de la France d'outre-mer, François Mitterrand, dont le RDA rallie alors le parti, l'Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR). F. Houphouët-Boigny est désormais totalement intégré dans la vie politique française. Il devient ministre en 1956, appartient à tous les derniers cabinets de la IVe République, et demeure au gouvernement avec le général de Gaulle, qu'il n'abandonne qu'après être devenu Premier ministre de Côte d'Ivoire (dans le cadre de la Communauté), en avril 1959. Il demeurera désormais, jusqu'à sa mort, l'allié fidèle et écouté de Paris.
4. La présidence de Félix Houphouët-Boigny (1960-1993)
4.1. Un régime « paternaliste »
Houphouët-Boigny est évidemment élu président de la République au moment de l'indépendance (7 août 1960). Il est candidat unique et le sera à chaque élection quinquennale, sauf à la dernière, en 1990. Le président est en même temps chef du gouvernement. Le PDCI est un parti unique, de fait, mais, à partir de 1980, les électeurs peuvent choisir, pour les scrutins législatifs et locaux, entre plusieurs candidats présentés par lui. Le président tiendra à maintenir une disposition « transitoire » dérogatoire à la Constitution, qui ne sera abolie qu'après sa mort : les Africains non ivoiriens bénéficient du droit de vote. Il envisagera même en 1966 de créer une citoyenneté commune aux nationaux ivoiriens, voltaïques et nigériens, mais devra renoncer devant l'hostilité générale que ce projet soulève.
Dans un pareil système, la vie politique ne peut guère être active. Elle n'est marquée que par un complot en 1963 et un autre en 1973, suivis de condamnations à mort, puis de grâces présidentielles, par l'« africanisation » du gouvernement, qui s'achève par le départ en 1966 de R. Saller, le tout-puissant ministre des Finances, ancien gouverneur de la France d'outre-mer, par une certaine contestation du président à la suite d'un scandale politico-financier en 1983, et par diverses fièvres sur le campus d'Abidjan.
Il faut attendre le « vent d'Est » qui souffle à partir de 1989 pour qu'elle s'anime un peu. Le vieux président, malade, freine autant qu'il le peut le mouvement. Mais il doit admettre l'instauration du multipartisme et se voit opposer pour la première fois un challenger, Laurent Gbagbo, chef du Front populaire ivoirien (FPI), lors de la présidentielle de 1990. Houphouët-Boigny l'emporte, certes, avec plus de 80 % des voix, mais les abstentions atteignent 30 %. L'essentiel du pouvoir est assuré désormais par Alassane Ouattara, nommé en novembre 1990 au poste nouvellement créé de Premier ministre.
4.2. Politique étrangère
Le président est mu par plusieurs idées-forces, dont la principale est peut-être le rôle prépondérant qu'il entend faire jouer à son pays dans l'ensemble africain francophone. Cela le conduit à rejeter, au moment de l'indépendance, le projet de fédération qui aurait assuré la prééminence de Dakar, puis à soutenir activement les diverses institutions comme l'Organisation commune africaine et malgache (OCAM) qui regroupe les pays modérés issus de l'Union française. Car l'ancien « compagnon de route » du PCF est devenu anticommuniste et s'oppose à ses deux voisins, le Ghana et la Guinée, que leurs leaders respectifs, Kwame Nkrumah et Sékou Touré, ont lancé dans la voie du socialisme.
Il constate avec inquiétude, tout comme Paris, la montée en puissance du Nigeria pétrolier, ce qui l'amène à soutenir la dissidence du Biafra. À partir de 1970, ses relations avec ses anciens adversaires de l'Afrique de l'Ouest se normalisent progressivement, ce qu'entérine la conférence de Monrovia de mars 1978.
Partisan du dialogue, Houphouët-Boigny a tenté d'intervenir dans le problème sud-africain, ne craignant pas de braver l'opinion publique africaine en nouant des contacts avec les autorités du régime d'apartheid, et ce dès le début des années 1970.
5. L'après Houphouët-Boigny : une succession sous tension
5.1. Henri Konan Bédié (1993-1999) et le repli nationaliste
Le mandat interrompu de F. Houphouët-Boigny, qui meurt en décembre 1993, est achevé, aux termes de la Constitution, par le président de l'Assemblée, Henri Konan Bédié. Après avoir fait adopter un nouveau code électoral (décembre 1994) afin d’empêcher la candidature de son principal concurrent, A. Ouattara, qui est alors accusé d’être burkinabé – l'article 49 stipulant que « nul ne peut être élu président de la République s'il n'est Ivoirien de naissance, né de père et mère eux-mêmes Ivoiriens de naissance » – H. K. Bédié remporte haut la main l'élection présidentielle en octobre 1995. Mais l’abstention est très forte, ses deux principaux adversaires, A. Ouattara et L. Gbagbo, s’étant retirés et leurs partis respectifs – Rassemblement des républicains (RDR) et FPI – ayant appelé au boycottage du scrutin pour protester contre la nouvelle loi électorale. Le débat politique se focalise dès lors sur le thème de l’« ivoirité ».
Le président Bédié et son Premier ministre doivent faire face à une situation intérieure difficile : paupérisation urbaine, afflux de réfugiés du Liberia et de la Sierra Leone, xénophobie rampante. La Côte d'Ivoire procède à un repli nationaliste au travers notamment d'une série de mesures : adoption d'une politique de préférence nationale en matière d'emploi, instauration d'une carte de séjour et adoption d'un nouveau Code foncier rural, qui interdit l'accès à la propriété aux non-Ivoiriens. Les autorités ivoiriennes semblent hésiter à jouer pleinement le jeu démocratique : le mode d'exercice du pouvoir de l'ancien président continue de marquer les esprits.
Un projet de révision de la Constitution qui accroît considérablement les pouvoirs, déjà très étendus, du chef de l'État est adopté en juin 1998. Après l'annonce par A. Ouattara, devenu président du RDR, de sa candidature à l'élection présidentielle de 2000 (juillet 1999), le pouvoir tente une fois de plus de démontrer que ce candidat n'est pas ivoirien mais burkinabé. Des affrontements opposent ses partisans aux forces de l'ordre ; les principaux dirigeants du RDR sont arrêtés.
Au cours de l'automne 1999, prenant prétexte d'un conflit foncier, les Ivoiriens procèdent à une véritable chasse aux Burkinabés, qui sont repoussés au-delà des frontières. Dans ce climat politique délétère, le président Bédié est destitué le 24 décembre 1999 au terme d'une mutinerie de jeunes soldats.
5.2. Le général Robert Gueï (1999-2000)
Le général Gueï, ancien chef d'état-major, devient le nouvel homme fort du pays. Il forme un Comité national de salut public (CNSP), organe militaire de dix membres, et annonce (janvier 2000) la tenue d'un référendum constitutionnel avant l'organisation d'élections générales, prévues pour l'automne. Il forme un gouvernement de transition regroupant les principales formations politiques du pays (en particulier le RDR de A. Ouattara et le FPI de L. Gbagbo). À la suite d'un remaniement (mai) permettant au général Gueï de consolider son pouvoir en intégrant neuf membres du CNSP et en limitant la participation du RDR à un seul représentant, ce dernier décide de s'en retirer. En juillet, la nouvelle Constitution et le nouveau Code électoral sont approuvés par une majorité d'Ivoiriens (88 % de « oui »). Pourtant, quelques jours avant le scrutin, de nouvelles restrictions sont apportées aux conditions d'éligibilité pour empêcher la candidature de A. Ouattara qui est invalidée début octobre par la Cour suprême. H. Konan Bédié et ses partisans sont également écartés de la course, laissant R. Gueï et L. Gbagbo, seuls prétendants sérieux, en lice.
Au soir du premier tour, les résultats partiels sont favorables à L. Gbagbo, qui revendique aussitôt la victoire. Le général Gueï refuse la défaite et s'autoproclame président, mais il est chassé par plusieurs milliers de manifestants soutenus par une partie des forces armées. A. Ouattara conteste la légitimité du nouveau président, mettant en avant le fort taux d'abstention. Cette situation explosive débouche sur de violents affrontements entre les partisans de L. Gbagbo (chrétiens du Sud) et ceux de A. Ouattara (musulmans du Nord), faisant près de 200 victimes.
6. Laurent Gbagbo et les menaces de guerre civile (2000-2011)
Laurent Gbagbo forme un gouvernement « d'ouverture » comprenant sa propre formation, le FPI, et le PDCI, qu'il a combattu pendant des années lorsqu'il était dans l'opposition ; le RDR choisit de rester à l'écart.
Début décembre, alors que le pays se prépare à retourner aux urnes pour élire ses députés, la candidature de A. Ouattara est à nouveau rejetée par la Cour suprême. Les violences reprennent, tandis que l'état d'urgence est décrété et un couvre-feu, instauré. Le scrutin, boycotté par le RDR, se déroule dans un calme relatif, mais il est reporté dans de nombreuses villes du Nord (193 sièges, seulement, sont pourvus, sur les 225 que comprend l'Assemblée). Le FPI distance le PDCI (96 sièges contre 77) et s'impose comme la première force politique du pays. Le taux de participation est très faible (33 %). Mais les municipales de mars 2001 – auxquelles participe le RDR – donnent une image différente du rapport des forces : c'est le parti de A. Ouattara qui conquiert le plus grand nombre de villes, dont certaines dans l'Ouest et dans le Sud, suivi du PDCI, puis du FPI. Seule constante, la très forte abstention. En août 2002, le RDR entre dans le nouveau gouvernement « d'ouverture ».
6.1. Le coup d'État manqué du 19 septembre 2002
Le 19 septembre, une trentaine de sous-officiers, limogés ou déserteurs, rentrés de leur exil au Burkina Faso les armes à la main pour se joindre à 650 mutins, révoltés par la menace d'être démobilisés, s'emparent de plusieurs bâtiments stratégiques d'Abidjan, ainsi que de la deuxième ville du pays, Bouaké, et de la capitale du Nord, Korhogo. Le général Gueï – à qui est imputée la responsabilité du putsch – et le ministre de l'Intérieur sont tués. À l'issue de combats qui font plusieurs centaines de morts, les troupes loyalistes reprennent le contrôle d'Abidjan, mais les villes du Nord restent aux mains des rebelles, regroupés au sein du Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI). Le pays est coupé en deux et la menace de guerre civile n'est circonscrite que grâce à la présence de forces d'interposition : conformément à l'accord de défense franco-ivoirien du 24 avril 1961, la France renforce ses effectifs militaires en Côte d'Ivoire, les portant de 650 à 2 500 hommes (opération « Licorne »), et elle implique les pays voisins à travers l'envoi de « Casques blancs » de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
6.2. L'accord de Linas-Marcoussis du 24 janvier 2003 ou la paix malgré les Ivoiriens
Après l'échec de plusieurs médiations africaines, la France tente de réconcilier les Ivoiriens en réunissant à Linas-Marcoussis (Essonne), du 15 au 24 janvier 2003, le camp présidentiel, les rebelles et l'opposition non armée. Obtenu à l'arraché, l'accord de paix de Linas-Marcoussis prévoit la nomination d'un Premier ministre de consensus à la tête d'un « gouvernement de réconciliation nationale », au sein duquel les rebelles se voient attribuer les ministères de la Défense et de l'Intérieur. À Abidjan, cet accord soulève la colère des « jeunes patriotes » partisans du président, qui, outragés par la « capitulation imposée à Paris », se livrent à des violences antifrançaises. Un bras de fer s'engage alors entre la France et L. Gbagbo : ce dernier exige que l'attribution des ministères de la Défense et de l'Intérieur aux rebelles (rebaptisés, à Marcoussis, en « Forces nouvelles ») soit invalidée. Pour protéger ses ressortissants, la France menace de replier ses forces sur Abidjan et d'ouvrir la voie aux insurgés. Le 8 mars 2003, un compromis est finalement trouvé (accord d'Accra) : les deux ministères clés seront gérés par un Conseil national de sécurité composé de 15 membres, dont le chef de l'État, le Premier ministre et un représentant de chaque partie signataire de l'accord de Linas-Marcoussis. Entré en vigueur début mai, un accord de cessez-le-feu concernant l'ensemble du pays permet la levée du couvre-feu décrété après l'insurrection du 19 septembre 2002.
6.3. Ni guerre ni paix
Un an après l'accord de Linas-Marcoussis – auquel les parties au conflit n'ont eu de cesse de se soustraire –, le processus de pacification n'a guère abouti. Constitué après huit mois de négociations, le gouvernement d'union nationale est boycotté par les partis et le pays est toujours coupé en deux. Mettant à profit la « guerre des chefs » que se livrent, au Nord, l'ex-leader estudiantin Guillaume Soro et le sergent-chef Ibrahim Coulibaly, le régime du président Gbagbo s'est rétabli sans partage réel du pouvoir. Tant du côté gouvernemental que de la part des rebelles, nombreuses sont les exactions commises depuis le début de la guerre civile : malgré la publication d'une enquête des Nations unies concluant, dès janvier 2003, à l'existence d'« escadrons de la mort » proches de la présidence ivoirienne, assassinats ciblés, rackets, exécutions ou disparitions d'étrangers se succèdent dans la moitié sud du pays, accompagnés d'un chantage permanent à l'égard de la France, accusée de complicité avec les Forces nouvelles. Sur l'ensemble du territoire, la violence exercée sur les civils s'est banalisée, comme en témoignent les massacres des 25, 26 et 27 mars 2004 à Abidjan, lorsque près de 200 manifestants de l'opposition tombent victimes d'une répression préméditée impliquant les plus hautes autorités de l'État, ou ceux des 20 et 21 juin 2004 à Bouaké et à Korhogo, où des querelles d'influence et les purges qui s'ensuivent font une centaine de morts.
Le 4 avril 2004, l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (Onuci) se déploie dans le pays : composée de 6 000 hommes, cette force de paix intègre les contingents de la CEDEAO, mais non les 4 000 soldats français de l'opération « Licorne », dont le mandat est prorogé d'un an. Dans l'espoir de sauver le processus de paix en Côte d'Ivoire, l'ONU, la CEDEAO et l'UA réunissent à Accra le 30 juillet 2004 (Accra III) les parties au conflit : celles-ci se voient remettre un échéancier prévoyant la reconstitution du gouvernement d'union nationale (boycotté par l'ensemble de l'opposition depuis la répression meurtrière du mois de mars) et liant l'adoption de réformes politiques – notamment la révision de l'article 35 de la Constitution qui régit les conditions d'éligibilité à la présidence – au désarmement des Forces nouvelles et des forces armées régulières avant le 15 octobre. Le respect de ces échéances doit conduire la Côte d'Ivoire à des élections à l'automne 2005.
À l'exception du premier point, aucune des réformes fixées par l'accord d'Accra n'est mise en œuvre par la classe politique ivoirienne. La situation se dégrade en novembre 2004 lorsque, rompant le cessez-le-feu garanti par la communauté internationale et défiant les mises en garde de la France contre toute tentative de reconquête du Nord, L. Gbagbo ordonne le bombardement de positions rebelles à Bouaké et à Korhogo les 4 et 5 novembre. Le 6, un raid de l'aviation ivoirienne contre les troupes françaises à Bouaké fait 9 morts et 34 blessés parmi les soldats de l'opération « Licorne ». En représailles, la France détruit l'ensemble de l'aviation ivoirienne et procède à l'évacuation de 8 000 de ses ressortissants, devenus la cible des exactions des « patriotes ». À sa demande, le Conseil de sécurité de l'ONU impose un embargo immédiat sur les ventes d'armes à la Côte d'Ivoire, assorti de sanctions individuelles, et renforce le mandat de l'Onuci. Parallèlement, l'Union africaine confie au président sud-africain Thabo Mbeki une mission de médiation.
6.4. L'incessant report des élections
T. Mbeki parvient à arracher, le 6 avril 2005 à Pretoria, un accord prévoyant la cessation immédiate des hostilités et la reprise du processus de désarmement mais éludant volontairement la modification de l'article 35 de la Constitution, point focal de la crise. Selon l'accord, un plan de sécurité permettra le retour en Côte d'Ivoire des acteurs réfugiés à l'étranger, tels que H. Konan Bédié et A. Ouattara. Le 26 avril, L. Gbagbo accepte que la candidature de Alassane Ouattara, son principal opposant, soit retenue pour l'élection présidentielle du 30 octobre 2005, date à laquelle son mandat arrive à expiration. Le 18 mai, à Paris, les quatre principaux partis de l’opposition, le RDR de A. Ouattara, le PDCI d’Henri Konan Bédié, l’Union pour la démocratie en Côte d’Ivoire (UDPCI) dirigée par Albert Mabri Tailleusse, et le Mouvement des forces d’avenir (MFA) d’Innocent Kobenan Anaky, forment une coalition politique, le Rassemblement houphouëtiste pour la démocratie et la paix (RHDP). Cependant, devant l'impossibilité matérielle d'organiser des élections, le Conseil de sécurité de l'ONU décide le maintien de L. Gbagbo à son poste pour une durée n'excédant pas douze mois ; un nouveau Premier ministre de transition, Charles Konan Banny, doté de pouvoirs élargis, est chargé d'organiser le désarmement des forces rebelles et l'élection présidentielle avant le 31 octobre 2006 (résolution 1633).
Malgré quelques avancées (mise en place d'une Commission électorale indépendante, identification des électeurs), C. Konan Banny ne parvient pas à organiser des élections avant la date butoir. En novembre 2006, il voit ses pouvoirs renforcés au détriment du président Gbagbo, dont le mandat est une nouvelle fois prorogé d'un an (résolution 1721 du Conseil de sécurité de l'ONU). Mais le président Gbagbo refuse de se laisser dépouiller de ses prérogatives. Fort du soutien de l'armée, il s'oppose à la résolution 1721 – perçue comme une ingérence dans les affaires ivoiriennes – et, prenant l'ensemble de la communauté internationale de vitesse, préconise le dialogue direct avec la rébellion en vue du désarmement et de la réunification du pays.
Entamées début février 2007 à Ouagadougou sous l'égide du président burkinabé, Blaise Compaoré, les négociations entre L. Gbabgo et Guillaume Soro, le secrétaire général des Forces nouvelles, débouchent sur un accord de paix le 4 mars. L'accord de Ouagadougou fixe les grandes lignes d'une sortie de crise selon un calendrier précis pour sa mise en œuvre : suppression progressive de la « zone de confiance », démantèlement des milices favorables au président Gbagbo, intégration des militaires rebelles au sein de l'armée régulière et formation d'un nouveau gouvernement de transition. Le plan de paix prévoit également l'établissement d'une liste électorale fiable en vue des élections générales prévues d'ici à la fin de l'année et l'extension d'une précédente loi d'amnistie (à l'exclusion des auteurs de crimes contre l'humanité et des responsables de crimes de guerre). Nommé Premier ministre le 29 mars, G. Soro prend la tête du gouvernement d'union nationale formé le 7 avril. Une loi d'amnistie couvrant les crimes de la guerre civile est promulguée le 13 avril.
Mais la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions de l'accord de paix s'avère laborieuse, en dépit de l'impatience des Ivoiriens et de la bonne volonté des protagonistes. L'accord de Ouagadougou connaît des aménagements importants : initialement prévue en janvier 2008, l'élection présidentielle est reportée une première fois en novembre 2007, au plus tard à la fin du premier semestre 2008, avant d'être repoussée, le 14 avril, au mois de novembre 2008. Quant au processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des 45 000 combattants (33 000 rebelles et 12 000 supplétifs de l'armée régulière) –, timidement lancé à partir de décembre 2007 –, il pâtit de la prudence observée par les bailleurs de fonds européens, qui conditionnent leur aide aux progrès accomplis. Sa première phase n'est amorcée que le 2 mai 2008, avec le regroupement d'un millier d'anciens rebelles des Forces nouvelles.
En juillet 2010, le pays n’est toujours pas sorti de la crise et le mandat de l’Onuci – comprenant désormais plus de 7 000 militaires et soutenue par les 900 soldats de la force française Licorne – est prorogé de six mois tandis que la mission de facilitateur confiée à B. Compaoré est renouvelée par la CEDEAO. La Côte d’Ivoire vit ainsi une lente et difficile transition marquée par des conflits entre prétendants et les atermoiements du camp présidentiel, des rivalités qui se cristallisent autour de l’impartialité de la commission électorale et le recensement des électeurs. Après avoir porté pouvoir et opposition au bord de la rupture, ce différend entraîne un nouveau report de la date des élections, finalement organisées les 31 octobre et 28 novembre 2010.
7. Alassane Ouattara (2010-)
7.1. La crise post-électorale et la chute de L. Gbagbo
L. Gbagbo vient en tête du premier tour de l’élection présidentielle avec un peu plus de 38 % des suffrages, réalisant ses meilleurs scores dans les régions du Sud du pays dont Agnéby (74 %), Lagunes (59 %), Sud-Comoé (55 %), Moyen-Cavally et Fromager (53 %). Alassane Ouattara en obtient environ 32 %, faisant le plein des voix dans les régions du Nord (Denguélé [93 %]), Savanes [85 %], Worodougou [87 %] et Bafing [73 %] tandis que Henri Konan Bédié (25 %) l’emporte largement dans deux régions du centre (Lacs, 69 % et N'zi-Comoé, 65 %). Le camp anti-Gbagbo des « Houphouëtistes » (RHDP) se rassemble alors au second tour sur la candidature de A. Ouattara qui s’impose avec plus de 54 % des voix selon la Commission électorale indépendante, un résultat avalisé par les Nations unies et l’Union africaine (UA).
Mais après avoir invalidé le scrutin dans plusieurs départements du Nord pour fraude, le Conseil constitutionnel, suspecté d'être acquis à L. Gbagbo, proclame la victoire du président sortant (51,45 % des suffrages), qui prête serment le lendemain. Son rival – soutenu par la plus grande partie de la communauté internationale –, fait de même de son côté et reconduit G. Soro à la tête de son propre gouvernement.
L'ex-chef d'État sud-africain Thabo Mbeki est dépêché par l'UA pour tenter une médiation tandis que s'accentuent les pressions internationales. Un bras de fer s’engage dès lors entre les deux prétendants, L. Gbagbo, inflexible, restant sourd à la stratégie d’étouffement économique mise en place avec l’embargo sur les exportations de cacao ou aux exigences réitérées de l’UA.
Sur le terrain, le blocage post-électoral se transforme en conflit avec son cortège d'ingrédients : exode massif de populations, activité économique à l'arrêt, usage de mercenaires dans les deux camps, recrutement de miliciens et distribution d'armes dans le clan Gbagbo, massacres de civils, lynchages, guerre de quartiers.
Cependant, le rapport de force militaire évolue en faveur de A. Ouattara, ses alliés des Forces nouvelles (ex-rebelles du Nord) rebaptisées Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) ayant repris les armes pour lancer une violente offensive vers le sud, s’emparant de la plupart des villes tandis que l’armée régulière est mise en déroute ou finit par lâcher L. Gbagbo qui ne peut compter désormais que sur le soutien de sa garde présidentielle. À partir du 31 mars 2011, les combats s’étendent à Abidjan. Les pillages se multipliant et la situation humanitaire se dégradant, la force française Licorne intervient militairement avec l'aval des Nations unies au côté de l’Onuci avec pour mission officielle de protéger la population civile et de détruire l’armement lourd des dernières troupes fidèles au président sortant. De plus en plus isolé après de nouvelles défections dans son entourage et le cessez-le-feu annoncé par son chef d’état-major, assiégé dans sa résidence contre laquelle les FRCI lancent, sans succès, une première offensive le 6 avril, L. Gbagbo est finalement appréhendé le 11 avril à la suite d’une attaque des troupes de A. Ouattara menée avec l’appui militaire décisif de la force Licorne. Après avoir annoncé l’ouverture d’une procédure judiciaire contre L. Gbagbo, son épouse et ses collaborateurs, A. Ouattara affirme sa volonté de créer une « Commission vérité et réconciliation » afin de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme alors que des massacres commis par les deux camps sont révélés par plusieurs ONG.
7.2. Le difficile retour à la paix civile
Tandis que L. Gbagbo – soupçonné d’être responsable, en tant que « coauteur indirect », de quatre chefs de crimes contre l’humanité perpétrés dans le contexte des violences postélectorales entre décembre 2010 et avril 2011 – comparaît devant la Cour pénale internationale de La Haye le 5 décembre 2011 en audience préliminaire, des élections législatives ont lieu en Côte d'Ivoire le 12 décembre. Le Rassemblement des républicains, parti d’Alassane Ouattara, vient sans surprise en tête du scrutin avec 127 sièges sur 255 devant le parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de son allié H. K. Bédié qui en obtient 77. Le Front populaire ivoirien (FPI) de L. Gbagbo ayant appelé au boycott du scrutin, le taux de participation n’atteint cependant que 36,56 %, alors qu’il avait dépassé 80 % à l’élection présidentielle de 2010. Après avoir franchi cette étape, le président doit désormais s’atteler à la reconstruction du pays.
La fin de la crise post-électorale permet à la Côte d’Ivoire, en récession en – 4,4 % en 2011, de renouer avec une croissance économique soutenue : 10,7 % en 2012, 9,2 % en 2013, 9 % en 2014. Les exportations (avec notamment des cours du cacao à la hausse), de bons résultats dans l’agriculture, d’importants investissements publics dans les infrastructures, le retour des investisseurs étrangers sont parmi les principaux facteurs contribuant à la reprise. La Côte d’Ivoire vise ainsi désormais le statut d’économie émergente.
7.3. Le second mandat d'A. Ouattara
Le 25 octobre 2015, fort d’un bilan économique encourageant avec un taux de croissance du PIB de 9,2 % en 2015, A. Ouattara est réélu dès le premier tour de scrutin avec 83,66 % des voix. Pascal Affi N'Guessan, candidat du FPI, obtient 9,29 % des suffrages.
Une partie de l’opposition ayant appelé au boycott du scrutin dont les fidèles inconditionnels de L. Gbagbo (en attente de son procès à La Haye), le taux de participation n’atteint toutefois que 52,8 % et malgré les audiences de la « Commission vérité et réconciliation », le dialogue politique n’est pas encore rétabli.
Les relations entre le pouvoir et l’opposition se crispent à l’occasion de la réforme constitutionnelle : acte de naissance de la IIIe République, la nouvelle Constitution est approuvée par référendum, le 30 octobre 2016, par 93,4 % des votants, mais le taux de participation n’atteint que 42,2 %, l’opposition ayant appelé à boycotter la consultation. Parmi les nouvelles dispositions, le texte prévoit notamment la suppression de la condition très contestée d’« ivoirité » pour accéder à la présidence, la création d’un poste de vice-président et l’institution d’un Sénat représentant les collectivités territoriales et les Ivoiriens de l’étranger.
Présentant cette victoire du « oui » comme un plébiscite, A. Ouattara est conforté également par les résultats des élections législatives du 18 décembre, en dépit d’une participation qui dépasse à peine 34 %. La coalition au pouvoir (RHDP) remporte 167 sièges sur 254 pourvus, alors que le FPI s’effondre avec 3 députés, les élus indépendants – en grande partie des dissidents du PDCI, du RDR ou du FPI – réalisant une percée avec 75 sièges. En janvier 2017, tandis que Daniel Kablan Duncan accède à la vice-présidence (un poste aux contours encore flous), Amadou Gon Coulibaly (secrétaire général de la présidence depuis 2012) le remplace comme Premier ministre.